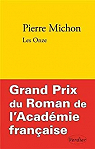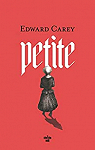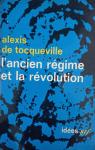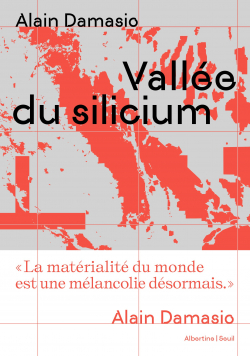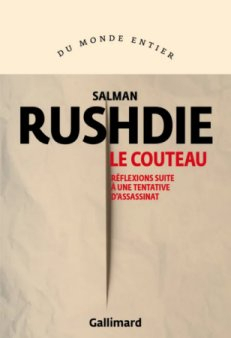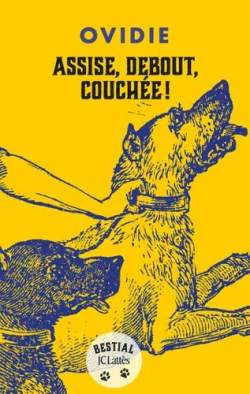Sophie Wahnich vous présente son ouvrage "La Révolution des sentiments : Comment faire une cité. 1789-1794" aux éditions Seuil. Entretien avec Clément Monseigne.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/3052750/sophie-wahnich-la-revolution-des-sentiments-comment-faire-une-cite-1789-1794
Note de musique : © mollat
Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/
Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux :
Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/
Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts
Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/
Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat
Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/
Vimeo : https://vimeo.com/mollat

Sophie Wahnich
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Résumé :
La Révolution française a été taraudée par une question : comment transmettre l’événement inouï aux générations qui ne l’auront pas vécu ? Les révolutionnaires ont alors cherché à inventer des institutions civiles qui permettraient d’entretenir le souvenir, mais surtout une tenue, une manière révolutionnaires d’être au monde. Cette question, ces institutions, les lieux et les pratiques qu’elles ont fait surgir, sont autant de laboratoires sociaux sensibles pour comp... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Histoire d'un trésor perdu : Transmettre la Révolution françaiseVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Transmettre et réinvestir (et non commémorer) les gestes, les textes et les actes des révolutionnaires
En introduction, Sophie Wahnich parle, entre autres, de Désarroi, d'Inquiétude, de Monuments, de Gestes et ritualités (« les gestes et leurs inscriptions sociales qui ont permis de fabriquer ces institutions civiles »), de Rejouer l'histoire révolutionnaire, renaitre ?, d'Une référence clivée, de la notion de « crime de lèse-humanité », des responsabilités individuelles et collectives, des Elèves anti-impérialistes de la Révolution ?, des Droits de l'homme, « Les droits de l'homme sont ainsi instrumentalisés pour sauver et protéger ceux qui ne se sont jamais cachés de défendre des projets qui les considéraient comme nuls et non advenus, en particulier en supprimant le cadre républicain du droit français », de la Résistance, des crimes de la guerre d'Algérie, du scandale de l'oubli des actes de torture, des Enoncés fantomatiques…
« Dans ce livre collectif, il s'agira de traverser, dans la discontinuité des temps, ces institutions civiles, faites bien sûr, de textes – qui le nierait ? -, mais aussi de gestes, de lieux, métissages complexes d'héritages réinventés, fantasmés, monuments pour se donner du courage, signalétique pour se reconnaître pétris d'un même désir de liens.
Il s'agira donc de revenir sur des quêtes, des pertes, des dénis, des clivages pour les moments de transmission chaque fois singuliers. A l'inquiétude révolutionnaire d'une Révolution inouïe, difficile à assimiler au présent et difficile à transmettre aux générations futures font suite le déni et le travestissement thermidoriens. En sommes-nous vraiment sortis ? ».
L'auteure revient aussi sur les années 70, la chute du mur de Berlin, de la « Révolution à l'ère des soupçons et des accusations », de la disqualification radicale du moment révolutionnaire, de 1793 – « moment le plus radical et égalitaire », d'Ethique, d'imaginaire social, de prescription collective au renoncement à l'idéal et aux idéaux, de 1989 pathétique ?…
Elle termine sur le bicentenaire, les révolutions du printemps arabe, « l'insistance d'une référence émancipatrice », la dégradation du mot révolution lui-même, de la « dimension utopique d'un désir subjectif d'un monde tout autre advenu en 1789 », la réinvention, « contre ce désintérêt et contre la coupure radicale entre passé révolu et un aujourd'hui immuable, une continuité. Il faudra commencer par refuser les préalables de l'histoire froide qui repose sur cette coupure et construit cet immuable », les femmes et les hommes ordinaires, les « demandes inaugurales de droit et de liberté »…
Elle cite René Char : « Nous n'appartenons à personne sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient éveillés le courage et le silence ».
Sommaire :
Sophie Wahnich : L'inquiétude de la transmission
Jolène Bureau : Aux origines de la légende noire de Robespierre : les premiers récits sur l'événement-Thermidor
Anna Karla : Editer la Révolution sous la Restauration : la collection « Barrière et Berville »
Emmanuel Fureix : Une transmission discontinue. Présences sensibles de la Révolution française, de la Restauration aux années 1830
Nathalie Richard : Rêver à la guillotine. Souvenirs révolutionnaires, psychologie et politique en France au XIXe siècle
Olivier le Trocquer : « Une seconde fois perdue ». L'héritage de la Révolution et sa transmission, de 1848 aux années 1880
Marc Deleplace : La Révolution française à l'école (1880-2008)
Jean-Numa Ducange : La transmission socialiste de la Révolution française au XIXe siècle
Guillaume Mazeau : La bataille du public. Les droites contre-révolutionnaires et la diffusion de l'histoire de la Révolution française au début du XXe siècle
Comment transmettre le passé, les passés, rendre compte des événements, de l'événement inouï qu'est une révolution ?
Comment lutter contre les écritures des « vainqueurs », les dénégations, les reniements, les omissions, les travestissements, les édulcorations, les fermetures ?
A ces questions habituelles, il convient aussi d'ajouter : Comment transmettre le présent dans ses dimensions de rupture, de fait accompli, de bouleversement, de révolution ? Comment parler vers le futur de cet actuel/inactuel, de ce possible espéré enfin en cours, des gestes, des actes et des décisions, de cet inouï, de ce fragile ?
Transmettre.
De ce riche ouvrage, je me contente d'évoquer certains points abordés par Sophie Wahnich dans son article : « L'inquiétude de la transmission »
Le moment révolutionnaire et l'inquiétude. Regard vers la postérité (« le tiers interpellé, un tiers qui motive l'action ») et vision des regards qui seront portés vers ce présent lorsqu'il sera devenu passé. « Cette inquiétude fabrique de fait une temporalité qui investit le futur, mais un futur déjà antérieur ».
Comment aborder la « violence fondatrice » contre la violence quotidienne des anciens rapports sociaux, comment l'articuler à la « vengeance publique » et non privée, juger des infamies, du crime de « lèse-humanité », comment maintenir/construire la confiance dans l'avenir ?
Comme le souligne l'auteure, la postérité est bien présente dans l'imaginaire révolutionnaire, dans les imaginaires des révolutionnaires. Postérité donc transmission. Elle donne comme exemple, « Cette transmission filiale et de religion civile est fantasmée et effectuée partout en France autour des autels de la Patrie », le chaînage des générations autour des « hymnes guerriers », du mourir pour la patrie, le mourir pour de bonnes lois…
Les générations passées et futures, comme appui « pour réclamer des actions qui rendent la coupure révolutionnaire effective ». Sans pouvoir en donner une définition totalement efficiente, la révolution est bien une rupture /brisure appréciable dans les quotidiens, les gestes, les organisations, les rapports sociaux, une (ré)actualisation advenue d'espérances…
Il ne s'agit pas de suivre une ligne tracée, de parcourir un chemin déjà écrit, mais d'inventer, dans leurs discontinuités, la liberté et l'égalité, de transmettre « cette capacité à maintenir sa liberté, maintenir le désir renouvelé de ne pas retomber dans une condition a-critique soumise à des lois devenues non-contemporaines ». La liberté « reconquise pour aujourd'hui et demain ». Transmettre c'est aussi construire « la ritualité civique et festive autour de cet arbre de la liberté ».
Que diront demain les citoyen-ne-s du « rendu de la justice », du procès fait à Louis, de sa condamnation ? Sophie Wahnich insiste : « la question de l'événement de justice est devenue indissociable de la question de la transmission ».
Situation difficile, inextricable, les temps de conflits ne se laissent pas réduire à l'aimable et soulignent les difficultés à faire face. Violences. Pour l'auteure, « le souci du moment des révolutionnaires est de protéger la société du caractère dissolvant de l'événement en tissant symboliquement un voile religieux capable d'entretenir un tabou sur une violence non métaphorisable ». Peut-être, mais la question de la violence ne peut rester un tabou. Elle est intrinsèque à l'événement, aux bouleversements de la société, au continuum et aux ruptures avec l'ordre/désordre existant. Encore ne faut-il ni la contourner (laissant la place au déchainement de la violence des dominants) ni la valoriser au nom d'hypothétiques « nécessités ».
Violences et justice. La justice a besoin d'instances dont la construction nécessite de prendre au sérieux l'idée de celles et ceux qui agissent, « l'exercice de la justice par le peuple lui-même ».
La violence peut aussi être inouïe, « L'événement est redevenu impossible à transmettre sinon sous la forme de l'effroi rétrospectif qui empêche de penser ». Violence comme acte exorbitant, certes, mais comme l'indique l'auteure « la résistance à l'oppression suppose la réciprocité des responsabilités », mais ne supprime ni l'effroi ni les conséquences dans le temps de cet inouï. Plus discutable me semble la confiance aux émotions.
Il ne faut pas oublier aussi « la manière dont cette violence a été instrumentalisée politiquement contre la possibilité d'une véritable souveraineté populaire ». Nous en revenons donc à la violence nécessaire pour briser la violence de l'ordre /désordre.
Sophie Wahnich traite de la Terreur, de la contradiction entre les « affects privés » et la « vertu publique », de la nécessité de « juguler l'incertitude par les institutions civiles », d'inventer les dispositifs « qui n'auraient pas encore été pensés pour pouvoir maintenir la liberté », inventer les dispositifs et les pratiques « capables de passer cette liberté qui ne pouvait reposer que sur des subjectivités sensibles, c'est-à-dire engagées ». L'auteure parle de « nouage serré de la raison et des émotions ». Donc, la construction d'institutions, « à la fois civiles et politiques » incorporant et développant la liberté initiative, « la liberté laissé au peuple », ce qui ne fournit cependant pas de recette… Justice et pouvoir souverain.
L'auteure insiste sur l'être libre, être responsable de son devenir, du devenir de la société, « non pour lui donner une forme immuable mais pour faire face à toutes les oppressions qui pourraient advenir ». Cela a bien quelque chose à voir avec le « souverain »…
Révolution, assoir les ruptures mais sans insulter le futur, nécessairement ouvert à des bifurcations, des croisements, des changements. Trancher dans des contradictions sans fantasmer sur la disparition de celles-ci. Ne pas employer le terme irréversible…
Transmettre les espoirs, les contingences, les bricolages, les compromis, les incertitudes, les manques ou les béances dans la mutation/transformation des rapports sociaux, de tous les rapports sociaux.
Liberté-égalité, droits individuels et collectifs des êtres humains, auto-détermination et auto-organisation des dominé-e-s, élargissement toujours des moyens et des organes de débats, de choix, de la démocratie souveraine…
Revenir sur la transmission de la Révolution français, c'est en effet récupérer un « trésor perdu », (r)allumer une flamme d'espérance…
Lien : https://entreleslignesentrel..
En introduction, Sophie Wahnich parle, entre autres, de Désarroi, d'Inquiétude, de Monuments, de Gestes et ritualités (« les gestes et leurs inscriptions sociales qui ont permis de fabriquer ces institutions civiles »), de Rejouer l'histoire révolutionnaire, renaitre ?, d'Une référence clivée, de la notion de « crime de lèse-humanité », des responsabilités individuelles et collectives, des Elèves anti-impérialistes de la Révolution ?, des Droits de l'homme, « Les droits de l'homme sont ainsi instrumentalisés pour sauver et protéger ceux qui ne se sont jamais cachés de défendre des projets qui les considéraient comme nuls et non advenus, en particulier en supprimant le cadre républicain du droit français », de la Résistance, des crimes de la guerre d'Algérie, du scandale de l'oubli des actes de torture, des Enoncés fantomatiques…
« Dans ce livre collectif, il s'agira de traverser, dans la discontinuité des temps, ces institutions civiles, faites bien sûr, de textes – qui le nierait ? -, mais aussi de gestes, de lieux, métissages complexes d'héritages réinventés, fantasmés, monuments pour se donner du courage, signalétique pour se reconnaître pétris d'un même désir de liens.
Il s'agira donc de revenir sur des quêtes, des pertes, des dénis, des clivages pour les moments de transmission chaque fois singuliers. A l'inquiétude révolutionnaire d'une Révolution inouïe, difficile à assimiler au présent et difficile à transmettre aux générations futures font suite le déni et le travestissement thermidoriens. En sommes-nous vraiment sortis ? ».
L'auteure revient aussi sur les années 70, la chute du mur de Berlin, de la « Révolution à l'ère des soupçons et des accusations », de la disqualification radicale du moment révolutionnaire, de 1793 – « moment le plus radical et égalitaire », d'Ethique, d'imaginaire social, de prescription collective au renoncement à l'idéal et aux idéaux, de 1989 pathétique ?…
Elle termine sur le bicentenaire, les révolutions du printemps arabe, « l'insistance d'une référence émancipatrice », la dégradation du mot révolution lui-même, de la « dimension utopique d'un désir subjectif d'un monde tout autre advenu en 1789 », la réinvention, « contre ce désintérêt et contre la coupure radicale entre passé révolu et un aujourd'hui immuable, une continuité. Il faudra commencer par refuser les préalables de l'histoire froide qui repose sur cette coupure et construit cet immuable », les femmes et les hommes ordinaires, les « demandes inaugurales de droit et de liberté »…
Elle cite René Char : « Nous n'appartenons à personne sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient éveillés le courage et le silence ».
Sommaire :
Sophie Wahnich : L'inquiétude de la transmission
Jolène Bureau : Aux origines de la légende noire de Robespierre : les premiers récits sur l'événement-Thermidor
Anna Karla : Editer la Révolution sous la Restauration : la collection « Barrière et Berville »
Emmanuel Fureix : Une transmission discontinue. Présences sensibles de la Révolution française, de la Restauration aux années 1830
Nathalie Richard : Rêver à la guillotine. Souvenirs révolutionnaires, psychologie et politique en France au XIXe siècle
Olivier le Trocquer : « Une seconde fois perdue ». L'héritage de la Révolution et sa transmission, de 1848 aux années 1880
Marc Deleplace : La Révolution française à l'école (1880-2008)
Jean-Numa Ducange : La transmission socialiste de la Révolution française au XIXe siècle
Guillaume Mazeau : La bataille du public. Les droites contre-révolutionnaires et la diffusion de l'histoire de la Révolution française au début du XXe siècle
Comment transmettre le passé, les passés, rendre compte des événements, de l'événement inouï qu'est une révolution ?
Comment lutter contre les écritures des « vainqueurs », les dénégations, les reniements, les omissions, les travestissements, les édulcorations, les fermetures ?
A ces questions habituelles, il convient aussi d'ajouter : Comment transmettre le présent dans ses dimensions de rupture, de fait accompli, de bouleversement, de révolution ? Comment parler vers le futur de cet actuel/inactuel, de ce possible espéré enfin en cours, des gestes, des actes et des décisions, de cet inouï, de ce fragile ?
Transmettre.
De ce riche ouvrage, je me contente d'évoquer certains points abordés par Sophie Wahnich dans son article : « L'inquiétude de la transmission »
Le moment révolutionnaire et l'inquiétude. Regard vers la postérité (« le tiers interpellé, un tiers qui motive l'action ») et vision des regards qui seront portés vers ce présent lorsqu'il sera devenu passé. « Cette inquiétude fabrique de fait une temporalité qui investit le futur, mais un futur déjà antérieur ».
Comment aborder la « violence fondatrice » contre la violence quotidienne des anciens rapports sociaux, comment l'articuler à la « vengeance publique » et non privée, juger des infamies, du crime de « lèse-humanité », comment maintenir/construire la confiance dans l'avenir ?
Comme le souligne l'auteure, la postérité est bien présente dans l'imaginaire révolutionnaire, dans les imaginaires des révolutionnaires. Postérité donc transmission. Elle donne comme exemple, « Cette transmission filiale et de religion civile est fantasmée et effectuée partout en France autour des autels de la Patrie », le chaînage des générations autour des « hymnes guerriers », du mourir pour la patrie, le mourir pour de bonnes lois…
Les générations passées et futures, comme appui « pour réclamer des actions qui rendent la coupure révolutionnaire effective ». Sans pouvoir en donner une définition totalement efficiente, la révolution est bien une rupture /brisure appréciable dans les quotidiens, les gestes, les organisations, les rapports sociaux, une (ré)actualisation advenue d'espérances…
Il ne s'agit pas de suivre une ligne tracée, de parcourir un chemin déjà écrit, mais d'inventer, dans leurs discontinuités, la liberté et l'égalité, de transmettre « cette capacité à maintenir sa liberté, maintenir le désir renouvelé de ne pas retomber dans une condition a-critique soumise à des lois devenues non-contemporaines ». La liberté « reconquise pour aujourd'hui et demain ». Transmettre c'est aussi construire « la ritualité civique et festive autour de cet arbre de la liberté ».
Que diront demain les citoyen-ne-s du « rendu de la justice », du procès fait à Louis, de sa condamnation ? Sophie Wahnich insiste : « la question de l'événement de justice est devenue indissociable de la question de la transmission ».
Situation difficile, inextricable, les temps de conflits ne se laissent pas réduire à l'aimable et soulignent les difficultés à faire face. Violences. Pour l'auteure, « le souci du moment des révolutionnaires est de protéger la société du caractère dissolvant de l'événement en tissant symboliquement un voile religieux capable d'entretenir un tabou sur une violence non métaphorisable ». Peut-être, mais la question de la violence ne peut rester un tabou. Elle est intrinsèque à l'événement, aux bouleversements de la société, au continuum et aux ruptures avec l'ordre/désordre existant. Encore ne faut-il ni la contourner (laissant la place au déchainement de la violence des dominants) ni la valoriser au nom d'hypothétiques « nécessités ».
Violences et justice. La justice a besoin d'instances dont la construction nécessite de prendre au sérieux l'idée de celles et ceux qui agissent, « l'exercice de la justice par le peuple lui-même ».
La violence peut aussi être inouïe, « L'événement est redevenu impossible à transmettre sinon sous la forme de l'effroi rétrospectif qui empêche de penser ». Violence comme acte exorbitant, certes, mais comme l'indique l'auteure « la résistance à l'oppression suppose la réciprocité des responsabilités », mais ne supprime ni l'effroi ni les conséquences dans le temps de cet inouï. Plus discutable me semble la confiance aux émotions.
Il ne faut pas oublier aussi « la manière dont cette violence a été instrumentalisée politiquement contre la possibilité d'une véritable souveraineté populaire ». Nous en revenons donc à la violence nécessaire pour briser la violence de l'ordre /désordre.
Sophie Wahnich traite de la Terreur, de la contradiction entre les « affects privés » et la « vertu publique », de la nécessité de « juguler l'incertitude par les institutions civiles », d'inventer les dispositifs « qui n'auraient pas encore été pensés pour pouvoir maintenir la liberté », inventer les dispositifs et les pratiques « capables de passer cette liberté qui ne pouvait reposer que sur des subjectivités sensibles, c'est-à-dire engagées ». L'auteure parle de « nouage serré de la raison et des émotions ». Donc, la construction d'institutions, « à la fois civiles et politiques » incorporant et développant la liberté initiative, « la liberté laissé au peuple », ce qui ne fournit cependant pas de recette… Justice et pouvoir souverain.
L'auteure insiste sur l'être libre, être responsable de son devenir, du devenir de la société, « non pour lui donner une forme immuable mais pour faire face à toutes les oppressions qui pourraient advenir ». Cela a bien quelque chose à voir avec le « souverain »…
Révolution, assoir les ruptures mais sans insulter le futur, nécessairement ouvert à des bifurcations, des croisements, des changements. Trancher dans des contradictions sans fantasmer sur la disparition de celles-ci. Ne pas employer le terme irréversible…
Transmettre les espoirs, les contingences, les bricolages, les compromis, les incertitudes, les manques ou les béances dans la mutation/transformation des rapports sociaux, de tous les rapports sociaux.
Liberté-égalité, droits individuels et collectifs des êtres humains, auto-détermination et auto-organisation des dominé-e-s, élargissement toujours des moyens et des organes de débats, de choix, de la démocratie souveraine…
Revenir sur la transmission de la Révolution français, c'est en effet récupérer un « trésor perdu », (r)allumer une flamme d'espérance…
Lien : https://entreleslignesentrel..
critiques presse (1)
C'est une navigation passionnante que nous offre ce travail collectif, autour d'un événement que chacun, depuis deux siècles, a pu, ou dû, s'approprier, sans que le dernier mot, jamais, ne soit dit. Peut-être parce qu'on n'achève pas la Révolution ?
Lire la critique sur le site : Telerama
Citations et extraits (3)
Ajouter une citation
Il s’agira donc de revenir sur des quêtes, des pertes, des dénis, des clivages pour les moments de transmission chaque fois singuliers. A l’inquiétude révolutionnaire d’une Révolution inouïe, difficile à assimiler au présent et difficile à transmettre aux générations futures font suite le déni et le travestissement thermidoriens. En sommes-nous vraiment sortis ?
cette capacité à maintenir sa liberté, maintenir le désir renouvelé de ne pas retomber dans une condition a-critique soumise à des lois devenues non-contemporaines
Cette inquiétude fabrique de fait une temporalité qui investit le futur, mais un futur déjà antérieur
Videos de Sophie Wahnich (6)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : révolution françaiseVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Sophie Wahnich (14)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3237 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3237 lecteurs ont répondu