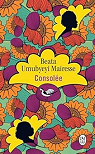Critiques filtrées sur 4 étoiles
[Lu dans le cadre du Grand Prix des lectrices de ELLE 2024]
Dans quatre brefs chapitres de présentation, Beata Umubyeyi Mairesse résume la trame narrative de son témoignage. Elle situe son histoire dans le temps et dans l'espace et explique les terribles circonstances de son départ du Rwanda. Elle expose ce qui l'a amenée à finalement écrire ce livre et tire les conclusions qui se sont imposées à elle. Elle développe ensuite chacun de ces points au fil de ses trouvailles et de ses réflexions dans quatre parties intitulées « Quatre photos », « Le temps du témoignage », « Terre des hommes » et « L'heure de nous-mêmes ». Les doutes, les questions et les réticences qui l'habitent hantent la totalité de ce récit. Est-elle la personne appropriée pour nous raconter sa fuite du Rwanda ? Est-elle légitime avec sa peau de métisse, noire pour les Blancs, blanche pour les Noirs ? Peut-elle parler au nom de tous ? Peut-elle sortir de la fiction dans laquelle elle s'est réfugiée jusqu'à maintenant pour parler de ce traumatisme ? Elle a eu sa possession (elle racontera comment c'est arrivé) quatre photos du convoi du 18 juin 1994 dans lequel elle et sa mère se trouvaient. Que va-t-elle, que peut-elle faire de ces photos sur lesquelles elle n'a vue ni sa mère ni elle-même ? Elle commence alors une enquête pour tenter de retrouver les enfants qui paraissent sur les photos, mais se rend compte au fil des rencontres qu'il est plus facile de trouver de la documentation sur les sauveurs que sur les victimes… Comment redonner aux victimes la place qui leur est due ?
***
Le titre de ce document, le Convoi, rappelle forcément d'autres convois qui me viennent à l'esprit avant ceux du Rwanda. Je trouve que le choix de ce titre permet de sensibiliser le lecteur aux plus récents, ceux du Rwanda. Cependant, dans ce cas, le projet des organisateurs est tout autre : il s'agit de soustraire ces enfants aux mains des génocidaires ! Dès le début, l'autrice pointe d'autres responsabilités que celles des Hutus : « Personne ne veut entendre les rares voix qui rappellent que l'ethnicisation de la société rwandaise est une construction coloniale. Ils s'entretuent depuis la nuit des temps, n'est-ce pas » (p. 17). La chronologie présentée à la fin de l'ouvrage permet de retrouver et de situer les événements, du protectorat allemand (1897) à l'arrivée des Belges (1916) jusqu'à juillet 1994. Même dans la présentation de cette chronologie apparaît l'attitude de la France avant et pendant le génocide. Je vivais au Québec à cette époque, et je me souviens de la froide colère de Roméo Dallaire quand il parlait, en interview, des responsabilités de l'Occident dans ce massacre, tout en déplorant son impuissance à agir en tant que commandant de la MINUAR. Passionnant aussi le questionnement de l'autrice à propos des photos que les reporters prennent des victimes. Elle s'interroge sur leur droit à l'image, sur la violence de cette représentation, sur la conservation des ces témoignages visuels et sur la manière souvent désinvolte dont ils sont utilisés, classés, perdus, diffusés, etc. Comme souvent ceux qui écrivent sur leur propre passé, l'autrice s'interroge encore sur les pièges de la mémoire, la manière dont on transforme ses propres souvenirs, la méfiance qu'elle éprouve envers les interprétations a posteriori, celles des autres, bien sûr, mais, avec un grand souci de vérité, les siennes propres. Un document intéressant et nécessaire, à mon avis, parfois confus et souffrant de quelques redites.
Dans quatre brefs chapitres de présentation, Beata Umubyeyi Mairesse résume la trame narrative de son témoignage. Elle situe son histoire dans le temps et dans l'espace et explique les terribles circonstances de son départ du Rwanda. Elle expose ce qui l'a amenée à finalement écrire ce livre et tire les conclusions qui se sont imposées à elle. Elle développe ensuite chacun de ces points au fil de ses trouvailles et de ses réflexions dans quatre parties intitulées « Quatre photos », « Le temps du témoignage », « Terre des hommes » et « L'heure de nous-mêmes ». Les doutes, les questions et les réticences qui l'habitent hantent la totalité de ce récit. Est-elle la personne appropriée pour nous raconter sa fuite du Rwanda ? Est-elle légitime avec sa peau de métisse, noire pour les Blancs, blanche pour les Noirs ? Peut-elle parler au nom de tous ? Peut-elle sortir de la fiction dans laquelle elle s'est réfugiée jusqu'à maintenant pour parler de ce traumatisme ? Elle a eu sa possession (elle racontera comment c'est arrivé) quatre photos du convoi du 18 juin 1994 dans lequel elle et sa mère se trouvaient. Que va-t-elle, que peut-elle faire de ces photos sur lesquelles elle n'a vue ni sa mère ni elle-même ? Elle commence alors une enquête pour tenter de retrouver les enfants qui paraissent sur les photos, mais se rend compte au fil des rencontres qu'il est plus facile de trouver de la documentation sur les sauveurs que sur les victimes… Comment redonner aux victimes la place qui leur est due ?
***
Le titre de ce document, le Convoi, rappelle forcément d'autres convois qui me viennent à l'esprit avant ceux du Rwanda. Je trouve que le choix de ce titre permet de sensibiliser le lecteur aux plus récents, ceux du Rwanda. Cependant, dans ce cas, le projet des organisateurs est tout autre : il s'agit de soustraire ces enfants aux mains des génocidaires ! Dès le début, l'autrice pointe d'autres responsabilités que celles des Hutus : « Personne ne veut entendre les rares voix qui rappellent que l'ethnicisation de la société rwandaise est une construction coloniale. Ils s'entretuent depuis la nuit des temps, n'est-ce pas » (p. 17). La chronologie présentée à la fin de l'ouvrage permet de retrouver et de situer les événements, du protectorat allemand (1897) à l'arrivée des Belges (1916) jusqu'à juillet 1994. Même dans la présentation de cette chronologie apparaît l'attitude de la France avant et pendant le génocide. Je vivais au Québec à cette époque, et je me souviens de la froide colère de Roméo Dallaire quand il parlait, en interview, des responsabilités de l'Occident dans ce massacre, tout en déplorant son impuissance à agir en tant que commandant de la MINUAR. Passionnant aussi le questionnement de l'autrice à propos des photos que les reporters prennent des victimes. Elle s'interroge sur leur droit à l'image, sur la violence de cette représentation, sur la conservation des ces témoignages visuels et sur la manière souvent désinvolte dont ils sont utilisés, classés, perdus, diffusés, etc. Comme souvent ceux qui écrivent sur leur propre passé, l'autrice s'interroge encore sur les pièges de la mémoire, la manière dont on transforme ses propres souvenirs, la méfiance qu'elle éprouve envers les interprétations a posteriori, celles des autres, bien sûr, mais, avec un grand souci de vérité, les siennes propres. Un document intéressant et nécessaire, à mon avis, parfois confus et souffrant de quelques redites.
Convoi humanitaire.
Beata Umubyeyi Mairesse a été sauvée avec sa mère, le 18 juin 1994 soit quelques semaines avant la fin du génocide des Tustsi au Rwanda, par un convoi humanitaire suisse.
Cette enquête commence simplement, des proches de Beata Umubeyi Mairesse les auraient vues, elle et sa mère, traverser la frontière entre le Rwanda et le Burundi sur la BBC. L'auteure va ainsi entrer en contact avec l'équipe de la BBC présente ce jour-là, treize ans après les faits. La quête de ces rushes va la pousser à mener l'enquête sur le convoi humanitaire suisse qui les a sauvées toutes les deux.
La première partie se concentre sur les premiers pas de Beata Umubeyi Mairesse dans son enquête. Elle fait également une réflexion intéressante sur le devoir de mémoire. Ainsi elle estime que témoigner peut permettre d'éveiller une conscience citoyenne chez les enfants, et les pousser à se questionner si une population particulière devait devenir bouc émissaire. Cela permettrait, peut-être, en cas de nouveau génocide, que des individus agissent contre.
La deuxième partie est le témoignage de Beata Umubeyi Mairesse durant le génocide en 1994. Ce témoignage est très instructif. le lecteur ressent la peur au ventre de celle qui témoigne, les journées d'angoisse dans leurs différentes caches. Ces jours sont l'expression de la folie d'une partie de la population rwandaise. La majeure partie des Hutus considèrent normal d'exterminer les Tutsis. Ils parlent même de « travail ».
Les troisième et quatrième parties sont malheureusement en deçà. L'auteur mélange son enquête sur les organisateurs du convoi, avec les témoignages d'enfants en ayant bénéficié. Elle ajoute également sa recherche d'autres photos et le témoignage de journalistes ayant couvert le génocide. L'ensemble devient très confus. Enfin, elle conclut son enquête en questionnant le rôle des témoins et des victimes. Les occidentaux ont imposé leur propre vision du génocide, quand les victimes n'avait pas le droit à la parole.
Bref, un témoignage instructif même si la forme est parfois brouillonne.
Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices ELLE 2024.
Beata Umubyeyi Mairesse a été sauvée avec sa mère, le 18 juin 1994 soit quelques semaines avant la fin du génocide des Tustsi au Rwanda, par un convoi humanitaire suisse.
Cette enquête commence simplement, des proches de Beata Umubeyi Mairesse les auraient vues, elle et sa mère, traverser la frontière entre le Rwanda et le Burundi sur la BBC. L'auteure va ainsi entrer en contact avec l'équipe de la BBC présente ce jour-là, treize ans après les faits. La quête de ces rushes va la pousser à mener l'enquête sur le convoi humanitaire suisse qui les a sauvées toutes les deux.
La première partie se concentre sur les premiers pas de Beata Umubeyi Mairesse dans son enquête. Elle fait également une réflexion intéressante sur le devoir de mémoire. Ainsi elle estime que témoigner peut permettre d'éveiller une conscience citoyenne chez les enfants, et les pousser à se questionner si une population particulière devait devenir bouc émissaire. Cela permettrait, peut-être, en cas de nouveau génocide, que des individus agissent contre.
La deuxième partie est le témoignage de Beata Umubeyi Mairesse durant le génocide en 1994. Ce témoignage est très instructif. le lecteur ressent la peur au ventre de celle qui témoigne, les journées d'angoisse dans leurs différentes caches. Ces jours sont l'expression de la folie d'une partie de la population rwandaise. La majeure partie des Hutus considèrent normal d'exterminer les Tutsis. Ils parlent même de « travail ».
Les troisième et quatrième parties sont malheureusement en deçà. L'auteur mélange son enquête sur les organisateurs du convoi, avec les témoignages d'enfants en ayant bénéficié. Elle ajoute également sa recherche d'autres photos et le témoignage de journalistes ayant couvert le génocide. L'ensemble devient très confus. Enfin, elle conclut son enquête en questionnant le rôle des témoins et des victimes. Les occidentaux ont imposé leur propre vision du génocide, quand les victimes n'avait pas le droit à la parole.
Bref, un témoignage instructif même si la forme est parfois brouillonne.
Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices ELLE 2024.
Cet essai m'a appris bien des choses sur le génocide rwandais vu, de l'intérieur, par une jeune fille tutsi qui a été miraculeusement épargnée. Les explications qu'elle nous donne sur son pays nous permettent de mettre à distance l'image que les médias européens, et spécialement français, ont véhiculée des événements.
La voix de l'autrice est singulière et attachante. Elle se pose beaucoup de questions, sa démarche est traversée par le doute, ce qui nous incite à nous questionner à notre tour dans une lecture active et critique.
J'ai aimé aussi que sa démarche ne soit pas autocentrée, qu'elle cherche à retrouver les enfants de son convoi pour leur rendre les images qui les représentaient lors de l'évacuation vers le Burundi qui leur a sauvé la vie. Elle leur offre ses recherches, ses efforts. Sa parole devient collective et résonne bien plus fort.
Et puis sa quête est émouvante. On la suit dans ce parcours frustrant pour rechercher les « images manquantes » du convoi de réfugiés dont elle et sa mère faisaient partie, comme si elle cherchait à valider ses souvenirs, à se réapproprier quelque chose qui lui a été confisqué. En effet, on comprend que les récits de ceux qui ont assisté au massacre ou qui ont tenté de l'expliquer dans les médias, que les photos qui ont été prises, sont le fait d'occidentaux qui ont oublié les victimes en chemin, notamment les victimes tutsis. Retrouver ces images participe donc de leur reconstruction. Il y a un enjeu ontologique fort dans cette quête et elle ne peut se faire sans émotions. Son aspect bouleversant nous rend l'expérience encore plus sensible.
La réflexion est donc très riche, explorant de nombreux thèmes plus larges que le seul génocide rwandais. Comment témoigner ? Qui est légitime pour le faire ? A quoi sert le témoignage ? Quelle est la valeur des traces ? Comment transmettre une mémoire collective ? Ce livre devrait être inscrit au programme de toutes les écoles de journalisme !
Cependant, j'émettrais une petite réserve qui réside dans l'aspect laborieux du récit, parfois trop détaillé ou redondant dans la dernière partie. Si l'on comprend l'entêtement de l'autrice à traquer la vérité, on peut aussi le trouver un peu mince comme fil rouge narratif. Notre curiosité se fatigue à attendre une révélation qui ne vient pas, des images qui ne seront jamais retrouvées. Cela nourrit la réflexion mais dessert un peu le dynamisme de la lecture.
Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices Elle 2024
La voix de l'autrice est singulière et attachante. Elle se pose beaucoup de questions, sa démarche est traversée par le doute, ce qui nous incite à nous questionner à notre tour dans une lecture active et critique.
J'ai aimé aussi que sa démarche ne soit pas autocentrée, qu'elle cherche à retrouver les enfants de son convoi pour leur rendre les images qui les représentaient lors de l'évacuation vers le Burundi qui leur a sauvé la vie. Elle leur offre ses recherches, ses efforts. Sa parole devient collective et résonne bien plus fort.
Et puis sa quête est émouvante. On la suit dans ce parcours frustrant pour rechercher les « images manquantes » du convoi de réfugiés dont elle et sa mère faisaient partie, comme si elle cherchait à valider ses souvenirs, à se réapproprier quelque chose qui lui a été confisqué. En effet, on comprend que les récits de ceux qui ont assisté au massacre ou qui ont tenté de l'expliquer dans les médias, que les photos qui ont été prises, sont le fait d'occidentaux qui ont oublié les victimes en chemin, notamment les victimes tutsis. Retrouver ces images participe donc de leur reconstruction. Il y a un enjeu ontologique fort dans cette quête et elle ne peut se faire sans émotions. Son aspect bouleversant nous rend l'expérience encore plus sensible.
La réflexion est donc très riche, explorant de nombreux thèmes plus larges que le seul génocide rwandais. Comment témoigner ? Qui est légitime pour le faire ? A quoi sert le témoignage ? Quelle est la valeur des traces ? Comment transmettre une mémoire collective ? Ce livre devrait être inscrit au programme de toutes les écoles de journalisme !
Cependant, j'émettrais une petite réserve qui réside dans l'aspect laborieux du récit, parfois trop détaillé ou redondant dans la dernière partie. Si l'on comprend l'entêtement de l'autrice à traquer la vérité, on peut aussi le trouver un peu mince comme fil rouge narratif. Notre curiosité se fatigue à attendre une révélation qui ne vient pas, des images qui ne seront jamais retrouvées. Cela nourrit la réflexion mais dessert un peu le dynamisme de la lecture.
Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices Elle 2024
Beata a 15 ans en juin 1994 quand elle fuit le Rwanda avec sa mère, grâce à un convoi de Terre des Hommes, une organisation humanitaire suisse. Rescapée du génocide Tutsi, elle témoigne. Mais plus qu'un témoignage, le convoi est avant tout un plaidoyer pour que soit respectée la parole des rescapés et des victimes, qu'on ne leur vole pas leur histoire en profitant de leur silence et de leur manque de ressources pour réagir. Il aura fallu 30 ans à Beata pour arriver à enfin se libérer et oser témoigner, en son nom propre, autrement qu'en faisant intervenir des personnages de fiction. Il ne s'agit pas de fiction ici, mais d'un retour en arrière motivé par la recherche d'une photo d'elle et de sa maman, quand elles ont réussi à passer la frontière avec le Burundi, après des semaines à se cacher pour échapper aux génocidaires. J'ai beaucoup aimé cette lecture, pour laquelle je remercie Babelio et les Editions Flammarion. Comme bien d'autres, à l'époque du génocide et bien après, j'ai été maintenue dans l'ignorance de ce qui s'était passé au Rwanda. Qui étaient les « méchants », finalement, dans cette région où les massacreurs, les machetteurs assoiffés de sang, se transformaient quelques semaines après en pauvres réfugiés sur le chemin de l'exil ? le récit de ce qu'ont vécu Beata (et les Tutsi dont elle parle dans son récit) est nécessaire pour le devoir de mémoire, et très instructif. Mais sa réflexion sur le rôle des journalistes et reporters dans la couverture de tels conflits est extrêmement intéressante.
1994, j'ai 6 ans. A la maison, le moment du journal télévisé est sacré. On le regarde en famille. J'entends les mots Rwanda, machettes, massacre, personne ne se soucie vraiment de savoir ce que je comprends. Pourtant, je capte une image, qui me hante encore 30 ans plus tard. Un homme brandit un collier de doigts.
Alors quand j'ai reçu ce texte, c'est cette image qui est revenue. Encore une fois.
Mais qu'ai-je vu ? le récit en images fait par des journalistes occidentaux qui posent un certain regard sur l'Afrique. Avec un grand A, continent indissociable où il est bien connu que la violence est partout. On ne dit pas que c'est un génocide. On ne dit pas que ce sont les Tutsi sont massacrés... Pourtant... "Nous ne sommes pas les derniers".
Beata Umubyeyi Mairesse est une survivante. Elle fait entendre sa voix, celle d'une jeune fille métisse de 15 ans qui se cachera dans un convoi réservé aux enfants de moins de 12 ans pour quitter le Rwanda et rejoindre, avec sa mère, le Burundi voisin. Opération dangereuse qui réussira. Elle fait partie de ces rescapés qui ont pu se construire une vie. Sans oublier pour autant. Et en étant surpris d'être à ce point depossédés de leur histoire.
C'est en ça que le convoi n'est pas un témoignage comme les autres. Au-delà de la quête de l'autrice qui a en sa possession 4 photos du convoi du 18 juin, et qui veut comprendre ce qui s'est joué ce jour-là (et trouver une preuve de sa présence), il y a l'analyse. Pourquoi est-il si difficile pour les rescapés d'accéder à leurs propres images ? Pourquoi la voix qui porte le plus est celle des humanitaires, des reporters, des sauveurs... et pas celle des victimes ? Quels sont les liens qui se tissent entre survivants et porteurs de la mémoire des génocides du XXe siècle ?
Sortir d'une lecture en se sentant grandi ce n'est pas si souvent. C'est le cas ici, cette sensation d'avoir pris de la hauteur. le sujet me faisait peur, la peur de la gosse de 6 ans face au monstre. Mais un monstre avec la distance de l'écran. Elle est bien ridicule cette peur face au témoignage de l'autrice qui décrit si bien cette émotion qui vrille le bide. Et l'instinct de survie.
Celui qui lui fera trouver une stratégie face aux tueurs quand tout semblait perdu. Je sais que de cette lecture, il me restera aussi beaucoup de questionnements. Sur ce qu'une image nous dit, qu'un message peut être intégralement modifié par une légende et que du Rwanda, finalement, on ne nous aura pas réellement donné les clés de compréhension. Mais il y a des autrices comme Beata Umubyeyi Mairesse. Et que le convoi ne fait qu'ouvrir le chemin.
Alors quand j'ai reçu ce texte, c'est cette image qui est revenue. Encore une fois.
Mais qu'ai-je vu ? le récit en images fait par des journalistes occidentaux qui posent un certain regard sur l'Afrique. Avec un grand A, continent indissociable où il est bien connu que la violence est partout. On ne dit pas que c'est un génocide. On ne dit pas que ce sont les Tutsi sont massacrés... Pourtant... "Nous ne sommes pas les derniers".
Beata Umubyeyi Mairesse est une survivante. Elle fait entendre sa voix, celle d'une jeune fille métisse de 15 ans qui se cachera dans un convoi réservé aux enfants de moins de 12 ans pour quitter le Rwanda et rejoindre, avec sa mère, le Burundi voisin. Opération dangereuse qui réussira. Elle fait partie de ces rescapés qui ont pu se construire une vie. Sans oublier pour autant. Et en étant surpris d'être à ce point depossédés de leur histoire.
C'est en ça que le convoi n'est pas un témoignage comme les autres. Au-delà de la quête de l'autrice qui a en sa possession 4 photos du convoi du 18 juin, et qui veut comprendre ce qui s'est joué ce jour-là (et trouver une preuve de sa présence), il y a l'analyse. Pourquoi est-il si difficile pour les rescapés d'accéder à leurs propres images ? Pourquoi la voix qui porte le plus est celle des humanitaires, des reporters, des sauveurs... et pas celle des victimes ? Quels sont les liens qui se tissent entre survivants et porteurs de la mémoire des génocides du XXe siècle ?
Sortir d'une lecture en se sentant grandi ce n'est pas si souvent. C'est le cas ici, cette sensation d'avoir pris de la hauteur. le sujet me faisait peur, la peur de la gosse de 6 ans face au monstre. Mais un monstre avec la distance de l'écran. Elle est bien ridicule cette peur face au témoignage de l'autrice qui décrit si bien cette émotion qui vrille le bide. Et l'instinct de survie.
Celui qui lui fera trouver une stratégie face aux tueurs quand tout semblait perdu. Je sais que de cette lecture, il me restera aussi beaucoup de questionnements. Sur ce qu'une image nous dit, qu'un message peut être intégralement modifié par une légende et que du Rwanda, finalement, on ne nous aura pas réellement donné les clés de compréhension. Mais il y a des autrices comme Beata Umubyeyi Mairesse. Et que le convoi ne fait qu'ouvrir le chemin.
Hasard des lectures et des rencontres.
Je viens de finir le très réussi roman de Gaëlle Nohant, "le bureau d'éclaircissements des destins" qui parle des camps et du retour des survivants et du devoir de mémoire.
Puis j'ai assisté à une rencontre sur une exposition "La vie sociale et politique des papiers d'identification en Afrique" et une conversation littéraire & scientifique à la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda avec Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine franco-rwandaise.
Je viens de lire son livre "le convoi". Elle raconte et explique de façon sincère, sensible, détaillée, sa recherche et son enquête pour trouver des traces (photos), des noms des enfants qui ont fait partie des convois humanitaires qui ont sauvé des enfants lors du génocide rwandais.
Elle avait 15 ans lors de cette fuite et a des souvenirs. Elle a retrouvé quelques photos, tirées de reportages de journalistes et elle a mené une réelle enquête pour retrouver des membres de l'association "Terre des hommes" qui ont participé à ces convois mais aussi des enfants rescapés. Elle parle très bien de ses recherches, de ses doutes, des difficultés qu'elle a rencontré pour retrouver des archives, des témoignages.
Ecrivaine, elle a écrit des romans et de la poésie mais pour ce texte et cette enquête, elle a senti qu'il fallait qu'elle fasse un texte plus personnel et ne pas passer par le romanesque.
Elle décrit ce qui s'est passé lors de ces évacuations, à travers ses propres souvenirs, les souvenirs recueillis, des reportages, des archives..
Avec une belle écriture, ce texte est un beau témoignage et le titre, qui pourrait faire penser aux convois nazis a ici une consonnance plus positive, il s'agit de convois vers la vie et non vers la mort. Elle parle d'ailleurs très bien des témoignages des survivants et des rencontres qu'elle a pu faire lors de rencontres dans des lycées, avec des survivants de la Shoah et des similitudes dans la difficulté d'en parler et d'utiliser les archives. Ce qui fait donc écho avec la lecture du texte de Gaelle Nohant, sur l'International Tracing Service est le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies.
Des textes qui permettent de tenter d'appréhender ses époques et la façon dont il est nécessaire de s'en souvenir et de ne pas oublier.
Je viens de finir le très réussi roman de Gaëlle Nohant, "le bureau d'éclaircissements des destins" qui parle des camps et du retour des survivants et du devoir de mémoire.
Puis j'ai assisté à une rencontre sur une exposition "La vie sociale et politique des papiers d'identification en Afrique" et une conversation littéraire & scientifique à la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda avec Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine franco-rwandaise.
Je viens de lire son livre "le convoi". Elle raconte et explique de façon sincère, sensible, détaillée, sa recherche et son enquête pour trouver des traces (photos), des noms des enfants qui ont fait partie des convois humanitaires qui ont sauvé des enfants lors du génocide rwandais.
Elle avait 15 ans lors de cette fuite et a des souvenirs. Elle a retrouvé quelques photos, tirées de reportages de journalistes et elle a mené une réelle enquête pour retrouver des membres de l'association "Terre des hommes" qui ont participé à ces convois mais aussi des enfants rescapés. Elle parle très bien de ses recherches, de ses doutes, des difficultés qu'elle a rencontré pour retrouver des archives, des témoignages.
Ecrivaine, elle a écrit des romans et de la poésie mais pour ce texte et cette enquête, elle a senti qu'il fallait qu'elle fasse un texte plus personnel et ne pas passer par le romanesque.
Elle décrit ce qui s'est passé lors de ces évacuations, à travers ses propres souvenirs, les souvenirs recueillis, des reportages, des archives..
Avec une belle écriture, ce texte est un beau témoignage et le titre, qui pourrait faire penser aux convois nazis a ici une consonnance plus positive, il s'agit de convois vers la vie et non vers la mort. Elle parle d'ailleurs très bien des témoignages des survivants et des rencontres qu'elle a pu faire lors de rencontres dans des lycées, avec des survivants de la Shoah et des similitudes dans la difficulté d'en parler et d'utiliser les archives. Ce qui fait donc écho avec la lecture du texte de Gaelle Nohant, sur l'International Tracing Service est le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies.
Des textes qui permettent de tenter d'appréhender ses époques et la façon dont il est nécessaire de s'en souvenir et de ne pas oublier.
Le convoi du 18 juin 1994.
Longtemps, Beata Umubyeyi Mairesse s'en souviendra. Cachée dans un convoi de l'organisation Terre des Hommes qui l'emmènera avec sa mère, de Butare à la frontière du Burundi. Ce convoi était interdit aux enfants de moins de 12 ans, elles feront donc le voyage cachées tout au fond à même le sol, des enfants assis sur leurs corps, fébriles et silencieuses.
Après plusieurs écrits, l'auteure, hésitante, s'est lancée pour raconter son histoire, et celui de beaucoup d'autres. Un questionnement long d'une quinzaine d'années. Après avoir été dans plusieurs collèges et lycées parler de son vécu, elle s'interroge néanmoins sur la portée de témoigner sans trahir les siens. Une peur que ses mots ou ressentis soient mal interprétés. Lors de ses recherches, ce sont des photos prises par des journalistes qui lui sont présentées. Des photos prises par des étrangers finalement, qui pour elle, ont une importance capitale mais elle s'aperçoit très vite que pour ses compatriotes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quelle dimension leur donner ? Quelle interprétation en faire ?
le convoi, terme longtemps évoqué pour les heures sombres de la seconde guerre mondiale et la déportation, qui revêt aujourd'hui une onde positive. Une brèche vers la lumière et la liberté.
Longtemps, Beata Umubyeyi Mairesse s'en souviendra. Cachée dans un convoi de l'organisation Terre des Hommes qui l'emmènera avec sa mère, de Butare à la frontière du Burundi. Ce convoi était interdit aux enfants de moins de 12 ans, elles feront donc le voyage cachées tout au fond à même le sol, des enfants assis sur leurs corps, fébriles et silencieuses.
Après plusieurs écrits, l'auteure, hésitante, s'est lancée pour raconter son histoire, et celui de beaucoup d'autres. Un questionnement long d'une quinzaine d'années. Après avoir été dans plusieurs collèges et lycées parler de son vécu, elle s'interroge néanmoins sur la portée de témoigner sans trahir les siens. Une peur que ses mots ou ressentis soient mal interprétés. Lors de ses recherches, ce sont des photos prises par des journalistes qui lui sont présentées. Des photos prises par des étrangers finalement, qui pour elle, ont une importance capitale mais elle s'aperçoit très vite que pour ses compatriotes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quelle dimension leur donner ? Quelle interprétation en faire ?
le convoi, terme longtemps évoqué pour les heures sombres de la seconde guerre mondiale et la déportation, qui revêt aujourd'hui une onde positive. Une brèche vers la lumière et la liberté.
Le Convoi
Beata Umubyeyi Mairesse
Ceci n'est ni un récit, ni un roman, ni un document historique, ni un essai, ni peut-être même pas un livre. Peut-être une sorte de témoignage en lumière qui naît du plus profond de l'obscurité d'un tunnel morbide pour très lentement se rapprocher d'une lumière d'abord floue, puis peu à peu devenir un peu plus nette, et finir par éclater au grand jour. Un livre, bien sûr, si on veut bien, mais beaucoup plus que cela.
L'autrice, Beata, est une rescapée, comment peut-on seulement définir ce mot, une survivante improbable d'un massacre, là encore quels mots se cachent derrière cette expression, celui d'un génocide, cela devient plus net et plus explicite, celui de la communauté Tutsi au Rwanda par l'autre ethnie, celle des Hutus. Nous sommes en 1994. Pour ma part j'avais 38 ans, et comme tous les Blancs qui suivaient l'actualité géopolitique de cette époque, je n'ai pas oublié le massacre incompréhensible d'une communauté par une autre, du même pays, de la même culture, de la même religion, de la même ethnie, formation, éducation, scolarité.
Beata a 15 ans à l'époque. A la fois très mature et encore enfant. Son récit, magistralement organisé (j'allais dire malencontreusement « découpé » ! ) nous raconte sa fuite vers le Burundi avec l'aide d'une ONG suisse, Terre des hommes. Elle n'y a pourtant pas droit. Elle a 15 ans, et le sauvetage de ces convois d'enfants n'a été âprement négocié que pour des enfants de12 ans maximum, entre Terre des Hommes et le gouvernement Hutu de l'époque. Mais Beata est blanche, franco-rwandaise, parle couramment le Français, elle va parvenir à se cacher sous les couvertures, au fond du camion qui emmène ces enfants, avec sa maman, et parvenir à se faire exfiltrer au Burundi. Rien que ce récit au titre ravageur, qui nous rappelle d'autres temps sombres pas si anciens, est mortifère, générant une émotion et une angoisse sans nom. Mais Beata, ne pourra pas dans sa vie d'adulte se satisfaire du seul miracle de son évasion, elle a vu , elle a entendu, elle a compris ce qui se jouait, les exactions sur les Tutsis, les meurtres à la machette, au couteau, au gourdin. Les 250 000 femmes tutsis qui ont été violées pendant le génocide, l'ont souvent été délibérément par des hommes que l'on savait séropositifs ! Ces images atroces qui se sont imprimées, collées, additionnées dans sa mémoire, elle ne peut pas mettre le couvercle de l'oubli par-dessus.
Tout son récit va se croiser avec une enquête minutieuse qu'elle va entreprendre une fois adulte, on appelle ça un devoir de mémoire, je dirais une obligation de mémoire. A partir de 4 photos de son Convoi, vagues, floues, recueillies grâce à la BBC, Beata va avec une minutie et une patience sans relâche, reconstituer en convoquant le passé, par des témoignages, par des recherches dans les archives de la BBC, de Terre des Hommes, de la presse, de la Croix Rouge, et retrouver, identifier, nommer, ne pas laisser l'oubli s'installer. Entremêlant naturellement les deux récits, mais aussi en peignant les portraits des protagonistes, journalistes, photographes, simples témoins, archivistes, elle va relier, bout à bout, les minuscules pièces d'un puzzle fait d'horreurs, d'histoire mais aussi de vérité et d'humanité. C'est un livre qui, par moments, m'a fait penser au très beau récit « la Carte Postale » d'Anne Berest, cette volonté farouche d'écrire, de reconstituer un lien pour que l'oubli n'efface rien de ce que l'âme humaine peut faire de pire. Mais aussi de beau de désintéressé voire d'exaltant, donner du sens . Un livre où rôde l'esprit de Saint Ex, celui de Terre des Hommes, celui aussi du journaliste français Patrick de Saint Exupéry dont elle parle peu mais qui fut le Grand témoin français à mettre à jour ce qui se jouait au Rwanda.
L'enquête, terriblement complexe, est menée avec humanité, douceur parfois, pour surtout ni ne rien oublier, ni commettre un impair en n'ayant pas la preuve sur chaque pièce quelle avance. D'abord la Vérité. Beata cite beaucoup, nomme beaucoup les journalistes britanniques dont certains resteront à jamais traumatisés par ce qu'ils ont vu, les photographes ( il y a dans ce livre une admirable réflexion sur le pouvoir des instants figés par le temps de la photo, des caméramen, des preneurs de sons, des journalistes dont certains ont pris des risques insensés pour que tout soit vu et dit, du fondateur de Terre des Hommes Alexis Briquet organisateur du Convoi qu'elle va retrouver à la fin de sa vie, tant d'années après et avec lequel elle partage une affection infinie. Elle tisse une gigantesque toile d'araignée humaine qui va relier les photos d'enfants devenus adultes qui vont se reconnaître, après qu'elle les ait contactés, sur ces photos anciennes. Beata n'a pas besoin d'asséner des jugements ou des commentaires, c'est ce qui fait la force de son récit, les faits parlent d'eux-mêmes. Ces faits qui nous font honte à nous blancs. Que faisions nous, pour les plus anciens, en 1994, pour ma part que faisais je si ce n'est regarder incrédule, sans comprendre qu'un génocide (100 000 morts en 100j) se déroulait sous nos yeux, avec l'assentiment tacite du gouvernement Français, que l'autrice a l'incroyable pudeur de ne ni nommer ,ni accabler, accuser, attaquer. Parfois ne pas exposer donne encore plus de force au propos.
Mais nous avions l'habitude sans doute de voir défiler sur nos postes, d'horribles images venues d'Afrique Noire, nous avions eu le Biafra, nous avions eu Mandela et l'Afrique du Sud, sans doute, avons-nous eu nos bons et nos mauvais pauvres, nos bons et nos mauvais sans papiers, nous avions nos bons et nos mauvais génocides, blancs de préférence. On avait déjà eu tant de mal à se sortir du guêpier Algérien, pour ne pas en plus aller se fourrer dans celui d'un pays dont nous peinions à prononcer le nom. Nous avions en quelque sorte eu nos génocides à nous. Nous avions eu la Shoah, nous avions eu le massacre des Arméniens, nous avons aujourd'hui le film horrible de ce qui se déroule en Palestine, alors le Rwanda… Qui savait d‘ailleurs où situer ce petit pays sur la carte d'Afrique, vous imaginez ? des gens qui se tuaient à coups de machette ? La désinformation faisait son travail, le gouvernement de Paris soutenait le pouvoir en place. Alors, nous regardions distraitement avec un zeste d'empathie un massacre supplémentaire du plus grand prédateur de l'espèce humaine, l'Homme lui-même.
Impossible de dire que ce livre est beau. Les adjectifs de valeur n'ont ici guère de signification. Ce livre nous renvoit à notre condition d'homme blanc et nous fait gicler comme une gifle la honte au visage. D'une immense dignité, il nous fait comprendre la dette terrible que nous avons, envers le Rwanda bien sûr, où la colonisation porte une écrasante responsabilité en ayant pour d'obscures raisons économiques, dressé à mort l'une contre l'autre deux communautés qui avaient jusqu'alors réussi à cohabiter paisiblement, mais aussi et surtout avec l'Afrique dans son ensemble, dette que nous ne cessons d'abonder avec une impudence sans limites, que nous serons incapables de rembourser un jour. Tout au plus pourrons-nous, peut-être, nous agenouiller devant un mémorial et demander pardon à ces frères humains. Parce qu'au fond, nous n'avons encore rien compris aujourd'hui , tiré aucune leçon, certes nous ne tuons pas frontalement, mais Total continue de défoncer la terre en Ouganda pour y rechercher l'or noir et faire carburer les voitures des blancs, 40 % des femmes africaines meurent du cancer du Col de l'utérus , deuxième rang en termes d'incidence et de mortalité, parce que les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas mettre des vaccins à des prix abordables, et un jeune premier ministre français de 34 ans ne trouve comme solution à la désertification médicale en France que de proposer d'aller piller les médecins africains pour les faire venir dans nos campagnes.
Une dette avez-vous dit ?
Ce livre, sobre dans son écriture, pudique, nous émeut, que ce soit par le récit d'évasion de Beata de sa mère et de centaines d'enfants par des humanitaires qui ont donné leur vie en lui donnant un sens, mais conduit une intelligente et intuitive réflexion qui va bien au-delà des massacres, en nous demandant de nous observer sans fard dans le miroir de nos existences humaines. La réflexion sur le regard du photographe, qui rend le témoignage ineffaçable, est imparable « « le fait d'être photographié nous permettait d'avoir un regard sur ce que nous vivions, et nous pouvions confusément espérer, que ce regard nous sauverait ». Même si la photographie ultime, qui devrait clore l'enquête, n'a pas été encore retrouvée, peu importe, nous savons qu'elle existe, qu'elle est quelque part dans une archive, dans un carton, et que si la retrouver est intensément important pour l'auteur, pour nous lecteurs, nous avons compris ce que nous devons à Beata.
En refermant le livre, j'ai repensé au dernier livre de Cynthia Fleury : « la Clinique de la Dignité ». C'est exactement cela.
Merci Madame.
Beata Umubyeyi Mairesse
Ceci n'est ni un récit, ni un roman, ni un document historique, ni un essai, ni peut-être même pas un livre. Peut-être une sorte de témoignage en lumière qui naît du plus profond de l'obscurité d'un tunnel morbide pour très lentement se rapprocher d'une lumière d'abord floue, puis peu à peu devenir un peu plus nette, et finir par éclater au grand jour. Un livre, bien sûr, si on veut bien, mais beaucoup plus que cela.
L'autrice, Beata, est une rescapée, comment peut-on seulement définir ce mot, une survivante improbable d'un massacre, là encore quels mots se cachent derrière cette expression, celui d'un génocide, cela devient plus net et plus explicite, celui de la communauté Tutsi au Rwanda par l'autre ethnie, celle des Hutus. Nous sommes en 1994. Pour ma part j'avais 38 ans, et comme tous les Blancs qui suivaient l'actualité géopolitique de cette époque, je n'ai pas oublié le massacre incompréhensible d'une communauté par une autre, du même pays, de la même culture, de la même religion, de la même ethnie, formation, éducation, scolarité.
Beata a 15 ans à l'époque. A la fois très mature et encore enfant. Son récit, magistralement organisé (j'allais dire malencontreusement « découpé » ! ) nous raconte sa fuite vers le Burundi avec l'aide d'une ONG suisse, Terre des hommes. Elle n'y a pourtant pas droit. Elle a 15 ans, et le sauvetage de ces convois d'enfants n'a été âprement négocié que pour des enfants de12 ans maximum, entre Terre des Hommes et le gouvernement Hutu de l'époque. Mais Beata est blanche, franco-rwandaise, parle couramment le Français, elle va parvenir à se cacher sous les couvertures, au fond du camion qui emmène ces enfants, avec sa maman, et parvenir à se faire exfiltrer au Burundi. Rien que ce récit au titre ravageur, qui nous rappelle d'autres temps sombres pas si anciens, est mortifère, générant une émotion et une angoisse sans nom. Mais Beata, ne pourra pas dans sa vie d'adulte se satisfaire du seul miracle de son évasion, elle a vu , elle a entendu, elle a compris ce qui se jouait, les exactions sur les Tutsis, les meurtres à la machette, au couteau, au gourdin. Les 250 000 femmes tutsis qui ont été violées pendant le génocide, l'ont souvent été délibérément par des hommes que l'on savait séropositifs ! Ces images atroces qui se sont imprimées, collées, additionnées dans sa mémoire, elle ne peut pas mettre le couvercle de l'oubli par-dessus.
Tout son récit va se croiser avec une enquête minutieuse qu'elle va entreprendre une fois adulte, on appelle ça un devoir de mémoire, je dirais une obligation de mémoire. A partir de 4 photos de son Convoi, vagues, floues, recueillies grâce à la BBC, Beata va avec une minutie et une patience sans relâche, reconstituer en convoquant le passé, par des témoignages, par des recherches dans les archives de la BBC, de Terre des Hommes, de la presse, de la Croix Rouge, et retrouver, identifier, nommer, ne pas laisser l'oubli s'installer. Entremêlant naturellement les deux récits, mais aussi en peignant les portraits des protagonistes, journalistes, photographes, simples témoins, archivistes, elle va relier, bout à bout, les minuscules pièces d'un puzzle fait d'horreurs, d'histoire mais aussi de vérité et d'humanité. C'est un livre qui, par moments, m'a fait penser au très beau récit « la Carte Postale » d'Anne Berest, cette volonté farouche d'écrire, de reconstituer un lien pour que l'oubli n'efface rien de ce que l'âme humaine peut faire de pire. Mais aussi de beau de désintéressé voire d'exaltant, donner du sens . Un livre où rôde l'esprit de Saint Ex, celui de Terre des Hommes, celui aussi du journaliste français Patrick de Saint Exupéry dont elle parle peu mais qui fut le Grand témoin français à mettre à jour ce qui se jouait au Rwanda.
L'enquête, terriblement complexe, est menée avec humanité, douceur parfois, pour surtout ni ne rien oublier, ni commettre un impair en n'ayant pas la preuve sur chaque pièce quelle avance. D'abord la Vérité. Beata cite beaucoup, nomme beaucoup les journalistes britanniques dont certains resteront à jamais traumatisés par ce qu'ils ont vu, les photographes ( il y a dans ce livre une admirable réflexion sur le pouvoir des instants figés par le temps de la photo, des caméramen, des preneurs de sons, des journalistes dont certains ont pris des risques insensés pour que tout soit vu et dit, du fondateur de Terre des Hommes Alexis Briquet organisateur du Convoi qu'elle va retrouver à la fin de sa vie, tant d'années après et avec lequel elle partage une affection infinie. Elle tisse une gigantesque toile d'araignée humaine qui va relier les photos d'enfants devenus adultes qui vont se reconnaître, après qu'elle les ait contactés, sur ces photos anciennes. Beata n'a pas besoin d'asséner des jugements ou des commentaires, c'est ce qui fait la force de son récit, les faits parlent d'eux-mêmes. Ces faits qui nous font honte à nous blancs. Que faisions nous, pour les plus anciens, en 1994, pour ma part que faisais je si ce n'est regarder incrédule, sans comprendre qu'un génocide (100 000 morts en 100j) se déroulait sous nos yeux, avec l'assentiment tacite du gouvernement Français, que l'autrice a l'incroyable pudeur de ne ni nommer ,ni accabler, accuser, attaquer. Parfois ne pas exposer donne encore plus de force au propos.
Mais nous avions l'habitude sans doute de voir défiler sur nos postes, d'horribles images venues d'Afrique Noire, nous avions eu le Biafra, nous avions eu Mandela et l'Afrique du Sud, sans doute, avons-nous eu nos bons et nos mauvais pauvres, nos bons et nos mauvais sans papiers, nous avions nos bons et nos mauvais génocides, blancs de préférence. On avait déjà eu tant de mal à se sortir du guêpier Algérien, pour ne pas en plus aller se fourrer dans celui d'un pays dont nous peinions à prononcer le nom. Nous avions en quelque sorte eu nos génocides à nous. Nous avions eu la Shoah, nous avions eu le massacre des Arméniens, nous avons aujourd'hui le film horrible de ce qui se déroule en Palestine, alors le Rwanda… Qui savait d‘ailleurs où situer ce petit pays sur la carte d'Afrique, vous imaginez ? des gens qui se tuaient à coups de machette ? La désinformation faisait son travail, le gouvernement de Paris soutenait le pouvoir en place. Alors, nous regardions distraitement avec un zeste d'empathie un massacre supplémentaire du plus grand prédateur de l'espèce humaine, l'Homme lui-même.
Impossible de dire que ce livre est beau. Les adjectifs de valeur n'ont ici guère de signification. Ce livre nous renvoit à notre condition d'homme blanc et nous fait gicler comme une gifle la honte au visage. D'une immense dignité, il nous fait comprendre la dette terrible que nous avons, envers le Rwanda bien sûr, où la colonisation porte une écrasante responsabilité en ayant pour d'obscures raisons économiques, dressé à mort l'une contre l'autre deux communautés qui avaient jusqu'alors réussi à cohabiter paisiblement, mais aussi et surtout avec l'Afrique dans son ensemble, dette que nous ne cessons d'abonder avec une impudence sans limites, que nous serons incapables de rembourser un jour. Tout au plus pourrons-nous, peut-être, nous agenouiller devant un mémorial et demander pardon à ces frères humains. Parce qu'au fond, nous n'avons encore rien compris aujourd'hui , tiré aucune leçon, certes nous ne tuons pas frontalement, mais Total continue de défoncer la terre en Ouganda pour y rechercher l'or noir et faire carburer les voitures des blancs, 40 % des femmes africaines meurent du cancer du Col de l'utérus , deuxième rang en termes d'incidence et de mortalité, parce que les laboratoires pharmaceutiques ne veulent pas mettre des vaccins à des prix abordables, et un jeune premier ministre français de 34 ans ne trouve comme solution à la désertification médicale en France que de proposer d'aller piller les médecins africains pour les faire venir dans nos campagnes.
Une dette avez-vous dit ?
Ce livre, sobre dans son écriture, pudique, nous émeut, que ce soit par le récit d'évasion de Beata de sa mère et de centaines d'enfants par des humanitaires qui ont donné leur vie en lui donnant un sens, mais conduit une intelligente et intuitive réflexion qui va bien au-delà des massacres, en nous demandant de nous observer sans fard dans le miroir de nos existences humaines. La réflexion sur le regard du photographe, qui rend le témoignage ineffaçable, est imparable « « le fait d'être photographié nous permettait d'avoir un regard sur ce que nous vivions, et nous pouvions confusément espérer, que ce regard nous sauverait ». Même si la photographie ultime, qui devrait clore l'enquête, n'a pas été encore retrouvée, peu importe, nous savons qu'elle existe, qu'elle est quelque part dans une archive, dans un carton, et que si la retrouver est intensément important pour l'auteur, pour nous lecteurs, nous avons compris ce que nous devons à Beata.
En refermant le livre, j'ai repensé au dernier livre de Cynthia Fleury : « la Clinique de la Dignité ». C'est exactement cela.
Merci Madame.
18 juin 1994, Beata et sa mère ont la vie sauve grâce au convoi humanitaire Terre des hommes. Sous les yeux des journalistes de la BBC, alors âgée de 15 ans, Beata fuit le Rwanda et le génocide des Tutsi.
N'ayant utilisé jusqu'à présente que la fiction pour parler du Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse pose maintenant ses mots et son histoire dans un récit poignant dont les faits sont parfois difficiles à lire.
Sous forme d'enquête, l'autrice souhaite avant tout retrouver les enfants qui étaient présents dans le même convoi humanitaire qu'elle et sa mère. En s'appuyant sur les 4 photos d'un journaliste anglais, Beata Umubyeyi Mairesse reconstitue la petite histoire dans la grande.
30 ans après ces milliers de morts, Beata Umubyeyi Mairesse donne une voix aux victimes du génocide du Rwanda. Un texte qui souligne l'importance de la mémoire. Parler pour ne jamais oublier.
« Je sais aujourd'hui que les génocidaires ne m'intéressent pas. Je souhaite consacrer toute mon énergie à l'histoire des victimes, parler de nos peines, des traumatismes dont on ne guérit pas, mais aussi de nos délicates solidarités. »
Je rappelle aussi ce texte bouleversant de Pierre-François Kettler Je suis innocent (Éditions Talents hauts). Grâce une belle documentation, l'auteur donne la parole à un enfant rwandais rescapé du génocide.
« La vie ne tient qu'à un fil. »
http://www.mesecritsdunjour.com/2024/04/le-convoi-beata-umubyeyi-mairesse.html
Lien : http://www.mesecritsdunjour...
N'ayant utilisé jusqu'à présente que la fiction pour parler du Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse pose maintenant ses mots et son histoire dans un récit poignant dont les faits sont parfois difficiles à lire.
Sous forme d'enquête, l'autrice souhaite avant tout retrouver les enfants qui étaient présents dans le même convoi humanitaire qu'elle et sa mère. En s'appuyant sur les 4 photos d'un journaliste anglais, Beata Umubyeyi Mairesse reconstitue la petite histoire dans la grande.
30 ans après ces milliers de morts, Beata Umubyeyi Mairesse donne une voix aux victimes du génocide du Rwanda. Un texte qui souligne l'importance de la mémoire. Parler pour ne jamais oublier.
« Je sais aujourd'hui que les génocidaires ne m'intéressent pas. Je souhaite consacrer toute mon énergie à l'histoire des victimes, parler de nos peines, des traumatismes dont on ne guérit pas, mais aussi de nos délicates solidarités. »
Je rappelle aussi ce texte bouleversant de Pierre-François Kettler Je suis innocent (Éditions Talents hauts). Grâce une belle documentation, l'auteur donne la parole à un enfant rwandais rescapé du génocide.
« La vie ne tient qu'à un fil. »
http://www.mesecritsdunjour.com/2024/04/le-convoi-beata-umubyeyi-mairesse.html
Lien : http://www.mesecritsdunjour...
Un témoignage fort, puissant qui retrace le parcours de Beata pour échapper au genocide au Rwanda.
Beata Umubyeyi Mairesse et sa mère seront sauvé in extremis du génocide des Tutsi au Rwanda le 18 juin 1994...Le convoi humanitaire organisé par l'ONG sera leur échappatoire à un destin tragique.
Plusieurs années après, alors rentrée en France, elle éprouvera le besoin de coucher ses maux sur papier, et de retrouver à l'aide de photos, les enfants comme elle qui ont été sauvé lors du convoi dont elle a fait parti, et des autres convois aussi...
Un travail de recherches, une enquête pour retracer et comprendre l'histoire des enfants des convois, et peut-être retrouver leurs sauveurs.
Une lecture qui m'a beaucoup plu, et qui m'a ouvert les yeux sur le genocide au Rwanda, sujet que je ne connaissais pas tant que cela, mais qui m'a intéressé.
Une écriture fluide, immersive et touchante au côté de cette adolescente et sa mère..
Vous connaissez?
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Beata Umubyeyi Mairesse (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1745 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1745 lecteurs ont répondu