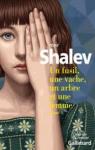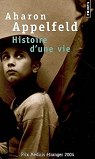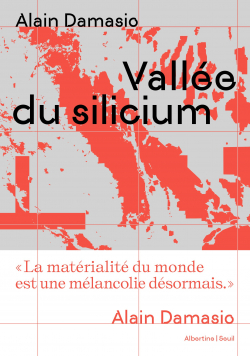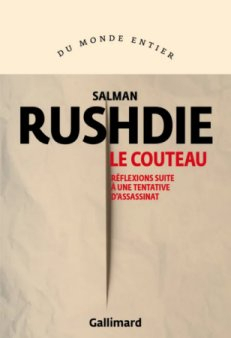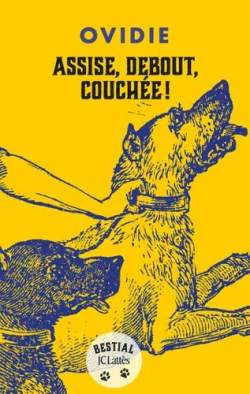Yaël Neeman/5
34 notes
Résumé :
«Le kibboutz n'est pas un village au paysage pastoral, avec ses habitants pittoresques, ses poules et ses arbres de Judée. C'est une oeuvre politique, et rares sont les gens de par le monde qui ont vécu, par choix et de leur libre volonté, une telle expérience, la plus ambitieuse qui fut jamais tentée. Qui pourrait dire non à une tentative de fonder un monde meilleur, un monde d'égalité et de justice ? Nous n'avons pas dit non. Nous avons déserté.» Avec humour, comp... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Nous étions l'avenirVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (7)
Voir plus
Ajouter une critique
En hébreu le mot "kibboutz" signifie "groupe". Et c'est en tant que membre d'un groupe d'enfants que Yaël Neeman a passé ses vingt premières années au sein d'un kibboutz d'obédience marxiste.
Dans son récit elle évoque les souvenirs de cette période marquée par un mode de vie collectiviste issu du rejet des influences idéologiques et spirituelles de la société bourgeoise. On y pratique la séparation entre les adultes et les enfants qui vivent dans des mondes parallèles. Dès leur naissance garçons et filles sont regroupés dans une maison qui est leur domaine. Ils y mangent, dorment, étudient, jouent et travaillent. L'auteure y a vécu "des années baignées d'or" jusqu'à ses douze ans. Mais à l'adolescence tout change brutalement... Il faut quitter le monde de l'enfance pour séjourner six ans d'affilée dans un institut éducatif censé donner aux jeunes "une autonomie complète dans l'organisation démocratique de leur vie immédiate". Période difficile pour la jeune fille. Puis, après le passage obligé par la case Tsahal, retour au kibboutz. Mais pour quel avenir ?
Avec grand souci d'exactitude, Yaël Neeman contextualise habilement cette expérience de vie unique en son genre dans des descriptions précises de la fondation historique du kibboutz Yehi'am, de son organisation, de son environnement et de ses membres. Très différent de Ailleurs peut-être d'Amos Oz par sa forme moins littéraire, cet ouvrage autobiographique donne un aperçu plus réaliste de la vie kibboutzique. Malgré une construction un peu déséquilibrée, trop détaillée par moments et trop anecdotique à d'autres, c'est dans l'ensemble une lecture fort intéressante, entre idéalisme et désillusion. Un texte facile à lire et plutôt plaisant avec comme petits bémols une fâcheuse tendance à la répétition et une fin subite comme une coupure de courant
Dans son récit elle évoque les souvenirs de cette période marquée par un mode de vie collectiviste issu du rejet des influences idéologiques et spirituelles de la société bourgeoise. On y pratique la séparation entre les adultes et les enfants qui vivent dans des mondes parallèles. Dès leur naissance garçons et filles sont regroupés dans une maison qui est leur domaine. Ils y mangent, dorment, étudient, jouent et travaillent. L'auteure y a vécu "des années baignées d'or" jusqu'à ses douze ans. Mais à l'adolescence tout change brutalement... Il faut quitter le monde de l'enfance pour séjourner six ans d'affilée dans un institut éducatif censé donner aux jeunes "une autonomie complète dans l'organisation démocratique de leur vie immédiate". Période difficile pour la jeune fille. Puis, après le passage obligé par la case Tsahal, retour au kibboutz. Mais pour quel avenir ?
Avec grand souci d'exactitude, Yaël Neeman contextualise habilement cette expérience de vie unique en son genre dans des descriptions précises de la fondation historique du kibboutz Yehi'am, de son organisation, de son environnement et de ses membres. Très différent de Ailleurs peut-être d'Amos Oz par sa forme moins littéraire, cet ouvrage autobiographique donne un aperçu plus réaliste de la vie kibboutzique. Malgré une construction un peu déséquilibrée, trop détaillée par moments et trop anecdotique à d'autres, c'est dans l'ensemble une lecture fort intéressante, entre idéalisme et désillusion. Un texte facile à lire et plutôt plaisant avec comme petits bémols une fâcheuse tendance à la répétition et une fin subite comme une coupure de courant
Dans ce récit, l'auteure raconte son enfance et sa jeunesse au kibboutz Yehi'am, au nord d'Isräel, au pied d'une forteresse de croisés. Elle a connu le kibboutz dans les ferveurs du début, lorsqu'une communauté voulait inventer une société nouvelle et un homme nouveau. Créé entre 1946 et 1948, il était surtout constitué de Hongrois ayant échappé à la mort pendant la guerre.
C'est un témoignage passionnant, tant sur le plan historique que personnel. Je crois n'avoir jamais lu aussi précisément sur la vie en interne dans un kibboutz. L'auteure décrit une enfance très heureuse, assez protégée, malgré une organisation qui vue de l'extérieur heurte quelque peu. Les enfants ne vivaient pas avec leurs parents biologiques. le but était de leur éviter la nature bourgeoise de la famille et le poids des désirs de leurs parents. le kibboutz Yehi'am était socialiste, la religion n'y avait pas droit de cité.
Les enfants s'habituaient à vivre entre eux, toujours dans le même groupe mélangeant garçons et filles. Ils ne se confiaient pas aux adultes, réglaient les problèmes à leur manière. Ils voyaient leurs parents une heure cinquante par jour, sans attente particulière.
L'auteure utilise le nous dans son livre, le je n'avait pas cours. Les enfants n'en souffraient pas puisque c'était la seule vie qu'ils connaissaient. Les éducatrices leur inculquait le sens du travail, de l'effort, du collectif, ils participaient jeunes à certaines tâches.
Cette enfance heureuse a commencé à battre de l'aile à l'adolescence, à l'âge où les jeunes allaient dans un institut pour étudier .. ou pas. Ils étaient très libres. le principal était qu'ils continuent à travailler pour le kibboutz pendant les week-end et les vacances.
Le récit est souvent drôle, l'auteure raconte la manière de vivre de ceux qui l'entouraient avec leurs habitudes et leurs difficultés d'adaptation plus ou moins grandes. Les plus anciens ont connu une autre vie. Pour les Hongrois par exemple, c'est difficile de ne plus parler leur langue et d'être contraints d'utiliser uniquement l'hébreu. Les Français, arrivés plus tardivement, seront assez nombreux à repartir.
Néanmoins, c'est plutôt de la tristesse que j'ai ressenti à cette lecture, si l'enfance de l'auteure a été belle, les questionnements qui ont suivi ont été douloureux et n'ont pas préparé les jeunes à l'éventualité d'une vie différente. Il n'y a aucun jugement dans ce récit, simplement l'histoire telle qu'elle a été vécue par l'auteure.
Un témoignage précieux et un rappel bienvenu d'une histoire pas si lointaine.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
C'est un témoignage passionnant, tant sur le plan historique que personnel. Je crois n'avoir jamais lu aussi précisément sur la vie en interne dans un kibboutz. L'auteure décrit une enfance très heureuse, assez protégée, malgré une organisation qui vue de l'extérieur heurte quelque peu. Les enfants ne vivaient pas avec leurs parents biologiques. le but était de leur éviter la nature bourgeoise de la famille et le poids des désirs de leurs parents. le kibboutz Yehi'am était socialiste, la religion n'y avait pas droit de cité.
Les enfants s'habituaient à vivre entre eux, toujours dans le même groupe mélangeant garçons et filles. Ils ne se confiaient pas aux adultes, réglaient les problèmes à leur manière. Ils voyaient leurs parents une heure cinquante par jour, sans attente particulière.
L'auteure utilise le nous dans son livre, le je n'avait pas cours. Les enfants n'en souffraient pas puisque c'était la seule vie qu'ils connaissaient. Les éducatrices leur inculquait le sens du travail, de l'effort, du collectif, ils participaient jeunes à certaines tâches.
Cette enfance heureuse a commencé à battre de l'aile à l'adolescence, à l'âge où les jeunes allaient dans un institut pour étudier .. ou pas. Ils étaient très libres. le principal était qu'ils continuent à travailler pour le kibboutz pendant les week-end et les vacances.
Le récit est souvent drôle, l'auteure raconte la manière de vivre de ceux qui l'entouraient avec leurs habitudes et leurs difficultés d'adaptation plus ou moins grandes. Les plus anciens ont connu une autre vie. Pour les Hongrois par exemple, c'est difficile de ne plus parler leur langue et d'être contraints d'utiliser uniquement l'hébreu. Les Français, arrivés plus tardivement, seront assez nombreux à repartir.
Néanmoins, c'est plutôt de la tristesse que j'ai ressenti à cette lecture, si l'enfance de l'auteure a été belle, les questionnements qui ont suivi ont été douloureux et n'ont pas préparé les jeunes à l'éventualité d'une vie différente. Il n'y a aucun jugement dans ce récit, simplement l'histoire telle qu'elle a été vécue par l'auteure.
Un témoignage précieux et un rappel bienvenu d'une histoire pas si lointaine.
Lien : http://legoutdeslivres.canal..
Ce livre retrace l'enfance et la jeunesse de l'auteur qui a été élevée dans un kibboutz. Sa très belle écriture nous fait partager cette vie communautaire où les enfants vivent dans des maisons d'enfants, avec peu de contacts avec leurs "parents biologiques". L'idéologie et l'utopie communiste du kibboutz montre aussi ses limites à travers ce récit autobiographique, notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants.
C.Meaudre
C.Meaudre
Un témoignage d'une enfant jusqu'à l'âge adulte élevée dans un kibboutz. Cette notion de groupe pas de place pour le "je", un monde totalement à part pas de notion de familles, des contraintes totalement différentes : totalement dédiées au kibboutz, qui nous déconcertent complètement.
Ce n'est pas un roman, pas une biographie, plutôt un témoignage fort bien écrit d'une vie passée dans un kibboutz en Israël jusqu'à l'âge de 20 ans environ . Instructif mais assez distancié de tout affect comme ce qui était demandé au sein de ces résidences communautaires. Étonnant pour moi.
critiques presse (2)
Un passionnant témoignage sur l'Israël des pionniers.
Lire la critique sur le site : Lexpress
Témoignage majeur, Nous étions l'avenir est un vrai livre, un grand livre, de ceux qui font avancer.
Lire la critique sur le site : Telerama
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
À partir de la cinquième, on nous permit d’assister aux séances des adultes attendues par tout le kibboutz. Une fois par semaine, nous nous rassemblions dans la grande salle à manger et nous asseyions en rangs. La projection commençait en retard, tout comme les conférences du soir et le dîner du vendredi soir, en attendant que l’accord se fasse sur l’ouverture et la fermeture des fenêtres. Ces contestations se déroulaient comme un film muet qui se répétait invariablement avant la séance. Au début, ceux qui voulaient que les fenêtres soient fermées se levaient, les fermaient et se rasseyaient, le tout sans un mot. Ensuite ceux qui voulaient que les fenêtres soient ouvertes se levaient, les ouvraient et se rasseyaient. Et ce manège se répétait suivant une séquence connue d’eux seuls.
Personne n’intervenait, ni les enfants, ni les adultes. Nous le savions tous – cela venait de là-bas (la grande majorité des Hongrois, tant ceux des Ouvriers que ceux de Premier Mai, venaient de là-bas, et là-bas, m’avait raconté ma mère un jour où j’étais malade, le Danube gelait en hiver. Et là-bas, nous avait raconté une autre ancienne, on y avait jeté tant de cadavres de Juifs fusillés que le Danube était rouge de sang). L’explication de ce manège d’ouverture et de fermeture des fenêtres nous fut révélée par un des enfants qui composaient notre mille-pattes : ceux qui avaient été emprisonnés dans des camps, ou qui s’étaient dissimulés dans des cachettes où ils avaient failli suffoquer voulaient ouvrir les fenêtres, et ceux qui étaient restés à l’air libre, ou sur lesquels on avait lâché les chiens, voulaient les fermer. Nous attendions. Ceux qui fermaient et ceux qui ouvraient.
Personne n’intervenait, ni les enfants, ni les adultes. Nous le savions tous – cela venait de là-bas (la grande majorité des Hongrois, tant ceux des Ouvriers que ceux de Premier Mai, venaient de là-bas, et là-bas, m’avait raconté ma mère un jour où j’étais malade, le Danube gelait en hiver. Et là-bas, nous avait raconté une autre ancienne, on y avait jeté tant de cadavres de Juifs fusillés que le Danube était rouge de sang). L’explication de ce manège d’ouverture et de fermeture des fenêtres nous fut révélée par un des enfants qui composaient notre mille-pattes : ceux qui avaient été emprisonnés dans des camps, ou qui s’étaient dissimulés dans des cachettes où ils avaient failli suffoquer voulaient ouvrir les fenêtres, et ceux qui étaient restés à l’air libre, ou sur lesquels on avait lâché les chiens, voulaient les fermer. Nous attendions. Ceux qui fermaient et ceux qui ouvraient.
Nous chantions aussi avec conviction le chant des bataillons de Boudienny se lançant au combat : « Ay, Ay, Ay, voici venir les cosaques chargeant l’ennemi. » Nous ne savions pas qu’il s’agissait d’une bande d’émeutiers et de brigands en route vers des carnages. De même, nous ne savions rien de Staline, de Lénine, de Trotski, rien de leurs alliances ni de leurs scissions. Nous n’avions jamais entendu parler du Goulag, ni des millions d’hommes assassinés à cause de leur foi ou de leur loyauté envers l’un ou l’autre. Nous savions leurs noms, comme nous avons su ceux des généraux de Tsahal après 1967. Nous pensions que tous étaient des héros qui avaient vaincu les nazis et nous conduisaient désormais vers un monde meilleur : Uzi Narkis, le héros de la guerre d’Indépendance, Moshe Dayan, Staline et Lénine.
Nous savions que nous croyions en l’esprit humain et aux grands espaces verts. Qui pourrait parler contre l’esprit humain ? Qui pourrait s’opposer aux grands espaces verts ?
Nous savions que nous croyions en l’esprit humain et aux grands espaces verts. Qui pourrait parler contre l’esprit humain ? Qui pourrait s’opposer aux grands espaces verts ?
Notre système n'était pas favorable aux femmes. Les jeunes filles, les célibataires et même les fillettes de cinquième travaillaient dans les maisons d'enfants. On y manquait toujours de main-d'oeuvre. Destinées initialement à libérer les femmes des soins donnés à leurs enfants, en fait elles les y enfermaient, mais avec d'autres enfants. Il existait une égalité dans le travail féminin, mais uniquement entre femmes, entre mères et célibataires, cette égalité ne s'étendait pas aux hommes, sauf quand ils étaient de garde le samedi, toutes les cinq semaines.
En fait, le récit de notre création, celui de la création d’un monde nouveau, n’a jamais existé. C’est peut-être pourquoi nous nous le sommes raconté. Nous n’avions pas de langue écrite, ni même un langage dans lequel traduire notre vie pour les citadins.
Nous pensions que les masses se joindraient à nous. Les noyaux de l’HaChomer Hatzaïr, les volontaires de par-delà les mers, les travailleurs du monde entier. Nous ne savions pas que étions nés en 1960 sur une étoile dont la lumière était morte depuis longtemps et qui sombrait déjà dans la mer. Nous ne savions pas que le mouvement kibboutzique avait été au faîte de sa gloire dans les années 1930, à l’époque des « Murs et tours » et qu’avant même la création de l’État d’Israël en 1947, la population des kibboutzim avait atteint son maximum et représentait 7 % de la population juive vivant en Israël. Ce pourcentage avait déjà chuté en 1948 et n’était plus que de 3,3 % dans les années 1970.
Nous ne savions pas que notre étoile n’éclairait plus qu’elle-même. Nous nous pensions semeurs et bâtisseurs.
Nous sommes nés en 1960 dans le kibboutz Yehi’am, le plus beau kibboutz du monde, avec le vert de ses pins, le mauve de sa couronne de bosquets et le jaune de ses genêts, fondé en 1946 sur une colline, au-dessous d’une forteresse datant des Croisés. Nous sommes nés dans le groupe Narcisse, seize enfants, huit garçons et huit filles, un groupe gracieux, pour la plupart enfants tardifs des Hongrois fondateurs qui avaient bâti le kibboutz avec l’aide d’un noyau israélien.
Nous pensions que les masses se joindraient à nous. Les noyaux de l’HaChomer Hatzaïr, les volontaires de par-delà les mers, les travailleurs du monde entier. Nous ne savions pas que étions nés en 1960 sur une étoile dont la lumière était morte depuis longtemps et qui sombrait déjà dans la mer. Nous ne savions pas que le mouvement kibboutzique avait été au faîte de sa gloire dans les années 1930, à l’époque des « Murs et tours » et qu’avant même la création de l’État d’Israël en 1947, la population des kibboutzim avait atteint son maximum et représentait 7 % de la population juive vivant en Israël. Ce pourcentage avait déjà chuté en 1948 et n’était plus que de 3,3 % dans les années 1970.
Nous ne savions pas que notre étoile n’éclairait plus qu’elle-même. Nous nous pensions semeurs et bâtisseurs.
Nous sommes nés en 1960 dans le kibboutz Yehi’am, le plus beau kibboutz du monde, avec le vert de ses pins, le mauve de sa couronne de bosquets et le jaune de ses genêts, fondé en 1946 sur une colline, au-dessous d’une forteresse datant des Croisés. Nous sommes nés dans le groupe Narcisse, seize enfants, huit garçons et huit filles, un groupe gracieux, pour la plupart enfants tardifs des Hongrois fondateurs qui avaient bâti le kibboutz avec l’aide d’un noyau israélien.
La proximité et l'éloignement étaient intentionnels,il fallait éduquer et protéger les jeunes de la menace de la corruption bourgeoise provenant des familles et des kibboutzim déjà pervertis, mais en même temps, il fallait inculquer les valeurs de travail, de créativité et de communauté. Dans le kibboutzim de l'HaChomer Hatzaïr' l'éducation au socialisme commençait dès la naissance.
Au kibboutz, on vous envoie étudier les matières dont le kibboutz a besoin, et on travaille là où on a besoin de travailleurs.Car le seul et unique métier est d,être membre du kibboutz.
Le kibboutz n'est pas un village au paysage pastorale mais une oeuvre politique....Bâtir un autre monde nécessitant une conception différente de la famille et du foyer.
Au kibboutz, on vous envoie étudier les matières dont le kibboutz a besoin, et on travaille là où on a besoin de travailleurs.Car le seul et unique métier est d,être membre du kibboutz.
Le kibboutz n'est pas un village au paysage pastorale mais une oeuvre politique....Bâtir un autre monde nécessitant une conception différente de la famille et du foyer.
autres livres classés : littérature israélienneVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Yaël Neeman (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1742 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1742 lecteurs ont répondu