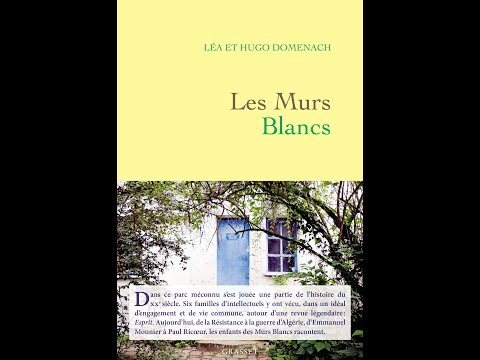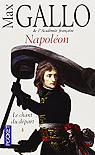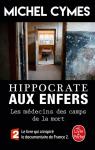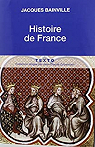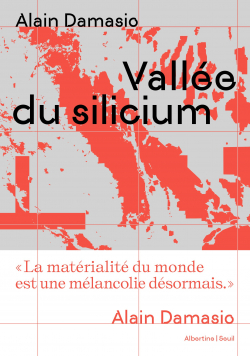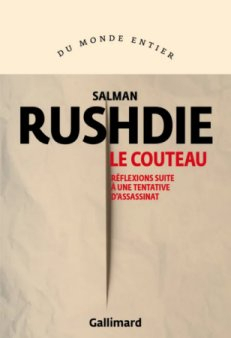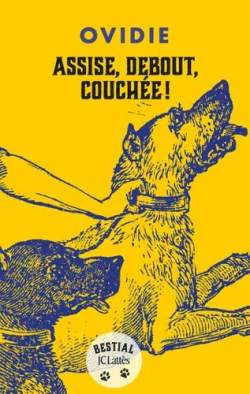Henri-Irénée Marrou/5
15 notes
Résumé :
De la connaissance historique
" Un livre capital." Philippe Ariès
" Il s'agit ici d'un essai qui est une manière de chef-d'oeuvre. Sérieusement, je
ne crois pas avoir rien lu d'aussi complet
ni d'aussi précis sur le travail de l'historien; et plus d'une page en va singulièrement loin dans le mystère de la
connaissance de l'homme par l'homme. "
Henri Rambaud
" Un tel livre n'est pas seulement fort utile pour l... >Voir plus
" Un livre capital." Philippe Ariès
" Il s'agit ici d'un essai qui est une manière de chef-d'oeuvre. Sérieusement, je
ne crois pas avoir rien lu d'aussi complet
ni d'aussi précis sur le travail de l'historien; et plus d'une page en va singulièrement loin dans le mystère de la
connaissance de l'homme par l'homme. "
Henri Rambaud
" Un tel livre n'est pas seulement fort utile pour l... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après De la connaissance historiqueVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Bonne introduction a la recherche historique dans ce qu'elle peut avoir de très frustrant mais aussi en son potentiel de transformation de l'homme et de la société. Un compte rendu honnête des limites de la discipline. A garder en tete lorsque l'on aborde les oeuvres des historiens modernes et/ou passes.
Citations et extraits (19)
Voir plus
Ajouter une citation
L'historien, avons-nous montré, commence par se poser une question; puis il constitue un dossier de documents y afférents, que I'analyse préliminaire conduit à affecter, chacun, de sa note de crédibilité. Image encore trop élémentaire : le progrès de la connaissance : réalise par ce mouvement dialectique, circulaire ou mieux hélicoïdal, dans lequel l'esprit de l'historien passe successivement de I'objet de sa recherche au document qui en est I'instrument et réciproquement ; la question qui a déclenché le mouvement ne reste pas identique à elle-même ; au contact des données du document, elle ne cesse de se transformer : on réalise, par exemple, qu'elle était absurde, anachronique (« le problème ne se pose pas »), on apprend à la formuler en termes plus précis, mieux adaptés à la nature de l'objet. C'est là le bénéfice de notre epokhè provisoire : au lieu d'un interrogatoire impatient qui sans cesse interrompt le témoin pour lui dire : Revenons à la question », I'historien demande au document : « Qui es-tu? Apprends-moi à te connaître ». [p.117]
Aussi bien notre théorie de la connaissance historique peut profiter de tout ce que la théologie et, si j'ose dire, la psychologie chrétiennes ont accumulé de réflexion autour de la notion de "foi divine" (...) : l'acte de foi historique ne doit pas être arbitraire, il comporte des preambula fidei rationnels; I'effort de compréhension auquel nous avons soumis les documents (...), cet effort aboutit pour finir à un jugement de crédibilité, jugement fondé en raison; l'historien consciencieux se gardera toujours de ce que la théorie catholique appelle l'erreur du "fidéisme", cette tendance à minimiser ou à nier le rôle de la raison démonstrative dans l'établissement de la croyance saine.
Condition nécessaire, mais non suffisante : une fois reconnu que confiance n'est pas crédibilité, que la foi n'est pas arbitraire pur, l'effet d'un despotisme de la volonté qui "captiverait" l'intelligence (en conservant au mot le sens fort que Bossuet aimait encore à lui donner), il reste que l'acte de foi demeure un acte libre qui engage l'homme tout entier, implique une décision existentielle. [p.129 - 130]
Condition nécessaire, mais non suffisante : une fois reconnu que confiance n'est pas crédibilité, que la foi n'est pas arbitraire pur, l'effet d'un despotisme de la volonté qui "captiverait" l'intelligence (en conservant au mot le sens fort que Bossuet aimait encore à lui donner), il reste que l'acte de foi demeure un acte libre qui engage l'homme tout entier, implique une décision existentielle. [p.129 - 130]
Il faut savoir reconnaître de bonne grâce nos servitudes à l'égard des documents, mesurer leur portée, savoir ce qu'il est possible d'en tirer (si ingénieux qu'il soit, l'historien ne peut extrapoler indéfiniment le témoignage de ses sources, leur faire dire autre chose que ce qu'elles sont faites pour dire). Nos servitudes aussi à l'égard de la logique, mesurer nos propres forces, ne pas promettre plus que nous ne pouvons tenir, savoir limiter à temps notre curiosité, exercer nos efforts dans les conditions, et les bornes, où ils peuvent réellement se montrer féconds (...). [p.139]
En face de la réalité du passé qu'il s'agit d'appréhender, c'est moins la question d'existence que la question d'essence qui préoccupe l'historien : établir la réalité de l'élément (qui, encore une fois peut être un sentiment, une idée aussi bien qu'une action un phénomène d'ensemble aussi bien qu'un geste individuel) importe certes, mais ne saurait suffire ; sur le squelette événementiel, il faut pouvoir replacer et les nerfs, et la chair et la peu - l'épiderme délicat et frémissant de la vie, c'est la complexité du réel, de l'homme, qui est l'objet de l'histoire. [p.125 - 126]
Comme chaque fois que notre théorie souligne une vertu nouvelle à exiger de l'historien, c'est une limite de plus qui s'impose à l'histoire : un document sera exactement compris dans la mesure où il se rencontrera un historien capable d'apprécier avec plus de profondeur sa nature et sa portée. [p.114 - 115]
Lire un extrait
Video de Henri-Irénée Marrou (2)
Voir plusAjouter une vidéo
« Personne ne soupçonne l'existence des Murs Blancs. Pourtant cette propriété a marqué l'histoire intellectuelle du XXème siècle. Elle a été aussi le lieu, où enfants, nous passions nos dimanche après-midi : la maison de nos grands-parents…
Après la guerre, ce magnifique parc aux arbres centenaires niché dans le vieux Châtenay-Malabry, est choisi par le philosophe Emmanuel Mounier, pour y vivre en communauté avec les collaborateurs de la revue qu'il a fondé : Esprit. Quatre intellectuels, chrétiens de gauche et anciens résistants, comme lui, Henri-Irénée Marrou, Jean Baboulène, Paul Fraisse, Jean-Marie Domenach, le suivent avec leurs familles dans cette aventure. Ils sont bientôt rejoints par Paul Ricoeur.
Pendant cinquante ans, les Murs Blancs sont le quartier général de leurs combats, dont la revue Esprit est le porte-voix : la guerre d'Algérie et la décolonisation, la lutte contre le totalitarisme communiste, la construction de l'Europe. Et bien sûr, Mai 68... Une vingtaine d'enfants, dont notre père, y sont élevés en collectivité. Malheureusement, les jalousies et les difficultés nourries par le quotidien de la vie en communauté y deviennent de plus en plus pesantes… Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles cette histoire est tombée dans l'oubli, et que personne n'avait pris la peine de nous la raconter jusqu'alors. Pourtant, beaucoup d'intellectuels, d'artistes et d'hommes politiques y ont fait leurs armes : Jacques Julliard, Jean Lebrun, Ivan Illich, Chris Marker, Jacques Delors et aussi… Emmanuel Macron. C'est grâce à leurs récits et confessions que nous avons pu renouer avec notre histoire : transformer un idéal difficile en récit familial et politique. »
L. et H. Domenach
+ Lire la suite
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Henri-Irénée Marrou (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3237 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3237 lecteurs ont répondu