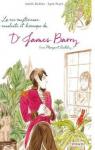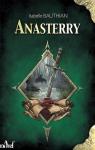Critiques de Isabelle Bauthian (341)
Christophe est cadre dans une grande entreprise. Sa vie est réglée comme du papier à musique et cette sécurité lui plaît. Dans son service, alors qu'une jeune collègue un peu hippie, Fleur, ne se gêne pas pour photocopier des documents personnels, son chef lui ordonne d'intervenir. Plutôt que de lui faire la leçon, il lui propose de boire un verre. Son sourire a réveillé quelque chose en lui. De même que sa spontanéité et sa drôlerie. À peine le verre avalé lui propose-t-elle d'aller chez lui. C'est le début d'une idylle entre eux même si la jeune femme semble bien différente de lui et avoir des conceptions de la vie opposées aux siennes...
Deux caractères opposés peuvent-ils s'aimer durablement ? L'organisé, le discret et un peu coincé Christophe peut-il s'entendre avec la hippie, la délurée et la désinvolte Fleur ? C'est cette histoire d'amour singulière que nous propose de suivre Isabelle Bauthian dans cet album, non pas fleur bleue, mais plutôt intelligent et original. L'auteur donne à réfléchir aussi bien sur les choses du quotidien que sur la conception de la vie, de ce que l'on veut en faire et des compromis que nous sommes prêts à faire pour vivre pleinement une relation à deux. Est-on sûr de vouloir voir notre propre reflet dans l'autre ou au contraire y trouver l'exact opposé ? Même si les caractères de Christophe et Fleur sont un tantinet stéréotypés et exagérés, l'auteur plante cette romance moderne et juste dans l'actualité. Avec son dessin proche du manga, Sylvain Limousi donne vie et modernité à cet album. Grâce aux couleurs au ton pastel, l'ambiance y est à la fois douce-amère et sentimentale.
Deux caractères opposés peuvent-ils s'aimer durablement ? L'organisé, le discret et un peu coincé Christophe peut-il s'entendre avec la hippie, la délurée et la désinvolte Fleur ? C'est cette histoire d'amour singulière que nous propose de suivre Isabelle Bauthian dans cet album, non pas fleur bleue, mais plutôt intelligent et original. L'auteur donne à réfléchir aussi bien sur les choses du quotidien que sur la conception de la vie, de ce que l'on veut en faire et des compromis que nous sommes prêts à faire pour vivre pleinement une relation à deux. Est-on sûr de vouloir voir notre propre reflet dans l'autre ou au contraire y trouver l'exact opposé ? Même si les caractères de Christophe et Fleur sont un tantinet stéréotypés et exagérés, l'auteur plante cette romance moderne et juste dans l'actualité. Avec son dessin proche du manga, Sylvain Limousi donne vie et modernité à cet album. Grâce aux couleurs au ton pastel, l'ambiance y est à la fois douce-amère et sentimentale.
Dans cet album de non-fiction (même si une petite histoire sert de fil rouge), les autrices s'attachent à montrer toutes les facettes de l'esprit critique, en mettant l'accent sur la méthode scientifique, et en dénonçant les multiples biais cognitifs qui peuvent altérer notre jugement. ● C'est remarquablement fait, et pour ma part je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses, alors que je croyais naïvement en connaître un rayon sur ce sujet ! Cela permet de se remettre en question ! ● La présentation s'efforce avec succès d'être agréable et ludique, pour faire passer ce que le fond du propos pourrait avoir d'austère, en particulier dans la recherche manifeste d'exhaustivité. ● Ce récit graphique devrait pouvoir tomber entre toutes les mains, c'est un vrai acte de salubrité publique à l'heure où la désinformation se déchaîne, ou les chaînes d'info en continu racontent n'importe quoi à longueur de journée, où les débats de soi-disant experts font rage partout. ● Une petite citation pour illustrer mon propos : « L'anti-intellectualisme s'infiltre sans relâche dans notre vie politique et culturelle, il est nourri par une idée trompeuse : celle que la démocratie signifierait ‘Mon ignorance a autant de valeur que votre savoir' ». ● Cet album passionnant de bout en bout est une vraie bouffée d'oxygène ! Je le recommande sans réserve.
Lutter, c’est vivre ; risquer, c’est vivre. Écarter d’avance le moindre obstacle, c’est la mort.
-
Ce tome contient une histoire complète, une forme de biographie consacrée au couple formé par Jean Cocteau (1889-1963) & Jean Marais (1913-1998). Sa première édition date de 2023. Le scénario a été écrit par Isabelle Bauthian, les dessins et les couleurs par Maurane Mazars. Il comporte cent-dix-neuf pages de bande dessinée. Il se termine avec un trombinoscope de trois pages présentant trente-quatre personnages apparaissant dans l’ouvrage, avec une petite vignette dessinée en gros plan, le nom de la personne, ses dates de naissance et de mort, et une brève présentation en une ou deux phrases. Après une page de remerciements des autrices, vient une liste des principales œuvres de Jean Cocteau.
Eugénie Cocteau, la mère de Jean, s’interroge. Elle ne sait pas comment elle a fait pour mettre au monde un poète. C’est très, très difficile. Il a toujours été sensible, cruel, parfois avec elle. Si, si, se souvient-il de ce gros mensonge, dans le train, qui manqué de la faire arrêter ? Avec ses amis, par contre… Ah, ils ne l’ont pas toujours remercié de sa générosité. Elle espère qu’il ne revoit plus cet odieux Maurice Sachs. Bien. En tout cas, elle est contente qu’il prenne enfin soin de sa santé. Et qu’en est-il de son mariage avec mademoiselle Chanel ? Mais pourquoi ne pas lui avouer ? Puisque c’est dans les journaux ! Paris en 1937, les journaux évoquent le fait que par crainte des milliers de tracts distribués par le Front populaire allemand, on ne fait plus l’obscurité dans les rues de Berlin. Jean Cocteau écrit un article sur le génie du boxeur Panama Al Brown. Dans le journal Action française, un article tourne en dérision le soutien de Cocteau à Brown. Un soir, Jean Marais reçoit un appel téléphonique de Jean Cocteau qui lui demande de venir immédiatement.
Jean Marais se rend en courant à l’hôtel Castille et va frapper à la porte de la chambre de Jean Cocteau. Celui-ci lui indique d’entrer, et il déclare au jeune acteur que c’est une catastrophe, il est amoureux de lui. D’abord pris de court, Marais se ressaisit et répond rapidement que c’est réciproque. Le lendemain, l’acteur dîne avec une actrice de la troupe de théâtre et elle le met en garde : s’il devient le nouvel enfant de Cocteau, les gens ne le verront plus jamais autrement. Quelques jours plus tard, le poète le présente à ses amis et ses amants : Christian Bérard, Boris Kochno, Marcel Khill, puis Marie-Laure de Noailles, Panama Al Brown, etc. L’actrice continue : tout le monde saura que Jean Marais n’est que le dernier en date de ces médiocres qu’il a parés de tous les talents, tellement il voulait le retrouver en eux. Marais ne comprend pas à quoi renvoie ce Le. Elle explicite le terme : Raymond Radiguet, le plus grand poète de leur génération, l’enfant auprès de qui Cocteau a créé ses plus grandes œuvres. Cocteau n’est plus que l’ombre de lui-même depuis sa mort. Suicidaire terrorisé par la mort, opiomane, médiocre. C’est à cette période qu’il crée sa pièce : les chevaliers de la table ronde.
Les éditions Steinkis ont débuté une collection appelé Dryade en 2022, avec [[ASIN:2368464336 Derrière le rideau - Simone Signoret et Yves Montand]] de Xavier Bétaucourt et Aleksi Cavaillez. La quatrième de couverture rappelle la définition de Dryade : réunion de deux principes qui se complètent réciproquement. Cette collection est consacrée aux couples qui ont marqué les esprits par leur engagement politique, leur créativité, leurs succès et leurs échecs, leurs forces et leurs faiblesses. Le présent ouvrage est donc consacré à l’idylle entre l’acteur et le dramaturge qui a duré de 1937 à 1948. Il s’arrête un peu avant. D’un côté, un poète, peintre, dessinateur, dramaturge et cinéaste français, âgé de quarante-huit ans en 1937, de l’autre un jeune acteur qui deviendra également metteur en scène, écrivain, peintre, sculpteur et potier, âgé de vingt-quatre ans. Cette idylle nait alors que le gouvernement d’Adolf Hitler a déjà viré au totalitarisme et que la seconde guerre mondiale approche, avec l’invasion et l’occupation d’une partie de la France. L’histoire personnelle de ces deux créateurs et de leur couple est indissolublement liée à celle de la France. Les autrices ont fait des choix structurels et esthétiques marqués pour rendre compte de cette réalité.
S’il commence par feuilleter l’ouvrage pour s’en faire une idée, le lecteur remarque qu’une partie significative de la narration repose sur des dialogues entre les personnages, souvent en plan poitrine ou plus rapproché, parfois en plan taille, avec un décor qui peut être minimaliste ou inexistant en fond de case, une mise en couleurs à base de camaïeu, à l’aquarelle, avec souvent une teinte prédominante pour une scène, du vert ou du rouge, un peu délavés. Il relève également une grande variété de lieux, et une discrète influence manga de type shojo dans certaines expressions de visage mais sans systématisme, souvent pour une émotion particulière plus appuyée. Dans les caractéristiques graphiques, il remarque également l’intégration de brèves coupures de presse qui semblent être des copies conformes d’articles de l’époque avec une reprographie reprenant l’épaississement des caractères et les imperfections d’imprimerie. Majoritairement l’artiste a recours à des traits de contour pour chaque forme, chaque personnage, parfois interrompus le temps d’une courbe ou d’un segment droit, et quelques cases sont réalisées en couleur directe, une certaine liberté d’exécution en phase avec la liberté d’écriture et de création de Cocteau.
Dans un premier temps, le lecteur ne sait pas trop comment s’adapter au mode narratif. Les deux pages d’introduction avec la mère de Jean Cocteau atteste de cette liberté visuelle : un dessin en pleine page, faisant penser à collage de différents éléments : la mère représentée en pied à la croisée de ce qui semble être deux faisceaux lumineux, l’un rouge, l’autre bleu, des bombes à ses pieds, une sorte de manteau ou de robe à motifs géométriques sur un mannequin à droite et un acteur ou deux déguisés en âne à gauche, la tête de son fils étant surimposée en lignes blanches. Dans la page suivante, elle est représentée en plan poitrine, jeune dans la première case, puis âgée dans la deuxième, puis en trait de contour délié de profil, puis sous forme d’une poupée gonflable avec un gros plan sur la tête, puis à nouveau comme dans la première page avec un perroquet sur l’épaule en plus. Le lecteur ne sait trop quoi en penser.
La page suivante comprend trois coupures de presse, un individu sur échelle en train de réaliser une fresque murale, et enfin deux cases, un téléphone qui sonne, un homme en très gros plan sur sa bouche qui répond. Les sept pages suivantes prennent une forme de bande dessinée classique, avec des cases alignées en bande, et ces camaïeux à l’aquarelle qui apportent de la substance, sans pour autant être figuratifs ou représentatifs de la couleur de chaque élément. En page treize, le lecteur découvre trois autres coupures de presse intégrées chacune à la place d’une case dans une bande. Puis en page seize, un autre article et cette fois-ci en surimpression de la case où les deux Jean regardent une danseuse sur scène. Les pages dix-huit et dix-neuf sont construites sur la base de juxtaposition d’images, sans bordure de case, avec un texte qui courent librement. En page trente-neuf, c’est une illustration en pleine page dépourvue de tout mot. En page quarante-quatre, trois bandes de deux cases, sans aucun mot. En page quatre-vingt-cinq, Jean Marais passe à tabac un critique insultant, et le rouge prend la place du noir pour les traits de contour et les aplats. La page quatre-vingt-treize contient uniquement le texte écrit par Jean Cocteau comme salut à Arno Breker, à l’occasion d’une exposition.
Les autrices montrent ainsi la relation qui unit les deux créateurs, la manière dont ils se soutiennent, dont Cocteau apprend à Marais à se cultiver, comment ce dernier réconforte le premier pendant les périodes de doute ou de manque. Les coupures de presse apportent un contexte partiel de la montée du nazisme, du déroulement de la guerre, des repères ponctuels et très épars, et aussi des informations sur les représentations, les parutions des œuvres de l’un, les rôles de l’autre. Il semble que l’ouvrage s’adresse d’abord à un lecteur ayant une idée préalable de la carrière de l’un et l’autre de ces deux créateurs, car la narration ne revêt pas une nature pédagogique ou vulgarisatrice. Par exemple, il vaut mieux pouvoir identifier les titres des pièces de théâtre, des films pour avoir l’assurance de ne pas les rater dans une page ou une autre. Sous cette réserve, ou après avoir lu une fiche encyclopédique sur la vie de l’un et l’autre à cette période, le lecteur ressent alors ce qui se joue pour les deux Jean, sur le plan de la création, sur le plan émotionnel, ainsi que l’intrication avec leur relation de couple. Il comprend la difficulté pour l’un comme pour l’autre de choisir s’il doit s’engager contre l’envahisseur et ses idées et comment, sur le dilemme cornélien d’accomplir leur métier de créateur dans une période d’incertitude totale sur la possibilité de faire jouer une pièce, de réaliser un film, de subir la censure, d’aider des amis ou d’autres créateurs qui portent l’étoile jaune. Ces questionnements et les décisions afférentes apparaissent sans manichéisme ni leçon de morale, découlant de la personnalité et l’histoire de l’un et de l’autre.
Une collection ambitieuse avec pour objectif de donner à voir l’engagement d’un couple dans son époque. Cette bande dessinée peut sembler un peu difficile d’accès pour un lecteur totalement ignorant de la vie des deux Jean, ce à quoi la simple lecture d’une fiche encyclopédique peut rapidement remédier. Il plonge alors dans une narration visuelle très personnelle, adaptée à la diversité des formes de création de ces deux auteurs. Il ressent la pression de l’Histoire, les événements arbitraires qui influent sur leur vie, en même temps qu’il côtoie deux êtres à la personnalité et à l’histoire différente, et qu’il devient le témoin privilégié de leur relation amoureuse et de la manière dont elle les enrichit l’un l’autre.
-
Ce tome contient une histoire complète, une forme de biographie consacrée au couple formé par Jean Cocteau (1889-1963) & Jean Marais (1913-1998). Sa première édition date de 2023. Le scénario a été écrit par Isabelle Bauthian, les dessins et les couleurs par Maurane Mazars. Il comporte cent-dix-neuf pages de bande dessinée. Il se termine avec un trombinoscope de trois pages présentant trente-quatre personnages apparaissant dans l’ouvrage, avec une petite vignette dessinée en gros plan, le nom de la personne, ses dates de naissance et de mort, et une brève présentation en une ou deux phrases. Après une page de remerciements des autrices, vient une liste des principales œuvres de Jean Cocteau.
Eugénie Cocteau, la mère de Jean, s’interroge. Elle ne sait pas comment elle a fait pour mettre au monde un poète. C’est très, très difficile. Il a toujours été sensible, cruel, parfois avec elle. Si, si, se souvient-il de ce gros mensonge, dans le train, qui manqué de la faire arrêter ? Avec ses amis, par contre… Ah, ils ne l’ont pas toujours remercié de sa générosité. Elle espère qu’il ne revoit plus cet odieux Maurice Sachs. Bien. En tout cas, elle est contente qu’il prenne enfin soin de sa santé. Et qu’en est-il de son mariage avec mademoiselle Chanel ? Mais pourquoi ne pas lui avouer ? Puisque c’est dans les journaux ! Paris en 1937, les journaux évoquent le fait que par crainte des milliers de tracts distribués par le Front populaire allemand, on ne fait plus l’obscurité dans les rues de Berlin. Jean Cocteau écrit un article sur le génie du boxeur Panama Al Brown. Dans le journal Action française, un article tourne en dérision le soutien de Cocteau à Brown. Un soir, Jean Marais reçoit un appel téléphonique de Jean Cocteau qui lui demande de venir immédiatement.
Jean Marais se rend en courant à l’hôtel Castille et va frapper à la porte de la chambre de Jean Cocteau. Celui-ci lui indique d’entrer, et il déclare au jeune acteur que c’est une catastrophe, il est amoureux de lui. D’abord pris de court, Marais se ressaisit et répond rapidement que c’est réciproque. Le lendemain, l’acteur dîne avec une actrice de la troupe de théâtre et elle le met en garde : s’il devient le nouvel enfant de Cocteau, les gens ne le verront plus jamais autrement. Quelques jours plus tard, le poète le présente à ses amis et ses amants : Christian Bérard, Boris Kochno, Marcel Khill, puis Marie-Laure de Noailles, Panama Al Brown, etc. L’actrice continue : tout le monde saura que Jean Marais n’est que le dernier en date de ces médiocres qu’il a parés de tous les talents, tellement il voulait le retrouver en eux. Marais ne comprend pas à quoi renvoie ce Le. Elle explicite le terme : Raymond Radiguet, le plus grand poète de leur génération, l’enfant auprès de qui Cocteau a créé ses plus grandes œuvres. Cocteau n’est plus que l’ombre de lui-même depuis sa mort. Suicidaire terrorisé par la mort, opiomane, médiocre. C’est à cette période qu’il crée sa pièce : les chevaliers de la table ronde.
Les éditions Steinkis ont débuté une collection appelé Dryade en 2022, avec [[ASIN:2368464336 Derrière le rideau - Simone Signoret et Yves Montand]] de Xavier Bétaucourt et Aleksi Cavaillez. La quatrième de couverture rappelle la définition de Dryade : réunion de deux principes qui se complètent réciproquement. Cette collection est consacrée aux couples qui ont marqué les esprits par leur engagement politique, leur créativité, leurs succès et leurs échecs, leurs forces et leurs faiblesses. Le présent ouvrage est donc consacré à l’idylle entre l’acteur et le dramaturge qui a duré de 1937 à 1948. Il s’arrête un peu avant. D’un côté, un poète, peintre, dessinateur, dramaturge et cinéaste français, âgé de quarante-huit ans en 1937, de l’autre un jeune acteur qui deviendra également metteur en scène, écrivain, peintre, sculpteur et potier, âgé de vingt-quatre ans. Cette idylle nait alors que le gouvernement d’Adolf Hitler a déjà viré au totalitarisme et que la seconde guerre mondiale approche, avec l’invasion et l’occupation d’une partie de la France. L’histoire personnelle de ces deux créateurs et de leur couple est indissolublement liée à celle de la France. Les autrices ont fait des choix structurels et esthétiques marqués pour rendre compte de cette réalité.
S’il commence par feuilleter l’ouvrage pour s’en faire une idée, le lecteur remarque qu’une partie significative de la narration repose sur des dialogues entre les personnages, souvent en plan poitrine ou plus rapproché, parfois en plan taille, avec un décor qui peut être minimaliste ou inexistant en fond de case, une mise en couleurs à base de camaïeu, à l’aquarelle, avec souvent une teinte prédominante pour une scène, du vert ou du rouge, un peu délavés. Il relève également une grande variété de lieux, et une discrète influence manga de type shojo dans certaines expressions de visage mais sans systématisme, souvent pour une émotion particulière plus appuyée. Dans les caractéristiques graphiques, il remarque également l’intégration de brèves coupures de presse qui semblent être des copies conformes d’articles de l’époque avec une reprographie reprenant l’épaississement des caractères et les imperfections d’imprimerie. Majoritairement l’artiste a recours à des traits de contour pour chaque forme, chaque personnage, parfois interrompus le temps d’une courbe ou d’un segment droit, et quelques cases sont réalisées en couleur directe, une certaine liberté d’exécution en phase avec la liberté d’écriture et de création de Cocteau.
Dans un premier temps, le lecteur ne sait pas trop comment s’adapter au mode narratif. Les deux pages d’introduction avec la mère de Jean Cocteau atteste de cette liberté visuelle : un dessin en pleine page, faisant penser à collage de différents éléments : la mère représentée en pied à la croisée de ce qui semble être deux faisceaux lumineux, l’un rouge, l’autre bleu, des bombes à ses pieds, une sorte de manteau ou de robe à motifs géométriques sur un mannequin à droite et un acteur ou deux déguisés en âne à gauche, la tête de son fils étant surimposée en lignes blanches. Dans la page suivante, elle est représentée en plan poitrine, jeune dans la première case, puis âgée dans la deuxième, puis en trait de contour délié de profil, puis sous forme d’une poupée gonflable avec un gros plan sur la tête, puis à nouveau comme dans la première page avec un perroquet sur l’épaule en plus. Le lecteur ne sait trop quoi en penser.
La page suivante comprend trois coupures de presse, un individu sur échelle en train de réaliser une fresque murale, et enfin deux cases, un téléphone qui sonne, un homme en très gros plan sur sa bouche qui répond. Les sept pages suivantes prennent une forme de bande dessinée classique, avec des cases alignées en bande, et ces camaïeux à l’aquarelle qui apportent de la substance, sans pour autant être figuratifs ou représentatifs de la couleur de chaque élément. En page treize, le lecteur découvre trois autres coupures de presse intégrées chacune à la place d’une case dans une bande. Puis en page seize, un autre article et cette fois-ci en surimpression de la case où les deux Jean regardent une danseuse sur scène. Les pages dix-huit et dix-neuf sont construites sur la base de juxtaposition d’images, sans bordure de case, avec un texte qui courent librement. En page trente-neuf, c’est une illustration en pleine page dépourvue de tout mot. En page quarante-quatre, trois bandes de deux cases, sans aucun mot. En page quatre-vingt-cinq, Jean Marais passe à tabac un critique insultant, et le rouge prend la place du noir pour les traits de contour et les aplats. La page quatre-vingt-treize contient uniquement le texte écrit par Jean Cocteau comme salut à Arno Breker, à l’occasion d’une exposition.
Les autrices montrent ainsi la relation qui unit les deux créateurs, la manière dont ils se soutiennent, dont Cocteau apprend à Marais à se cultiver, comment ce dernier réconforte le premier pendant les périodes de doute ou de manque. Les coupures de presse apportent un contexte partiel de la montée du nazisme, du déroulement de la guerre, des repères ponctuels et très épars, et aussi des informations sur les représentations, les parutions des œuvres de l’un, les rôles de l’autre. Il semble que l’ouvrage s’adresse d’abord à un lecteur ayant une idée préalable de la carrière de l’un et l’autre de ces deux créateurs, car la narration ne revêt pas une nature pédagogique ou vulgarisatrice. Par exemple, il vaut mieux pouvoir identifier les titres des pièces de théâtre, des films pour avoir l’assurance de ne pas les rater dans une page ou une autre. Sous cette réserve, ou après avoir lu une fiche encyclopédique sur la vie de l’un et l’autre à cette période, le lecteur ressent alors ce qui se joue pour les deux Jean, sur le plan de la création, sur le plan émotionnel, ainsi que l’intrication avec leur relation de couple. Il comprend la difficulté pour l’un comme pour l’autre de choisir s’il doit s’engager contre l’envahisseur et ses idées et comment, sur le dilemme cornélien d’accomplir leur métier de créateur dans une période d’incertitude totale sur la possibilité de faire jouer une pièce, de réaliser un film, de subir la censure, d’aider des amis ou d’autres créateurs qui portent l’étoile jaune. Ces questionnements et les décisions afférentes apparaissent sans manichéisme ni leçon de morale, découlant de la personnalité et l’histoire de l’un et de l’autre.
Une collection ambitieuse avec pour objectif de donner à voir l’engagement d’un couple dans son époque. Cette bande dessinée peut sembler un peu difficile d’accès pour un lecteur totalement ignorant de la vie des deux Jean, ce à quoi la simple lecture d’une fiche encyclopédique peut rapidement remédier. Il plonge alors dans une narration visuelle très personnelle, adaptée à la diversité des formes de création de ces deux auteurs. Il ressent la pression de l’Histoire, les événements arbitraires qui influent sur leur vie, en même temps qu’il côtoie deux êtres à la personnalité et à l’histoire différente, et qu’il devient le témoin privilégié de leur relation amoureuse et de la manière dont elle les enrichit l’un l’autre.
Ce récit graphique nous raconte la vie de Margaret Butley qui, au XIXe siècle, s’est, pendant toute sa vie d’adulte, travestie en homme pour pouvoir exercer la médecine. A la fois d’une grande compétence et très sévère envers les incompétents, elle occupa les postes les plus prestigieux de l’administration coloniale britannique. ● Ce récit original est d’une grande richesse, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force, car il est très intéressant, mais aussi sa faiblesse car les autrices veulent tant en dire que le propos est très souvent très confus. Il aurait mieux valu retenir moins d’événements mais mieux les traiter. ● Les dessins ne contribuent pas à la clarté, bien au contraire : je les ai trouvés fouillis au niveau tant du trait que des couleurs. Bien souvent, on ne reconnaît pas les personnages d’une case à l’autre ; les transitions sont très souvent confuses ; la chronologie est bouleversée comme cela se fait souvent, mais ici c’est en dépit du bon sens. ● Tout cela perd le lecteur qui n’y comprend rien. En cours de lecture, j’ai dû plusieurs fois me référer à la page Wikipédia pour m’y retrouver. ● Des annexes permettent aussi de reconstituer l’existence de cette femme extraordinaire et méconnue de façon bien plus claire que le récit graphique !
Une BD de fantasy. Semblable à plein d'autres même si le décalage des armes vers la prédominance du poison tente d'introduire de l'originalité.
Le dessin très stylé "héroïc fantasy Soleil" avec de belles couleurs sert bien l'histoire. Mais il n'y a pas grand chose d'original et l'humour est insuffisant pour faire passer l'ensemble. Il y a une suite prévue que je lirais si ma bibliothécaire pense à se le procurer.
Le dessin très stylé "héroïc fantasy Soleil" avec de belles couleurs sert bien l'histoire. Mais il n'y a pas grand chose d'original et l'humour est insuffisant pour faire passer l'ensemble. Il y a une suite prévue que je lirais si ma bibliothécaire pense à se le procurer.
La réalité n'est pas un sondage.
-
Ce tome est un exposé sur le thème de l’esprit critique, ne nécessitant aucune connaissance préalable. Sa première publication date de 2021. Il a été réalisé par Isabelle Bauthian pour le scénario, par Gally pour les dessins et les couleurs avec l’aide de Reiko Takaku assistante couleur. Cet ouvrage compte cent-vingt pages de bande dessinées. Il se termine par une courte biographie des deux auteurs en un paragraphe, une bibliographie de deux pages, et une double page intitulée Pour aller plus loin répertoriant douze ouvrages dont La petite Bédéthèque des Savoirs T24 Crédulité et rumeurs. Faire face aux théories du complot (2018) de Gérald Bronner & Krassinsky.
Un groupe de six amis, de jeunes adultes des deux sexes, mangent sur la terrasse d’un appartement, rendue plus agréable par la présence de nombreuses plantes vertes. Une nouvelle venue sonne à la porte : Masha, habillées d’une longue robe violette ; elle indique qu’elle a apporté ses photographies de fées. Elle explique : ce sont des esprits de paix et de guérison. Elle a eu l’honneur de les rencontrer plusieurs fois, leur présence silencieuse lui a appris à améliorer ses facultés méditatives. Et quand elle y est parvenue, son asthme a été soulagé. Paul Boutet ironise en répondant que sûrement ça ne peut pas être juste la balade et l’air pur. La jeune femme se ferme immédiatement : un sceptique ! Elle continue : elle aussi elle l’a été, mais elle a testé sa foi. Elle est revenue à différentes heures, sous différentes lumières, alors qu’elle était d’humeurs variées. Leur présence ne dépendait en rien de ces facteurs.la dernière fois, lorsqu’elle s’est approchée, elle a entendu un son de clochettes. Paul ajoute une remarque narquoise comme quoi ça ne l’étonne pas. Elle rétorque que bien des visionnaires ont été pris pour des fous avant qu’on ne leur donne raison, comme Galilée, Gandhi… L’hôtesse ajoute que Paul est particulièrement lourd.
Un autre invité s’adresse à Paul : il n’est pas surpris car Paul a toujours eu peur de ce qu’il ne pouvait pas expliquer. L’hôtesse continue : le monde est plein de mystères, c’est bien la preuve de l’existence de forces qui dépassent les humains. Un troisième intervient : il y a d’autres explications possibles. C’est facile de voir un motif dans de l’eau ou des nuages… Peut-être qu’un gamin avait construit un barrage un peu plus haut, et que ça perturbait le courant. Masha objecte qu’elle a remonté plusieurs fois cette rivière et il n’y avait aucun barrage : ce sont bien des fées ! Elle conclut : si ce n’est pas des fées, que les autres lui prouvent. Ses interlocuteurs interloqués ne répondant pas, elle conclut qu’elle veut bien se remettre en question, mais on parle là d’une technique de communication inter-spectrale utilisée par les druides depuis des millénaires. Paul ne peut pas retenir une exclamation : Mais c’est n’importe quoi ! Masha l’achève en accusant Paul de devenir insultant pour la culture celte. Paul rentre chez lui et se lâche sur les réseaux sociaux.
Au vu du titre et du texte de la quatrième de couverture, le lecteur sait qu’il s’agit d’un ouvrage de vulgarisation sur l’esprit critique. À la lecture, il constate les liens avec la méthode scientifique, ainsi qu’avec la zététique. Pour la narration de ce type d’ouvrage de vulgarisation, les auteurs optent soit pour un candide, soit pour un avatar de l’auteur qui expose et explique les différentes notions, avec une interaction plus ou moins sophistiquée avec les dessins. Ici, le procédé retenu procède un peu d’un mélange, avec le personnage principal Paul Boutet jouant le rôle du candide, et une incarnation humaine du principe de l’esprit critique. Les dessins apparaissent tout de suite très agréables à l’œil : une approche réaliste avec un degré signification de simplification dans la description. Des personnages jeunes sans beaucoup d’exagération dans l’expressivité de leur visage ou de leur langage corporel, immédiatement sympathiques, parfois contrariés, mais jamais animés d’émotions négatives ou destructrices. Le lecteur sait que l’ouvrage s’avèrera forcément composé de parties explicatives, et dans le même temps la première scène propose une mise en situation très concrète, opposant une jeune femme convaincue de la justesse de ses propos, de l’existence des fées, et Paul faisant preuve d’une attitude cartésienne ne pouvant pas souffrir ce genre de billevesées. Pourtant, il n’a pas le beau rôle, et les auteurs ne condamnent pas Masha par la raillerie ou la moquerie. C’est plutôt Paul qui apparaît comme obtus en dénigrant Masha sur les réseaux sociaux.
L’avatar de l’esprit critique apparaît dès la page neuf, en colère contre Paul qui use d’insultes et de moqueries sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme joue le rôle de professeur qui se lance dans un exposé construit et structuré sur l’esprit critique. Paul intervient plus ou moins pour objecter avec une situation concrète ou une remarque, pour relancer en posant une question, parfois en essayant de mettre en pratique ce que l’esprit critique vient d’expliquer. Pour autant, le lecteur n’éprouve pas la sensation de se retrouver en classe, car les auteurs mettent à profit les spécificités de ce mode d’expression : mises en situation au budget illimité, retour dans le passé sans limite d’ancienneté, intervention de scientifiques et de chercheurs illustres, représentation d’expériences classiques, observations en direct de phénomènes naturels ou sociaux. Le lecteur ressent rapidement que l’ouvrage a été conçu comme une vraie bande dessinée, scénariste et dessinatrice concevant chaque séquence ensemble avec des constructions de séquence reposant autant sur l’exposé en paroles de l’esprit critique, que sur ce qui est montré dans les dessins. Le lecteur ressent également la variété des possibilités visuelles utilisées : êtres humains en train d’interagir, facsimilé d’une conversation en messages instantanés, réseau de neurones et de synapses, dragon crachant du feu, facsimilé de diagrammes, orbites de planètes, morceaux de puzzle, jeu de plateau pour les différentes étapes de la méthode scientifique moderne, fausses affiches de publicité, utilisation de personnalités diverses (de savants comme Galilée, à un présentateur télé comme John Oliver), logos de moteur de recherche scientifique, page de résultat google, onomatopée d’effets sonores, etc.
La découverte des principes de l’esprit critique se trouve ainsi incarnée au travers de Paul et de son avatar. Cette dernière rentre dans le vif du sujet avec la première évidence : une corrélation n’est pas une relation de cause à effet, citant quelques exemples remarquables et amusants, extraits de l’ouvrage Spurious correlations (2015), de Tyler Vigen. La dessinatrice reprend quatre exemples sous forme de graphique mettant en évidence des courbes similaires entre le montant des dépenses U.S. pour la science et le nombre de morts par pendaison, entre le nombre de noyades dans des piscines et le nombre de films où Nicolas Cage apparaît, entre le taux de divorce dans le Maine et la consommation de margarine, entre la consommation de fromage et le nombre de morts étouffés dans leurs draps. Suit un diagramme pour expliquer que par rapport à une moyenne, il y a autant d’individus en dessous qu’au-dessus. Sous réserve qu’il soit familier de cet auteur, le lecteur sourit en voyant Terry Pratchet (1948-2015) chevaucher une tortue dans le ciel pour donner sa définition de la science : c’est une méthode qui consiste à poser des interrogations gênantes et à les soumettre à l’épreuve de la réalité, évitant ainsi la propension de l’homme à croire ce qui lui fait du bien. À partir de la page vingt-trois, l’esprit critique se lance dans l’histoire chronologique des activités scientifiques : l’artiste représente alors des hommes des cavernes, des éléments mythologiques (scandinave, grec…). Puis viennent les premiers hommes célèbres pour leurs théories scientifiques : Pythagore Platon, Eudoxe de Cnide, Héraclide du Pont… jusqu’à arriver à Anaximandre de Milet (de -610 à -546), premier Grec connu à avoir tenté de décrire et d’expliquer l'origine et l'organisation de tous les aspects du monde de façon scientifique.
Le lecteur apprécie à sa juste valeur la qualité de l’exposé, à la fois pour sa narration animée, vivante et amusante, à la fois pour la clarté de chaque point développé. La première partie aboutit à une double page présentant les différentes étapes de la méthode scientifique : observation, hypothèses, expériences, théories, évaluation par les pairs. Puis les auteurs abordent la question des pseudo-sciences sous un angle critique (avec une petite pique contre la pseudo-science qui refuse de contredire les hypothèses d’un fondateur), les présentations manipulatrices pour parer de termes scientifiques sans en observer la méthode. Le lecteur découvre ensuite la longue liste des biais cognitifs, chacun illustré par un exemple ou une mise en situation très parlante : paréidolie, biais de statuquo, effet Dunning-Kruger, effet Barnum, illusion de savoir, erreur fondamentale d’attribution, effet de halo, illusion de corrélation, biais de négativité, biais d’omission, biais de projection, biais de confirmation, effet foule, biais de la tache aveugle, illusion de fréquence, autruche, biais de cadrage, biais d’ancrage, effet de l’humour, biais rétrospectif, biais de rationalisation, illusion de savoir, illusion de fréquence, biais de représentativité. En fonction de sa culture en la matière, le lecteur retrouve ou découvre des problématiques incontournables comme la charge de la preuve (l’absence de la preuve n’est pas la même chose que la preuve de l’absence), les cinq questions de base à se poser face à une information, les parasites argumentatifs (sophisme et paralogisme, avec leurs dérivés), le fait que toutes les hypothèses ne se valent pas (entre un avis et un consensus scientifique), que la réalité n’est pas un sondage, et que l’ouverture d’esprit n’est pas synonyme de relativisme. Ils vont jusqu’à aborder la place de la foi dans l’esprit critique, à nouveau sans mépris ou même condescendance, et le caractère indispensable des émotions comme moteur de la raison.
Quelle que soit sa familiarité avec l’esprit critique et la méthode scientifique, le lecteur se retrouve vite passionné par cet exposé à la forme enjoué et rigoureuse. La narration visuelle a été pensé pour participer à l’exposé en apportant elle aussi sa part d’informations, de façon diversifiée et adaptée à chaque développement. L’ouvrage présente les différentes facettes de l’esprit citrique, d’abord par la méthode scientifique, puis par les biais cognitifs, les effets de rhétorique, avec à chaque fois des exemples concrets et actuels. Le tout aboutit à une présentation cohérente de ce qu’est une démarche scientifique quel que soit l’objet de son étude, et observe des situations sociales et des communications de l’industrie du divertissement et de la société du spectacle à cette lumière. Indispensable.
-
Ce tome est un exposé sur le thème de l’esprit critique, ne nécessitant aucune connaissance préalable. Sa première publication date de 2021. Il a été réalisé par Isabelle Bauthian pour le scénario, par Gally pour les dessins et les couleurs avec l’aide de Reiko Takaku assistante couleur. Cet ouvrage compte cent-vingt pages de bande dessinées. Il se termine par une courte biographie des deux auteurs en un paragraphe, une bibliographie de deux pages, et une double page intitulée Pour aller plus loin répertoriant douze ouvrages dont La petite Bédéthèque des Savoirs T24 Crédulité et rumeurs. Faire face aux théories du complot (2018) de Gérald Bronner & Krassinsky.
Un groupe de six amis, de jeunes adultes des deux sexes, mangent sur la terrasse d’un appartement, rendue plus agréable par la présence de nombreuses plantes vertes. Une nouvelle venue sonne à la porte : Masha, habillées d’une longue robe violette ; elle indique qu’elle a apporté ses photographies de fées. Elle explique : ce sont des esprits de paix et de guérison. Elle a eu l’honneur de les rencontrer plusieurs fois, leur présence silencieuse lui a appris à améliorer ses facultés méditatives. Et quand elle y est parvenue, son asthme a été soulagé. Paul Boutet ironise en répondant que sûrement ça ne peut pas être juste la balade et l’air pur. La jeune femme se ferme immédiatement : un sceptique ! Elle continue : elle aussi elle l’a été, mais elle a testé sa foi. Elle est revenue à différentes heures, sous différentes lumières, alors qu’elle était d’humeurs variées. Leur présence ne dépendait en rien de ces facteurs.la dernière fois, lorsqu’elle s’est approchée, elle a entendu un son de clochettes. Paul ajoute une remarque narquoise comme quoi ça ne l’étonne pas. Elle rétorque que bien des visionnaires ont été pris pour des fous avant qu’on ne leur donne raison, comme Galilée, Gandhi… L’hôtesse ajoute que Paul est particulièrement lourd.
Un autre invité s’adresse à Paul : il n’est pas surpris car Paul a toujours eu peur de ce qu’il ne pouvait pas expliquer. L’hôtesse continue : le monde est plein de mystères, c’est bien la preuve de l’existence de forces qui dépassent les humains. Un troisième intervient : il y a d’autres explications possibles. C’est facile de voir un motif dans de l’eau ou des nuages… Peut-être qu’un gamin avait construit un barrage un peu plus haut, et que ça perturbait le courant. Masha objecte qu’elle a remonté plusieurs fois cette rivière et il n’y avait aucun barrage : ce sont bien des fées ! Elle conclut : si ce n’est pas des fées, que les autres lui prouvent. Ses interlocuteurs interloqués ne répondant pas, elle conclut qu’elle veut bien se remettre en question, mais on parle là d’une technique de communication inter-spectrale utilisée par les druides depuis des millénaires. Paul ne peut pas retenir une exclamation : Mais c’est n’importe quoi ! Masha l’achève en accusant Paul de devenir insultant pour la culture celte. Paul rentre chez lui et se lâche sur les réseaux sociaux.
Au vu du titre et du texte de la quatrième de couverture, le lecteur sait qu’il s’agit d’un ouvrage de vulgarisation sur l’esprit critique. À la lecture, il constate les liens avec la méthode scientifique, ainsi qu’avec la zététique. Pour la narration de ce type d’ouvrage de vulgarisation, les auteurs optent soit pour un candide, soit pour un avatar de l’auteur qui expose et explique les différentes notions, avec une interaction plus ou moins sophistiquée avec les dessins. Ici, le procédé retenu procède un peu d’un mélange, avec le personnage principal Paul Boutet jouant le rôle du candide, et une incarnation humaine du principe de l’esprit critique. Les dessins apparaissent tout de suite très agréables à l’œil : une approche réaliste avec un degré signification de simplification dans la description. Des personnages jeunes sans beaucoup d’exagération dans l’expressivité de leur visage ou de leur langage corporel, immédiatement sympathiques, parfois contrariés, mais jamais animés d’émotions négatives ou destructrices. Le lecteur sait que l’ouvrage s’avèrera forcément composé de parties explicatives, et dans le même temps la première scène propose une mise en situation très concrète, opposant une jeune femme convaincue de la justesse de ses propos, de l’existence des fées, et Paul faisant preuve d’une attitude cartésienne ne pouvant pas souffrir ce genre de billevesées. Pourtant, il n’a pas le beau rôle, et les auteurs ne condamnent pas Masha par la raillerie ou la moquerie. C’est plutôt Paul qui apparaît comme obtus en dénigrant Masha sur les réseaux sociaux.
L’avatar de l’esprit critique apparaît dès la page neuf, en colère contre Paul qui use d’insultes et de moqueries sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme joue le rôle de professeur qui se lance dans un exposé construit et structuré sur l’esprit critique. Paul intervient plus ou moins pour objecter avec une situation concrète ou une remarque, pour relancer en posant une question, parfois en essayant de mettre en pratique ce que l’esprit critique vient d’expliquer. Pour autant, le lecteur n’éprouve pas la sensation de se retrouver en classe, car les auteurs mettent à profit les spécificités de ce mode d’expression : mises en situation au budget illimité, retour dans le passé sans limite d’ancienneté, intervention de scientifiques et de chercheurs illustres, représentation d’expériences classiques, observations en direct de phénomènes naturels ou sociaux. Le lecteur ressent rapidement que l’ouvrage a été conçu comme une vraie bande dessinée, scénariste et dessinatrice concevant chaque séquence ensemble avec des constructions de séquence reposant autant sur l’exposé en paroles de l’esprit critique, que sur ce qui est montré dans les dessins. Le lecteur ressent également la variété des possibilités visuelles utilisées : êtres humains en train d’interagir, facsimilé d’une conversation en messages instantanés, réseau de neurones et de synapses, dragon crachant du feu, facsimilé de diagrammes, orbites de planètes, morceaux de puzzle, jeu de plateau pour les différentes étapes de la méthode scientifique moderne, fausses affiches de publicité, utilisation de personnalités diverses (de savants comme Galilée, à un présentateur télé comme John Oliver), logos de moteur de recherche scientifique, page de résultat google, onomatopée d’effets sonores, etc.
La découverte des principes de l’esprit critique se trouve ainsi incarnée au travers de Paul et de son avatar. Cette dernière rentre dans le vif du sujet avec la première évidence : une corrélation n’est pas une relation de cause à effet, citant quelques exemples remarquables et amusants, extraits de l’ouvrage Spurious correlations (2015), de Tyler Vigen. La dessinatrice reprend quatre exemples sous forme de graphique mettant en évidence des courbes similaires entre le montant des dépenses U.S. pour la science et le nombre de morts par pendaison, entre le nombre de noyades dans des piscines et le nombre de films où Nicolas Cage apparaît, entre le taux de divorce dans le Maine et la consommation de margarine, entre la consommation de fromage et le nombre de morts étouffés dans leurs draps. Suit un diagramme pour expliquer que par rapport à une moyenne, il y a autant d’individus en dessous qu’au-dessus. Sous réserve qu’il soit familier de cet auteur, le lecteur sourit en voyant Terry Pratchet (1948-2015) chevaucher une tortue dans le ciel pour donner sa définition de la science : c’est une méthode qui consiste à poser des interrogations gênantes et à les soumettre à l’épreuve de la réalité, évitant ainsi la propension de l’homme à croire ce qui lui fait du bien. À partir de la page vingt-trois, l’esprit critique se lance dans l’histoire chronologique des activités scientifiques : l’artiste représente alors des hommes des cavernes, des éléments mythologiques (scandinave, grec…). Puis viennent les premiers hommes célèbres pour leurs théories scientifiques : Pythagore Platon, Eudoxe de Cnide, Héraclide du Pont… jusqu’à arriver à Anaximandre de Milet (de -610 à -546), premier Grec connu à avoir tenté de décrire et d’expliquer l'origine et l'organisation de tous les aspects du monde de façon scientifique.
Le lecteur apprécie à sa juste valeur la qualité de l’exposé, à la fois pour sa narration animée, vivante et amusante, à la fois pour la clarté de chaque point développé. La première partie aboutit à une double page présentant les différentes étapes de la méthode scientifique : observation, hypothèses, expériences, théories, évaluation par les pairs. Puis les auteurs abordent la question des pseudo-sciences sous un angle critique (avec une petite pique contre la pseudo-science qui refuse de contredire les hypothèses d’un fondateur), les présentations manipulatrices pour parer de termes scientifiques sans en observer la méthode. Le lecteur découvre ensuite la longue liste des biais cognitifs, chacun illustré par un exemple ou une mise en situation très parlante : paréidolie, biais de statuquo, effet Dunning-Kruger, effet Barnum, illusion de savoir, erreur fondamentale d’attribution, effet de halo, illusion de corrélation, biais de négativité, biais d’omission, biais de projection, biais de confirmation, effet foule, biais de la tache aveugle, illusion de fréquence, autruche, biais de cadrage, biais d’ancrage, effet de l’humour, biais rétrospectif, biais de rationalisation, illusion de savoir, illusion de fréquence, biais de représentativité. En fonction de sa culture en la matière, le lecteur retrouve ou découvre des problématiques incontournables comme la charge de la preuve (l’absence de la preuve n’est pas la même chose que la preuve de l’absence), les cinq questions de base à se poser face à une information, les parasites argumentatifs (sophisme et paralogisme, avec leurs dérivés), le fait que toutes les hypothèses ne se valent pas (entre un avis et un consensus scientifique), que la réalité n’est pas un sondage, et que l’ouverture d’esprit n’est pas synonyme de relativisme. Ils vont jusqu’à aborder la place de la foi dans l’esprit critique, à nouveau sans mépris ou même condescendance, et le caractère indispensable des émotions comme moteur de la raison.
Quelle que soit sa familiarité avec l’esprit critique et la méthode scientifique, le lecteur se retrouve vite passionné par cet exposé à la forme enjoué et rigoureuse. La narration visuelle a été pensé pour participer à l’exposé en apportant elle aussi sa part d’informations, de façon diversifiée et adaptée à chaque développement. L’ouvrage présente les différentes facettes de l’esprit citrique, d’abord par la méthode scientifique, puis par les biais cognitifs, les effets de rhétorique, avec à chaque fois des exemples concrets et actuels. Le tout aboutit à une présentation cohérente de ce qu’est une démarche scientifique quel que soit l’objet de son étude, et observe des situations sociales et des communications de l’industrie du divertissement et de la société du spectacle à cette lumière. Indispensable.
Une jolie bande dessinée qui nous raconte le parcours d'une trentenaire qui en a marre des petits boulots et qui a envie de stabilité professionnelle.
Mais trouver un travail stable, ça veut dire aussi accepter des compromis avec ses valeurs, ses envies les plus profondes, en clair, devenir adulte et ça, ce n'est pas si simple.
Lisa a fait des études de lettres et elle aimerait travailler dans le monde de l'écrit, ce qui est un peu vague...
Elle vit une relation avec un jeune homme censé et cela va l'aider à prendre le temps de se poser les bonnes questions quant à son avenir.
Mais qu'est-ce qu'un job de rêve exactement ?
Et est-ton forcément heureux du matin au soir en toute circonstance ou chacun doit-il faire des tas de petites concessions pour parvenir à une qualité de vie correcte ?
J'ai trouvé touchante cette jeune femme qui est réaliste dans ses attentes mais qui trouve que la vie n'est quand même pas toujours faite pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule de la normalité.
Mais trouver un travail stable, ça veut dire aussi accepter des compromis avec ses valeurs, ses envies les plus profondes, en clair, devenir adulte et ça, ce n'est pas si simple.
Lisa a fait des études de lettres et elle aimerait travailler dans le monde de l'écrit, ce qui est un peu vague...
Elle vit une relation avec un jeune homme censé et cela va l'aider à prendre le temps de se poser les bonnes questions quant à son avenir.
Mais qu'est-ce qu'un job de rêve exactement ?
Et est-ton forcément heureux du matin au soir en toute circonstance ou chacun doit-il faire des tas de petites concessions pour parvenir à une qualité de vie correcte ?
J'ai trouvé touchante cette jeune femme qui est réaliste dans ses attentes mais qui trouve que la vie n'est quand même pas toujours faite pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule de la normalité.
Bienvenue au 28 Barbary Lane, Mary-Ann !
Pour qui s’est déjà aventuré dans l’œuvre abondante d’Armistead Maupin, ces quelques mots font immédiatement remonter en surface de délicieux souvenirs de lecture des Chroniques de San Francisco. Eh bien bonne nouvelle : l’adaptation graphique voit enfin le jour, fidèlement adaptée par Isabelle Bauthian et dessinée par Sandrine Revel.
Fidèlement, car dès les premières pages, l’univers des Chroniques est en place : l’arrivée de Mary-Ann, jeune fille rangée de l’Ohio choisissant de s’installer à Frisco, la ville qui décoince ; la pension d’Anna Madrigal et ses locataires Mona et Norman ; la famille Halcyon et ses secrets bien cachés ; et surtout, ce souffle libertaire qui souffle dans ces années 70 où les esprits se libèrent aussi vite que les mœurs, ouvrant la porte à toutes les rencontres, mais pas toujours à tous les possibles.
Un tome 1 qui en appelle d’autres à la suite (le fond ne manque pas…), en espérant une évolution de la tonalité graphique « tout public » vers un trait davantage marqué et en accord avec l’esprit sulfureux de l’époque et de Maupin, chantre de l’homosexualité libérée, affichée et assumée. Un marqueur de ses œuvres insuffisamment présent dans ce premier opus.
Pour qui s’est déjà aventuré dans l’œuvre abondante d’Armistead Maupin, ces quelques mots font immédiatement remonter en surface de délicieux souvenirs de lecture des Chroniques de San Francisco. Eh bien bonne nouvelle : l’adaptation graphique voit enfin le jour, fidèlement adaptée par Isabelle Bauthian et dessinée par Sandrine Revel.
Fidèlement, car dès les premières pages, l’univers des Chroniques est en place : l’arrivée de Mary-Ann, jeune fille rangée de l’Ohio choisissant de s’installer à Frisco, la ville qui décoince ; la pension d’Anna Madrigal et ses locataires Mona et Norman ; la famille Halcyon et ses secrets bien cachés ; et surtout, ce souffle libertaire qui souffle dans ces années 70 où les esprits se libèrent aussi vite que les mœurs, ouvrant la porte à toutes les rencontres, mais pas toujours à tous les possibles.
Un tome 1 qui en appelle d’autres à la suite (le fond ne manque pas…), en espérant une évolution de la tonalité graphique « tout public » vers un trait davantage marqué et en accord avec l’esprit sulfureux de l’époque et de Maupin, chantre de l’homosexualité libérée, affichée et assumée. Un marqueur de ses œuvres insuffisamment présent dans ce premier opus.
Le festival des Imaginales va avoir lieu du 25 au 28 mai à Épinal, sous une nouvelle direction artistique, celle de Gilles Francescano. Et l’anthologie qui lui correspond vient juste de sortir. L’occasion de découvrir des nouvelles francophones d’horizons très divers, qui mêlent plusieurs générations d’auteurices. Tout cela pour s’interroger sur notre avenir urbain.
Nouvelle direction, nouvel éditeur. Les Imaginales ont connu une passation de pouvoir assez agitée, avec des mois sombres et des reproches dans les deux camps. Difficile, de mon côté, de prendre parti pour l’un ou l’autre, même si Stéphanie Nicot avait été particulièrement convaincante. Mais là n’est plus le sujet. Je ne suis jamais allé à ce festival. Je me contente de lire les anthologies qui paraissent à l’occasion. Et de noter que les éditions Mnémos ont laissé la place, cette année, aux éditions Au diable vauvert. Plongeons-nous à présent dans le contenu de ce livre : 14 textes (et non nouvelles, j’en parlerai ensuite) précédés d’une préface. Du beau monde, assurément. Des auteurices plus anciens aux plus récents. Un sommaire alléchant.
Si j’ai aimé dans l’ensemble la lecture (rapide) de cette anthologie, je n’en ressors pas empli d’espoir pour l’avenir. La plupart des auteurs, même s’ils ont des points de vue très différents et des approches très variées, n’imaginent pas des cités épanouissantes pour l’être humain. Comme souvent dans le domaine de l’imaginaire, les auteurices cherchent à pointer ce qui fait mal : le passage du temps qui abîme (« Tokyo 2115 ») et détruit, parfois de façon définitive au détriment de l’humanité même qui a causé les dégâts (« Histoire de Rome de nos jours à la fondation », « Tempus edax, homo edacior ([In]dispensables) », « L’histoire des oiseaux ») ; la tentation des sociétés à se tourner, comme ultime réponse, vers la dictature, la tyrannie, la poigne d’un homme (rarement une femme) fort et sans pitié, au nom du bien commun, mais destructeur de toute individualité, de tout rêve, de tout espoir (« Entartage », « 2084 ») ; un duel entre hommes et machines, les I.A. prenant le pouvoir ou non, suivant les instructions des humains ou non (« Le dernier jour de Paris », « Histoire de Rome de nos jours à la fondation ») ; l’humain changeant de peau, car le corps que nous avons à notre naissance ne suffit pas ou ne correspond pas ce que nous avons dans la tête, et car la technique le permet dorénavant (« Garou 2.0 ») ; l’être humain continuant à cramer le monde et à user de ses semblables comme d’objets (« Mobipolis ») dans une cité délétère (« Kontrol’za kacestvom »). Seule Sara Doke, ou presque, apporte un léger rayon de soleil en évoquant, dans « Phra au soleil », une société qui pourrait respecter l’autre et se rapprocher de celle que je découvre ces mois-ci dans différentes lectures (Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, Cité d’ivoire de Jean Krug, Le monde de Julia d’Ugo Bellagamba & Jean Baret, Un psaume pour les recyclés sauvages et Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers et même Les terres closes de Robert Jackon Bennett). Un panorama incomplet, certes, mais riche d’images d’un monde futur.
Cette lecture du Futur de la cité a été très agréable, alternant entre le vraiment passionnant et l’anecdotique, comme souvent dans une anthologie. Certains textes m’ont surpris, d’autres m’ont juste distrait (ce qui est déjà très bien). J’ai aimé me projeter dans ces multiples avenirs ainsi proposés, imaginés. Un bon cru, comme on dit.
Comme d’habitude, j’ai parlé de chaque texte individuellement, mais comme c'est un peu long, je n'ai placé cette partie que sur mon blog.
Lien : https://lenocherdeslivres.wo..
Nouvelle direction, nouvel éditeur. Les Imaginales ont connu une passation de pouvoir assez agitée, avec des mois sombres et des reproches dans les deux camps. Difficile, de mon côté, de prendre parti pour l’un ou l’autre, même si Stéphanie Nicot avait été particulièrement convaincante. Mais là n’est plus le sujet. Je ne suis jamais allé à ce festival. Je me contente de lire les anthologies qui paraissent à l’occasion. Et de noter que les éditions Mnémos ont laissé la place, cette année, aux éditions Au diable vauvert. Plongeons-nous à présent dans le contenu de ce livre : 14 textes (et non nouvelles, j’en parlerai ensuite) précédés d’une préface. Du beau monde, assurément. Des auteurices plus anciens aux plus récents. Un sommaire alléchant.
Si j’ai aimé dans l’ensemble la lecture (rapide) de cette anthologie, je n’en ressors pas empli d’espoir pour l’avenir. La plupart des auteurs, même s’ils ont des points de vue très différents et des approches très variées, n’imaginent pas des cités épanouissantes pour l’être humain. Comme souvent dans le domaine de l’imaginaire, les auteurices cherchent à pointer ce qui fait mal : le passage du temps qui abîme (« Tokyo 2115 ») et détruit, parfois de façon définitive au détriment de l’humanité même qui a causé les dégâts (« Histoire de Rome de nos jours à la fondation », « Tempus edax, homo edacior ([In]dispensables) », « L’histoire des oiseaux ») ; la tentation des sociétés à se tourner, comme ultime réponse, vers la dictature, la tyrannie, la poigne d’un homme (rarement une femme) fort et sans pitié, au nom du bien commun, mais destructeur de toute individualité, de tout rêve, de tout espoir (« Entartage », « 2084 ») ; un duel entre hommes et machines, les I.A. prenant le pouvoir ou non, suivant les instructions des humains ou non (« Le dernier jour de Paris », « Histoire de Rome de nos jours à la fondation ») ; l’humain changeant de peau, car le corps que nous avons à notre naissance ne suffit pas ou ne correspond pas ce que nous avons dans la tête, et car la technique le permet dorénavant (« Garou 2.0 ») ; l’être humain continuant à cramer le monde et à user de ses semblables comme d’objets (« Mobipolis ») dans une cité délétère (« Kontrol’za kacestvom »). Seule Sara Doke, ou presque, apporte un léger rayon de soleil en évoquant, dans « Phra au soleil », une société qui pourrait respecter l’autre et se rapprocher de celle que je découvre ces mois-ci dans différentes lectures (Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, Cité d’ivoire de Jean Krug, Le monde de Julia d’Ugo Bellagamba & Jean Baret, Un psaume pour les recyclés sauvages et Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers et même Les terres closes de Robert Jackon Bennett). Un panorama incomplet, certes, mais riche d’images d’un monde futur.
Cette lecture du Futur de la cité a été très agréable, alternant entre le vraiment passionnant et l’anecdotique, comme souvent dans une anthologie. Certains textes m’ont surpris, d’autres m’ont juste distrait (ce qui est déjà très bien). J’ai aimé me projeter dans ces multiples avenirs ainsi proposés, imaginés. Un bon cru, comme on dit.
Comme d’habitude, j’ai parlé de chaque texte individuellement, mais comme c'est un peu long, je n'ai placé cette partie que sur mon blog.
Lien : https://lenocherdeslivres.wo..
De temps en temps, il y a encore d’irréductibles fans du livre qui montent de nouvelles librairies, de nouvelles maisons d’édition ou de nouvelles associations. En l’occurrence, à l’automne 2018, c’est une maison d’édition qui se monte autour d’un nouveau roman d’Isabelle Bauthian au titre alléchant, Face au dragon !
Une nouveauté un peu particulière
Face au dragon est ainsi le premier des Projets Sillex. Cette maison d’édition se fonde sur un credo attrayant : rémunérer davantage ceux qui sont à la base de la filière du livre, les auteurs. En cela, ils espèrent « faire des étincelles » et peut-être apporter leur contribution, notamment au mouvement #PayeTonAuteur encore très porteur cette année. Pour lancer cette publication, hors les services de presse envoyés ça et là (dont nous faisons partie, merci à eux), c’est par un financement participatif que ça se passe : d’ailleurs, même si ce roman est désormais certain d’être publié et diffusé, le financement participatif (via leur site, c’est important de le souligner) se poursuit jusqu’à la fin novembre 2018. Ce roman d’Isabelle Bauthian semble avoir particulièrement attiré leur attention, pour commencer par celui-ci : l’autrice, très reconnue en bande dessinée (Alyssa, Versipelle, Je ne me suis jamais sentie aussi belle, etc.), s’est lancée dans une série de fantasy chez ActuSF (Anasterry, Grish-Mère) et passe ici à la littérature jeunesse/young adult.
Un casting restreint, mais pêchu
Face au dragon compose un casting de cinq personnages principaux : le preux Olri, la débrouillarde Menine, l’explorateur Nigel, le serviable Simon et l’ingénue Poly(xène). C’est cette dernière la véritable héroïne et qui nous fait découvrir le décor un peu particulier du roman. Mal à l’aise à l’école et globalement dans son rapport aux autres, nous trouvons Poly déprimant et se minant. Errant dans la forêt près de chez elle, elle ne reconnaît plus son chemin (qu’elle connaît pourtant par cœur) et émerge dans un lieu boisé qui lui est inconnu. Sans accès au réseau, sans davantage de repères connus, Poly se fait surprendre par une bête et seul un jeune homme lui vient en aide. Celui-ci lui part d’un camp, d’une île… Bref, très vite dans l’action et dans l’étrange, le roman nous emmène à la suite de Poly dans un monde parallèle au nôtre où elle rencontre ce petit groupe de survivants tels les naufragés de la série Lost. Comme cela nous est dévoilé extrêmement vite, leur premier intérêt est qu’ils viennent tous d’époques différentes, au point d’être très complémentaires. Le tableau est complet quand l’héroïne comprend qu’elle se trouve bien dans un endroit « autre » habité par un bestiaire légèrement différent du nôtre…
Un roman plutôt young adult, voire pour adolescents
Avec sa couverture chatoyante et son héroïne engagée, Face au dragon se casera facilement sur les rayons littéraires dits « young adult ». Comme parfois dans cette littérature, les genres sont volontairement mélangés : ici, le début fait penser à un roman fantastique puisqu’on doute franchement de la réalité, puis on émerge dans un monde de fantasy où le dragon nous guette, et finalement la résolution pointe vers la science-fiction, même si toutes les réponses ne sont pas tout à fait dévoilées. L’histoire se veut très pédagogique, puisqu’un bon nombre d’action mène à des enseignements de bons sens, bien utiles, sur l’intérêt de connaître son propre corps, sur l’énorme avantage de collaborer avec ses semblables plus que de vouloir les dominer, sur bien d’autres choses encore, ce qui en fait sous bien des aspects un bon roman initiatique. Dans cette perspective, l’autrice se permet, et c’est agréable, d’aborder par petites touches quantité de sujets contemporains (racisme, sexisme, violence sociétale plus ou moins contenue, etc. ; pas trop féminisme par contre dans ce roman-ci) sans débarquer avec de trop gros sabots. Certains lecteurs pourront pointer certaines longueurs dans quelques dialogues, une fois passé le milieu du roman ; toutefois, c’est aussi une façon choisie pour que, davantage que l’action, l’intrigue tente continuellement de nous ramener vers la réflexion avant le combat. Même si es fils de l’intrigue peuvent se deviner une fois ce constat fait, la résolution est intéressante, parce qu’elle laisse tout de même des sujets à interprétation concernant l’existence de ce petit îlot particulier.
Face au dragon est donc une découverte intéressante, rafraîchissante et qui devrait donner de bonnes idées aux lecteurs young adult.
Une nouveauté un peu particulière
Face au dragon est ainsi le premier des Projets Sillex. Cette maison d’édition se fonde sur un credo attrayant : rémunérer davantage ceux qui sont à la base de la filière du livre, les auteurs. En cela, ils espèrent « faire des étincelles » et peut-être apporter leur contribution, notamment au mouvement #PayeTonAuteur encore très porteur cette année. Pour lancer cette publication, hors les services de presse envoyés ça et là (dont nous faisons partie, merci à eux), c’est par un financement participatif que ça se passe : d’ailleurs, même si ce roman est désormais certain d’être publié et diffusé, le financement participatif (via leur site, c’est important de le souligner) se poursuit jusqu’à la fin novembre 2018. Ce roman d’Isabelle Bauthian semble avoir particulièrement attiré leur attention, pour commencer par celui-ci : l’autrice, très reconnue en bande dessinée (Alyssa, Versipelle, Je ne me suis jamais sentie aussi belle, etc.), s’est lancée dans une série de fantasy chez ActuSF (Anasterry, Grish-Mère) et passe ici à la littérature jeunesse/young adult.
Un casting restreint, mais pêchu
Face au dragon compose un casting de cinq personnages principaux : le preux Olri, la débrouillarde Menine, l’explorateur Nigel, le serviable Simon et l’ingénue Poly(xène). C’est cette dernière la véritable héroïne et qui nous fait découvrir le décor un peu particulier du roman. Mal à l’aise à l’école et globalement dans son rapport aux autres, nous trouvons Poly déprimant et se minant. Errant dans la forêt près de chez elle, elle ne reconnaît plus son chemin (qu’elle connaît pourtant par cœur) et émerge dans un lieu boisé qui lui est inconnu. Sans accès au réseau, sans davantage de repères connus, Poly se fait surprendre par une bête et seul un jeune homme lui vient en aide. Celui-ci lui part d’un camp, d’une île… Bref, très vite dans l’action et dans l’étrange, le roman nous emmène à la suite de Poly dans un monde parallèle au nôtre où elle rencontre ce petit groupe de survivants tels les naufragés de la série Lost. Comme cela nous est dévoilé extrêmement vite, leur premier intérêt est qu’ils viennent tous d’époques différentes, au point d’être très complémentaires. Le tableau est complet quand l’héroïne comprend qu’elle se trouve bien dans un endroit « autre » habité par un bestiaire légèrement différent du nôtre…
Un roman plutôt young adult, voire pour adolescents
Avec sa couverture chatoyante et son héroïne engagée, Face au dragon se casera facilement sur les rayons littéraires dits « young adult ». Comme parfois dans cette littérature, les genres sont volontairement mélangés : ici, le début fait penser à un roman fantastique puisqu’on doute franchement de la réalité, puis on émerge dans un monde de fantasy où le dragon nous guette, et finalement la résolution pointe vers la science-fiction, même si toutes les réponses ne sont pas tout à fait dévoilées. L’histoire se veut très pédagogique, puisqu’un bon nombre d’action mène à des enseignements de bons sens, bien utiles, sur l’intérêt de connaître son propre corps, sur l’énorme avantage de collaborer avec ses semblables plus que de vouloir les dominer, sur bien d’autres choses encore, ce qui en fait sous bien des aspects un bon roman initiatique. Dans cette perspective, l’autrice se permet, et c’est agréable, d’aborder par petites touches quantité de sujets contemporains (racisme, sexisme, violence sociétale plus ou moins contenue, etc. ; pas trop féminisme par contre dans ce roman-ci) sans débarquer avec de trop gros sabots. Certains lecteurs pourront pointer certaines longueurs dans quelques dialogues, une fois passé le milieu du roman ; toutefois, c’est aussi une façon choisie pour que, davantage que l’action, l’intrigue tente continuellement de nous ramener vers la réflexion avant le combat. Même si es fils de l’intrigue peuvent se deviner une fois ce constat fait, la résolution est intéressante, parce qu’elle laisse tout de même des sujets à interprétation concernant l’existence de ce petit îlot particulier.
Face au dragon est donc une découverte intéressante, rafraîchissante et qui devrait donner de bonnes idées aux lecteurs young adult.
Contrairement à ma chère et tendre, j’ai tenté de lire Grish-Mère, d’Isabelle Bauthian chez les éditions ActuSF, sans avoir lu Anasterry (même autrice, même éditeur). Bien m’en a pris, puisque la lecture en est indépendante !
Un monde vaste porteur d’enjeux très proches des nôtres
Grish-Mère est le nom d’une des principautés composant une vaste presqu’île et qui se caractérise par un régime politique porté sur le matriarcat. Cette première mention n’est pas anodine, car cette baronnie coexiste avec des voisinages le plus souvent hostiles à cette vision de voir la société. Cette première prise de position touche à la fois l’intrigue et le décor. En effet, le lecteur va découvrir un monde volontairement construit pour se poser des questions sur son propre environnement social et politique au sens large ; mais cela est tout à fait oubliable si vous vous concentrez sur le fait que l’existence de ce matriarcat (ou tout autre élément de l’intrigue d’ailleurs…) n’est qu’un élément de fantasy parmi d’autres, au même titre qu’une certaine magie ou que des créatures fantastiques. C’est là tout l’avantage de la fantasy : elle fait semblant d’avancer masquée avec ses mondes imaginaires, mais elle comporte en fait diablement plus de thématiques à explorer qu’une littérature se voulant un simple reflet du réel.
Sylve, antihéros malgré lui
Dans ce roman, nous suivons le dénommé Sylve, factotum de son état. Factotum ? Non, ça ne vous dit rien ? C’est normal. Imaginez que pour contenter les grands nobles du continent, une école ait été montée pour former des serviteurs d’élite, des hommes ou des femmes qui excellent tant dans tous les domaines qu’ils sont à la fois des guerriers hors pair et des majordomes plus que zélés. Sylve est donc de ceux-là après achevé sa longue formation. Sauf qu’on ne le retrouve pas au service du noble chez qui il a été placé, mais en bien mauvaise posture, car il doit récupérer une relique dérobée sous son nez s’il veut un jour retrouver son honneur et donc sa place. Sylve nous fait alterner entre son enfance de héros, dans son « école de servitude », et son présent durant sa quête. Il cherche, il cherche encore l’objet de celle-ci, mais il finit constamment par se faire violemment avoir : pour un factotum renommé, il faut avouer que c’est incongru ! Il aimerait bien, et il se le dit très souvent, être plus proactif, mais malheureusement il passe son temps à réagir, tant il est obligé par ses antagonistes à s’adapter sans cesse. Galère après galère, il finit par être pris au piège par une guilde influente qui le mène au doigt et à l’œil dans les ruelles de Grish-Mère où il compte bien trouver ce qu’il cherche.
Un roman étonnant qu’il faut prendre le temps d’aborder
Grish-Mère est marquée par une assez longue entrée en matière : nous arrivons véritablement dans ce lieu qu’à partir de la centième page ; avant cela, nous découvrons le personnage central (« sa vie, son œuvre » globalement, à moins que ce ne soit « ses amis, ses amours, ses emmerdes »…), et ce d’une façon il nous apparaît vraiment omniprésent, puisque nous suivons tous ses faits et gestes, mais également ses moindres réflexions mentales. Il y a un but de la part de l’autrice à ainsi mettre lourdement en scène les pensées de Sylve. Il est en passe de voir son petit monde de factotum s’effondrer et suivre tout ce qui lui passe par la tête sera utile pour comprendre et appréhender ses éventuelles réflexions, irritantes ou non. Mais en tout cas, de fait, ce choix de début, alors même que les premières scènes sont plutôt enlevées et bien rythmées, peut surprendre le lecteur qui ne s’y attend pas. Par contre, une fois apprivoisé ce drôle de factotum, la liste se lit avec plaisir et nous mettons nos pas dans les siens en sachant qu’à chaque coin de rue de Grish-Mère un mauvais tour nous pend au nez.
Grish-Mère est donc une belle découverte, tant du point de vue du propos que du style de l’autrice, qui peut par contre surprendre négativement au départ si on ne comprend pas le but recherché.
Un monde vaste porteur d’enjeux très proches des nôtres
Grish-Mère est le nom d’une des principautés composant une vaste presqu’île et qui se caractérise par un régime politique porté sur le matriarcat. Cette première mention n’est pas anodine, car cette baronnie coexiste avec des voisinages le plus souvent hostiles à cette vision de voir la société. Cette première prise de position touche à la fois l’intrigue et le décor. En effet, le lecteur va découvrir un monde volontairement construit pour se poser des questions sur son propre environnement social et politique au sens large ; mais cela est tout à fait oubliable si vous vous concentrez sur le fait que l’existence de ce matriarcat (ou tout autre élément de l’intrigue d’ailleurs…) n’est qu’un élément de fantasy parmi d’autres, au même titre qu’une certaine magie ou que des créatures fantastiques. C’est là tout l’avantage de la fantasy : elle fait semblant d’avancer masquée avec ses mondes imaginaires, mais elle comporte en fait diablement plus de thématiques à explorer qu’une littérature se voulant un simple reflet du réel.
Sylve, antihéros malgré lui
Dans ce roman, nous suivons le dénommé Sylve, factotum de son état. Factotum ? Non, ça ne vous dit rien ? C’est normal. Imaginez que pour contenter les grands nobles du continent, une école ait été montée pour former des serviteurs d’élite, des hommes ou des femmes qui excellent tant dans tous les domaines qu’ils sont à la fois des guerriers hors pair et des majordomes plus que zélés. Sylve est donc de ceux-là après achevé sa longue formation. Sauf qu’on ne le retrouve pas au service du noble chez qui il a été placé, mais en bien mauvaise posture, car il doit récupérer une relique dérobée sous son nez s’il veut un jour retrouver son honneur et donc sa place. Sylve nous fait alterner entre son enfance de héros, dans son « école de servitude », et son présent durant sa quête. Il cherche, il cherche encore l’objet de celle-ci, mais il finit constamment par se faire violemment avoir : pour un factotum renommé, il faut avouer que c’est incongru ! Il aimerait bien, et il se le dit très souvent, être plus proactif, mais malheureusement il passe son temps à réagir, tant il est obligé par ses antagonistes à s’adapter sans cesse. Galère après galère, il finit par être pris au piège par une guilde influente qui le mène au doigt et à l’œil dans les ruelles de Grish-Mère où il compte bien trouver ce qu’il cherche.
Un roman étonnant qu’il faut prendre le temps d’aborder
Grish-Mère est marquée par une assez longue entrée en matière : nous arrivons véritablement dans ce lieu qu’à partir de la centième page ; avant cela, nous découvrons le personnage central (« sa vie, son œuvre » globalement, à moins que ce ne soit « ses amis, ses amours, ses emmerdes »…), et ce d’une façon il nous apparaît vraiment omniprésent, puisque nous suivons tous ses faits et gestes, mais également ses moindres réflexions mentales. Il y a un but de la part de l’autrice à ainsi mettre lourdement en scène les pensées de Sylve. Il est en passe de voir son petit monde de factotum s’effondrer et suivre tout ce qui lui passe par la tête sera utile pour comprendre et appréhender ses éventuelles réflexions, irritantes ou non. Mais en tout cas, de fait, ce choix de début, alors même que les premières scènes sont plutôt enlevées et bien rythmées, peut surprendre le lecteur qui ne s’y attend pas. Par contre, une fois apprivoisé ce drôle de factotum, la liste se lit avec plaisir et nous mettons nos pas dans les siens en sachant qu’à chaque coin de rue de Grish-Mère un mauvais tour nous pend au nez.
Grish-Mère est donc une belle découverte, tant du point de vue du propos que du style de l’autrice, qui peut par contre surprendre négativement au départ si on ne comprend pas le but recherché.
Après un premier tome de bonne facture paru en 2016 (« Anasterry »), Isabelle Bauthian revient en ce début d'année 2018 avec la deuxième version de sa série « Les Rhéteurs ». Un second tome qui peut se lire de manière totalement indépendante et qui ne posera donc aucun problème de compréhension majeur à ceux qui n'auraient pas le temps (ou l'envie) de lire le précédent opus. Le lecteur découvrant l'univers risque toutefois de passer à côté d'un certain nombre de références à des événements politiques ou des personnages déjà mis en scène qui ajoutent évidemment à la complexé, et donc à la qualité, de l'ensemble. Le roman met cette fois en scène un nouveau personnage, un certain Sylve, cherchant à échapper à ses anciens collègues factotums et à regagner son honneur perdu depuis qu'une de ses connaissances a volé un objet de grande valeur appartenant à son employeur. Factotums ? Des combattants redoutables et de grands érudits qui assument le rôle de domestiques auprès des plus grands seigneurs de Civilisation. Experts aussi bien dans l'art de la guerre que dans celui du pliage du linge, capables de mémoriser des siècles d'histoire et d'apprendre des dizaines de langues, les factotums constituent la crème de la crème des serviteurs. « Des guerriers d'intérieur ! », se moquent leurs détracteurs. « Les serviteurs idéaux ! », rétorque l’école de Landor qui s'occupe depuis des décennies de la formation des candidats aspirant au prestigieux statut. Seulement les honneurs et le respect, c'est bel et bien terminé pour Sylve à qui ses anciens professeurs entendent bien faire payer sa négligence ayant entaché la réputation de l'ordre. La seule chance de salut de notre héros consiste à remettre la main sur l'objet volé ainsi que sur son voleur, envers lequel il éprouve malheureusement des sentiments ambigus qui n'ont pas tous à voir avec la haine... Déjà compliquée, la situation du pauvre homme va de plus considérablement se corser lorsqu'il va se retrouver embarqué bien malgré lui dans les combines politiques du retors chef de la Guilde des Épices.
Après Anasterry, place donc à Grish-Mère, une autre baronnie qui constitue le principal décor de ce second tome. Le récit alterne entre chapitres au présent relatant la quête de Sylve pour se dépatouiller de tous ses ennemis, et passages au passé dans lesquels on découvre son enfance et le contenu de sa formation de factotum à Landor. L'alternance est bien dosée et permet au roman d'évoluer selon un rythme enlevé. L'auteur ne se prive d'ailleurs pas de jouer avec le parallèle entre événements passés et présents afin de rehausser le potentiel dramatique de telle scène ou surprendre plus sûrement encore le lecteur lors d'une révélation. L'intrigue est maîtrisée de bout en bout et promet de jolies surprises, qui sont cela dit loin de constituer le seul et unique atout de ce roman qui se révèle à mon sens bien meilleur que le premier (qui était pourtant déjà fort sympathique). Parmi les points positifs de cette série, on peut sans aucun doute mentionner la qualité de son univers qui, sans être d'une complexité folle, n'en demeure pas moins suffisamment riche pour entretenir la curiosité du lecteur. L'action des deux premiers tomes (et vraisemblablement des suivants) se déroule dans un royaume baptisé de manière fort objective « Civilisation », lui même composé de quatre baronnies et d'un gouvernement central qui ne gère de toute évidence plus grand chose. Chacune de ces baronnies possède un système politique sensiblement différent que l'auteur se propose de nous faire découvrir, Grish-Mère succédant ici à l'utopique Anasterry. On ne sait rien, ou presque, de ce qui se passe en dehors des frontières de Civilisation, si ce n'est que les personnages font souvent référence à une guerre de grande ampleur les ayant opposé à leurs voisins et dont la paix qui a suivi a permis l'essor des guildes. Parmi celles ayant le vent en poupe, on trouve notamment la Guilde des Épices à la tête de laquelle on retrouve le jeune Thélban Acremont, le charismatique compagnon d'arme du prince de Montès déjà mis en scène dans Anasterry. On comprend vite que le personnage occupe une place centrale dans les événements politiques qui menacent de bouleverser l'équilibre du royaume (notamment en matière d'armement), mais l'auteur ne nous donne pas encore toutes les clés pour cerner les véritables enjeux.
La majorité de l'action se déroule ici dans la baronnie qui donne son nom au roman, Grish-Mère, une région qui se distingue des autres par bien des aspects, à commencer par son décor. Il s'agit en effet de la seule baronnie insulaire de Civilisation, isolée du reste du continent par la mer qui ne se retire que quelques fois par mois pour permettre aux caravanes et voyageurs d'emprunter la route menant à l'île principale. Autre élément intéressant (qui peut paraître anecdotique mais qui aura son importance) : l'existence de failles à la taille et au potentiel destructeur varié, capables d'engloutir les passants distraits ayant eu le malheur de poser le pied sur l'une d'elles. La plus grande originalité de Grish-Mère vient cela dit moins de son décor que de son organisation politique puisque on a affaire à une baronnie gérée par des femmes, pour les femmes. Comment cela se traduit-il concrètement ? D'abord, ce sont des femmes qui occupent tous les postes clés de la cité, non seulement à la tête de la baronnie mais également dans les différents corps de métier. Le culte de la Déesse-Mère, également vénérée dans les autres baronnies, est également célébré par un clergé exclusivement féminin et les rituels pratiqués le sont en fonction du cycle féminin (menstruations, grossesse...). Bref, les femmes ont la conquête totale de l'espace public où elles ne subissent aucune violence d'aucune sorte par les hommes : pas de paroles dégradantes, pas de gestes déplacés, et encore moins de viols. Ce pouvoir donné aux femmes passe aussi par l'appropriation du langage par les habitantes de Grish-Mère qui optent pour une féminisation des mots (on ne dit pas « gens » mais « gentes » ; le féminin l'importe sur le masculin d'un point de vue grammatical...). Le procédé aurait pu se révéler très indigeste, mais l'auteur s'y prend avec suffisamment d'habilité pour que cela ne devienne pas redondant et que cela ne gène pas la fluidité de la lecture (à titre de comparaison, j'ai trouvé ma lecture de certains passages du dernier roman de Jeanne A. Debats en écriture inclusive beaucoup plus désagréable à lire). Les réflexions de l'auteur autour de la place de la femme dans la société et l'importance de remettre en cause les clichés et comportements sexistes font évidemment fortement échos à notre actualité, et c'est à mon sens l'une des plus grandes réussites de ce roman. Le sujet n'était pourtant pas évident à traiter, et si l'auteur parvient à échapper aux écueils typiques de ce genre de d'exercices, c'est avant tout parce qu'on découvre cette baronnie par les yeux du narrateur qui (et c'est le moins qu'on puisse dire !) ne voit pas du tout d'un bon œil ce renversement de la « hiérarchie des sexes ». Loin d'être bluffé ou admiratif par les particularités de Grish-Mère, le personnage fait preuve d'un esprit critique qui frôle bien souvent la mauvaise foi mais qui permet au lecteur de repérer les travers de cette société certes féminine mais pas féministe.
Le regard très critique posé par Sylve est cela dit contrebalancé par la personnalité franchement déplaisante du personnage. Résolument machiste (il s'insurge de voir des femmes se promener dans la rue avec des cheveux courts ou des tenues moulantes), notre narrateur est de plus raciste et homophobe. Sylve ne cache en effet pas son aversion pour les dilués (comprenez les anciens adversaires de Civilisation ayant été altérés par la magie) et n'a pas de mots assez forts pour manifester son dégoût des hommes qu'il estime manquer de virilité (« tantouze », « tapette », les expressions de ce type sont légion). On pourrait se dire que tant d'intolérance rendrait le personnage franchement détestable et que le lecteur éprouverait pour lui une telle antipathie qu'il serait incapable de s'intéresser à son histoire, seulement là encore, l'auteur fait preuve de beaucoup de finesse, décortiquant les raisons qui poussent le personnage à adopter un tel comportement (peur et frustration, le duo gagnant). En dépit de tous ses défauts (pourtant franchement rédhibitoires !), Sylve se révèle malgré tout attachant, et ce par bien des aspects. Cela tient d'abord à sa façon de s'exprimer qui varie en fonction de si le personnage s'adresse à autrui ou se parle à lui-même. Dans le premier cas, Sylve fait preuve d'une politesse impeccable et use d'un langage très soutenu à la limite de l’obséquiosité. Dans le second, il ne se prive pas de dévoiler ses véritables sentiments avec un langage cru et une gouaille qui donne lieu à des passages savoureux qui ne manqueront pas de faire sourire le lecteur. C'est du contraste entre les deux niveaux de langage que naît l'humour qui permet de voir le personnage sous un jour plus sympathique. Mais l'attachement du lecteur provient aussi et surtout de la sacrée évolution de Sylve tout au long du roman, le personnage des dernières pages n'ayant plus grand chose à voir avec l'abruti arrogant, moralisateur et pétri de stéréotypes des premières pages. Ce long cheminement intérieur, Sylve le doit aussi bien aux événements auxquels il se trouve mêlé qu'aux personnages auxquels il se trouve confronté. Parmi les influences décisives sur le jeune homme, on peut notamment citer deux personnages déjà connus des lecteurs d'Anasterry et qu'on retrouve ici avec un grand plaisir : le chef de guide Thélban et la guerrière Constance.
Isabelle Bauthian signe avec ce second tome des « Rhéteurs » un très bon roman à la lecture duquel je ressors totalement conquise. Bien plus maîtrisé qu'« Anasterry », « Grish-Mère » met en scène un personnage complexe qu'on aimerait détesté sans pouvoir s'y résoudre, le tout dans un décor qui permet à l'auteur d'explorer plus précisément la politique de son univers tout en traitant de questions d'actualité qu'on a plaisir à voir ainsi décortiquées dans un roman de fantasy. Inutile de vous dire que j'ai hâte de lire la suite qui se focalisera cette fois sur une autre baronnie dont il a déjà été question dans Anastery, celle de Montès. Une belle découverte, que je vous recommande chaudement.
Après Anasterry, place donc à Grish-Mère, une autre baronnie qui constitue le principal décor de ce second tome. Le récit alterne entre chapitres au présent relatant la quête de Sylve pour se dépatouiller de tous ses ennemis, et passages au passé dans lesquels on découvre son enfance et le contenu de sa formation de factotum à Landor. L'alternance est bien dosée et permet au roman d'évoluer selon un rythme enlevé. L'auteur ne se prive d'ailleurs pas de jouer avec le parallèle entre événements passés et présents afin de rehausser le potentiel dramatique de telle scène ou surprendre plus sûrement encore le lecteur lors d'une révélation. L'intrigue est maîtrisée de bout en bout et promet de jolies surprises, qui sont cela dit loin de constituer le seul et unique atout de ce roman qui se révèle à mon sens bien meilleur que le premier (qui était pourtant déjà fort sympathique). Parmi les points positifs de cette série, on peut sans aucun doute mentionner la qualité de son univers qui, sans être d'une complexité folle, n'en demeure pas moins suffisamment riche pour entretenir la curiosité du lecteur. L'action des deux premiers tomes (et vraisemblablement des suivants) se déroule dans un royaume baptisé de manière fort objective « Civilisation », lui même composé de quatre baronnies et d'un gouvernement central qui ne gère de toute évidence plus grand chose. Chacune de ces baronnies possède un système politique sensiblement différent que l'auteur se propose de nous faire découvrir, Grish-Mère succédant ici à l'utopique Anasterry. On ne sait rien, ou presque, de ce qui se passe en dehors des frontières de Civilisation, si ce n'est que les personnages font souvent référence à une guerre de grande ampleur les ayant opposé à leurs voisins et dont la paix qui a suivi a permis l'essor des guildes. Parmi celles ayant le vent en poupe, on trouve notamment la Guilde des Épices à la tête de laquelle on retrouve le jeune Thélban Acremont, le charismatique compagnon d'arme du prince de Montès déjà mis en scène dans Anasterry. On comprend vite que le personnage occupe une place centrale dans les événements politiques qui menacent de bouleverser l'équilibre du royaume (notamment en matière d'armement), mais l'auteur ne nous donne pas encore toutes les clés pour cerner les véritables enjeux.
La majorité de l'action se déroule ici dans la baronnie qui donne son nom au roman, Grish-Mère, une région qui se distingue des autres par bien des aspects, à commencer par son décor. Il s'agit en effet de la seule baronnie insulaire de Civilisation, isolée du reste du continent par la mer qui ne se retire que quelques fois par mois pour permettre aux caravanes et voyageurs d'emprunter la route menant à l'île principale. Autre élément intéressant (qui peut paraître anecdotique mais qui aura son importance) : l'existence de failles à la taille et au potentiel destructeur varié, capables d'engloutir les passants distraits ayant eu le malheur de poser le pied sur l'une d'elles. La plus grande originalité de Grish-Mère vient cela dit moins de son décor que de son organisation politique puisque on a affaire à une baronnie gérée par des femmes, pour les femmes. Comment cela se traduit-il concrètement ? D'abord, ce sont des femmes qui occupent tous les postes clés de la cité, non seulement à la tête de la baronnie mais également dans les différents corps de métier. Le culte de la Déesse-Mère, également vénérée dans les autres baronnies, est également célébré par un clergé exclusivement féminin et les rituels pratiqués le sont en fonction du cycle féminin (menstruations, grossesse...). Bref, les femmes ont la conquête totale de l'espace public où elles ne subissent aucune violence d'aucune sorte par les hommes : pas de paroles dégradantes, pas de gestes déplacés, et encore moins de viols. Ce pouvoir donné aux femmes passe aussi par l'appropriation du langage par les habitantes de Grish-Mère qui optent pour une féminisation des mots (on ne dit pas « gens » mais « gentes » ; le féminin l'importe sur le masculin d'un point de vue grammatical...). Le procédé aurait pu se révéler très indigeste, mais l'auteur s'y prend avec suffisamment d'habilité pour que cela ne devienne pas redondant et que cela ne gène pas la fluidité de la lecture (à titre de comparaison, j'ai trouvé ma lecture de certains passages du dernier roman de Jeanne A. Debats en écriture inclusive beaucoup plus désagréable à lire). Les réflexions de l'auteur autour de la place de la femme dans la société et l'importance de remettre en cause les clichés et comportements sexistes font évidemment fortement échos à notre actualité, et c'est à mon sens l'une des plus grandes réussites de ce roman. Le sujet n'était pourtant pas évident à traiter, et si l'auteur parvient à échapper aux écueils typiques de ce genre de d'exercices, c'est avant tout parce qu'on découvre cette baronnie par les yeux du narrateur qui (et c'est le moins qu'on puisse dire !) ne voit pas du tout d'un bon œil ce renversement de la « hiérarchie des sexes ». Loin d'être bluffé ou admiratif par les particularités de Grish-Mère, le personnage fait preuve d'un esprit critique qui frôle bien souvent la mauvaise foi mais qui permet au lecteur de repérer les travers de cette société certes féminine mais pas féministe.
Le regard très critique posé par Sylve est cela dit contrebalancé par la personnalité franchement déplaisante du personnage. Résolument machiste (il s'insurge de voir des femmes se promener dans la rue avec des cheveux courts ou des tenues moulantes), notre narrateur est de plus raciste et homophobe. Sylve ne cache en effet pas son aversion pour les dilués (comprenez les anciens adversaires de Civilisation ayant été altérés par la magie) et n'a pas de mots assez forts pour manifester son dégoût des hommes qu'il estime manquer de virilité (« tantouze », « tapette », les expressions de ce type sont légion). On pourrait se dire que tant d'intolérance rendrait le personnage franchement détestable et que le lecteur éprouverait pour lui une telle antipathie qu'il serait incapable de s'intéresser à son histoire, seulement là encore, l'auteur fait preuve de beaucoup de finesse, décortiquant les raisons qui poussent le personnage à adopter un tel comportement (peur et frustration, le duo gagnant). En dépit de tous ses défauts (pourtant franchement rédhibitoires !), Sylve se révèle malgré tout attachant, et ce par bien des aspects. Cela tient d'abord à sa façon de s'exprimer qui varie en fonction de si le personnage s'adresse à autrui ou se parle à lui-même. Dans le premier cas, Sylve fait preuve d'une politesse impeccable et use d'un langage très soutenu à la limite de l’obséquiosité. Dans le second, il ne se prive pas de dévoiler ses véritables sentiments avec un langage cru et une gouaille qui donne lieu à des passages savoureux qui ne manqueront pas de faire sourire le lecteur. C'est du contraste entre les deux niveaux de langage que naît l'humour qui permet de voir le personnage sous un jour plus sympathique. Mais l'attachement du lecteur provient aussi et surtout de la sacrée évolution de Sylve tout au long du roman, le personnage des dernières pages n'ayant plus grand chose à voir avec l'abruti arrogant, moralisateur et pétri de stéréotypes des premières pages. Ce long cheminement intérieur, Sylve le doit aussi bien aux événements auxquels il se trouve mêlé qu'aux personnages auxquels il se trouve confronté. Parmi les influences décisives sur le jeune homme, on peut notamment citer deux personnages déjà connus des lecteurs d'Anasterry et qu'on retrouve ici avec un grand plaisir : le chef de guide Thélban et la guerrière Constance.
Isabelle Bauthian signe avec ce second tome des « Rhéteurs » un très bon roman à la lecture duquel je ressors totalement conquise. Bien plus maîtrisé qu'« Anasterry », « Grish-Mère » met en scène un personnage complexe qu'on aimerait détesté sans pouvoir s'y résoudre, le tout dans un décor qui permet à l'auteur d'explorer plus précisément la politique de son univers tout en traitant de questions d'actualité qu'on a plaisir à voir ainsi décortiquées dans un roman de fantasy. Inutile de vous dire que j'ai hâte de lire la suite qui se focalisera cette fois sur une autre baronnie dont il a déjà été question dans Anastery, celle de Montès. Une belle découverte, que je vous recommande chaudement.
Voilà une bande dessinée vachement intéressante, qui essaie d’éveiller notre esprit critique ! On part d’une situation banale : Paul fait un repas avec ses amis. Mais voilà qu’il s’énerve contre une femme qui prétend avoir vu des fées, parce que, enfin, c’est complètement impossible !
Et le soir même, il reçoit la visite de quelqu’un d’un peu spécial… l’Esprit Critique. Représenté par une jeune femme aux cheveux roses, l’esprit critique va d’abord nous faire remonter dans le temps afin de comprendre ce qu’est la pensée/méthode scientifique, avant de nous présenter tout un tas de biais cognitifs, qui pourraient biaiser notre esprit critique justement.
~
C’était vraiment très intéressant, d’un point de vue culture G, ou éveil de l’esprit critique, forcément ! Les dessins en plus sont sympathiques, vifs et colorés.
Bon, on va pas se mentir, c’est un poil complexe, donc soyez bien concentré si vous voulez tout comprendre, et pas seulement survoler. Ce n’est donc pas trop un ouvrage pour les trop jeunes enfants, dès 15/16 ans c’est pas mal je pense… puis c’est à cet âge-là qu’on doit s’ouvrir un peu la tête !
Je regrette cependant l’effet légèrement « liste de course » qu’on peut trouver à la fin, lorsque sont présentés les biais cognitifs, par exemple. Mais après, j’avoue, l’ouvrage aurait vraiment été long avec un développement approfondi !
Enfin, j’ai adoré le concept de mettre un petit jeu à la fin, pour vérifier si on avait tout bien compris :)
~
Bref, c’était très instructif, mais concentrez-vous ;)
Et le soir même, il reçoit la visite de quelqu’un d’un peu spécial… l’Esprit Critique. Représenté par une jeune femme aux cheveux roses, l’esprit critique va d’abord nous faire remonter dans le temps afin de comprendre ce qu’est la pensée/méthode scientifique, avant de nous présenter tout un tas de biais cognitifs, qui pourraient biaiser notre esprit critique justement.
~
C’était vraiment très intéressant, d’un point de vue culture G, ou éveil de l’esprit critique, forcément ! Les dessins en plus sont sympathiques, vifs et colorés.
Bon, on va pas se mentir, c’est un poil complexe, donc soyez bien concentré si vous voulez tout comprendre, et pas seulement survoler. Ce n’est donc pas trop un ouvrage pour les trop jeunes enfants, dès 15/16 ans c’est pas mal je pense… puis c’est à cet âge-là qu’on doit s’ouvrir un peu la tête !
Je regrette cependant l’effet légèrement « liste de course » qu’on peut trouver à la fin, lorsque sont présentés les biais cognitifs, par exemple. Mais après, j’avoue, l’ouvrage aurait vraiment été long avec un développement approfondi !
Enfin, j’ai adoré le concept de mettre un petit jeu à la fin, pour vérifier si on avait tout bien compris :)
~
Bref, c’était très instructif, mais concentrez-vous ;)
En 1976, Amistead Maupain se lanca avec ses chroniques de San Fransico dans un projet dense et ambitieux, dresser le portrait d'une certaine jeunesse américaine des années 70: sexe, drogue, mensonges et (des) illusions..
Un projet qui nous plonge au coeur de San Francisco, symbole de la révolution sexuelle, de l'explosion des moeurs et de la « branchitude » post-hippie des années 70-80.
Son oeuvre littéraire devient rapidement culte notamment auprès de la communauté homosexuelle car à l'époque, mentionner ouvertement l’homosexualité auprès du grand-public, même dans une ville aussi libérale que San Francisco, n’est pas de l’ordre de l’habituel et Armistead Maupin le faisait alors sans aucun complexe ni ambiguité.
planches
Cette toute première adaptation en BD des romans d’Armistead Maupin, scénarisée par Isabelle Bauthian et illustrée par Sandrine Revel, relève très joliment le défi , notamment avec ce premier tome d'une saga/ roman graphique qui pourrait comporter de nombreux tomes .
La transposition s'avère assez fidèle à l'oeuvre originale , parsemé de quelques clins d'oeils bien sympathiques et trouvailles narratives qui plaira aux inconditionnels des romans originaux.
Le dessin sobre, et plein de couleur chatoyante de Sandrine Revel contribue de rendre ce projet emballant et réussi de bout en bout !
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Un projet qui nous plonge au coeur de San Francisco, symbole de la révolution sexuelle, de l'explosion des moeurs et de la « branchitude » post-hippie des années 70-80.
Son oeuvre littéraire devient rapidement culte notamment auprès de la communauté homosexuelle car à l'époque, mentionner ouvertement l’homosexualité auprès du grand-public, même dans une ville aussi libérale que San Francisco, n’est pas de l’ordre de l’habituel et Armistead Maupin le faisait alors sans aucun complexe ni ambiguité.
planches
Cette toute première adaptation en BD des romans d’Armistead Maupin, scénarisée par Isabelle Bauthian et illustrée par Sandrine Revel, relève très joliment le défi , notamment avec ce premier tome d'une saga/ roman graphique qui pourrait comporter de nombreux tomes .
La transposition s'avère assez fidèle à l'oeuvre originale , parsemé de quelques clins d'oeils bien sympathiques et trouvailles narratives qui plaira aux inconditionnels des romans originaux.
Le dessin sobre, et plein de couleur chatoyante de Sandrine Revel contribue de rendre ce projet emballant et réussi de bout en bout !
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Dans le royaume de Civilisation, la cité d'Anasterry fait un peu figure d'ovni. Alors que la plupart des autres baronnies ont opté pour un fonctionnement relativement proche du système féodal, Anasterry, elle, lorgne du côté de l'utopie. Égalité entre les hommes, éducation du peuple, bienveillance envers les autres races pourtant pourchassées partout ailleurs... : si la tolérance dont fait preuve le baron local suscite l'admiration de son peuple elle s'accompagne surtout d'une certaine méfiance de la part des autres dirigeants. Ce ne sont pourtant pas les ennemis de l'extérieur que devrait craindre la prospère baronnie, mais bel et bien ceux qui se cachent en son sein. Chargée d'inaugurer la toute nouvelle collection Bad Wolf publiée par ActuSF, Isabelle Bauthian signe avec ce premier tome des « Rhéteurs » un premier roman divertissant qui dispose de solides qualités. Sans être d'une originalité exceptionnelle, l'univers dépeint par l'auteur se révèle suffisamment consistant pour que le lecteur ait envie d'y poursuivre son incursion. C'est déjà plutôt bon signe. Les personnages ne sont pas mal campés non plus, même si le petit Renaldo ne partait pas franchement gagnant. Hautain, obtus, un brin chouinard... : les premières pages en compagnie du héros ne participent pas à nous le rendre sympathique (on est alors tenté de penser au « Eos » paru chez Mnémos en début d'année).
Le protagoniste d'Isabelle Bauthian se décoince fort heureusement assez vite et gagne en profondeur au fil des chapitres qui proposent à plusieurs reprises des flash-back censés nous en apprendre un peu plus sur la personnalité du jeune homme. Celui-ci fait cela dit pâle figure comparé à son acolyte, figure d'ordinaire assez secondaire mais qui, ici, constitue à mon sens le principal atout du roman. Toutes proportions gardées, on retrouve en ce jeune chef de guilde un peu du Fou de Robin Hobb, personnage emblématique de l'Assassin royal (le physique avantageux en moins). Drôle, incisif, redoutablement intelligent, faussement désinvolte, volontairement provocateur, le personnage possède un sacré charisme et pose un regard acéré sur le monde qui l'entoure, le faisant ainsi gagner en profondeur. Les autres personnages sont un peu moins marquants et auraient sans doute mérité d'être davantage étoffés mais tiennent néanmoins leur rôle. L'intrigue est en revanche un peu plus faiblarde, d'abord parce qu'elle manque légèrement d'ampleur et de rythme, mais surtout parce qu'elle se révèle trop prévisible, et ce dès le début du roman. La fin ouvre malgré tout d'intéressantes perspectives pour la suite qui s'annonce plus corsée et dont l'intrigue devrait cette fois se jouer à une plus grande échelle.
Isabelle Bauthian signe avec « Anasterry » un premier roman solide et plaisant qui pose les bases d'un univers et de personnalités intéressants qui devraient progressivement s'enrichir. Un début prometteur... affaire à suivre !
Le protagoniste d'Isabelle Bauthian se décoince fort heureusement assez vite et gagne en profondeur au fil des chapitres qui proposent à plusieurs reprises des flash-back censés nous en apprendre un peu plus sur la personnalité du jeune homme. Celui-ci fait cela dit pâle figure comparé à son acolyte, figure d'ordinaire assez secondaire mais qui, ici, constitue à mon sens le principal atout du roman. Toutes proportions gardées, on retrouve en ce jeune chef de guilde un peu du Fou de Robin Hobb, personnage emblématique de l'Assassin royal (le physique avantageux en moins). Drôle, incisif, redoutablement intelligent, faussement désinvolte, volontairement provocateur, le personnage possède un sacré charisme et pose un regard acéré sur le monde qui l'entoure, le faisant ainsi gagner en profondeur. Les autres personnages sont un peu moins marquants et auraient sans doute mérité d'être davantage étoffés mais tiennent néanmoins leur rôle. L'intrigue est en revanche un peu plus faiblarde, d'abord parce qu'elle manque légèrement d'ampleur et de rythme, mais surtout parce qu'elle se révèle trop prévisible, et ce dès le début du roman. La fin ouvre malgré tout d'intéressantes perspectives pour la suite qui s'annonce plus corsée et dont l'intrigue devrait cette fois se jouer à une plus grande échelle.
Isabelle Bauthian signe avec « Anasterry » un premier roman solide et plaisant qui pose les bases d'un univers et de personnalités intéressants qui devraient progressivement s'enrichir. Un début prometteur... affaire à suivre !
En Résumé : J’ai passé un moment de lecture très sympathique avec ce roman dont l’intrigue peut, aux premiers abords, être classique mais dont l’auteur ne fait finalement que se servir pour nous faire réfléchir. En effet elle soulève ainsi au fil des pages de nombreuses réflexions que ce soit sur notre façon de traiter les autres, les étrangers, le pouvoir, la position de la femme ou bien encore, même si c’est un peu binaire, le parallèle entre un pouvoir plus « féodal » et un autre qui cherche l’égalité. Alors parfois ça manque de finesse, certains arguments donnent l’impression de tourner en rond ou d’être répétitifs, mais dans l’ensemble j’ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Dommage que j’ai trouvé l’intrigue de fond facilement devinable, ce qui joue obligatoirement sur le rythme et les surprises. L’univers s’avère solide et intéressant à découvrir, gardant tout de même quelques mystères pour les suites, comme principalement cette révélation sur la fin qui me donne envie d’en savoir plus. Les personnages sont intéressant à suivre que ce soit dans leurs idéologies comme dans leurs façon d’évoluer. Seul Renaldo m’a un peu moins accroché tant le décalage entre son passé et son présent me laisse perplexe. La plume de l’auteur est entraînante, fluide et efficace et je me laisserai assez facilement tenter par la suite.
Retrouvez ma chronique complète sur mon blog.
Lien : http://www.blog-o-livre.com/..
Retrouvez ma chronique complète sur mon blog.
Lien : http://www.blog-o-livre.com/..
Une B.D. passionnante qui retrace une partie de la vie du docteur James Barry, femme médecin militaire se cachant sous une identité d'homme.
Nous l'accompagnons dans ses combats pour améliorer les normes sanitaires dans les colonies et pour améliorer la pratique médicale (elle y apporte humanité, écoute, compétences). En parallèle nous découvrons progressivement et à rebours son parcours depuis ses 13 ans, pourquoi et comment elle a changé d'identité.
Cette double intrigue insuffle de l'intéret supplémentaire pour suivre ce parcours hors du commun.
Unique bémol: je n'aime pas le graphisme peu clair et les couleurs "mal étalées" selon moi, qui ne me permettent pas de distinguer les différents personnages les uns des autres.
Les visages des personnages principaux auraient gagné à plus de précision pour etre davantage expressifs. Ils demeurent trop neutres à mon gout.
Cela reste une très bonne B.D. qui remet en lumière un destin de femme extraordinaire.
Nous l'accompagnons dans ses combats pour améliorer les normes sanitaires dans les colonies et pour améliorer la pratique médicale (elle y apporte humanité, écoute, compétences). En parallèle nous découvrons progressivement et à rebours son parcours depuis ses 13 ans, pourquoi et comment elle a changé d'identité.
Cette double intrigue insuffle de l'intéret supplémentaire pour suivre ce parcours hors du commun.
Unique bémol: je n'aime pas le graphisme peu clair et les couleurs "mal étalées" selon moi, qui ne me permettent pas de distinguer les différents personnages les uns des autres.
Les visages des personnages principaux auraient gagné à plus de précision pour etre davantage expressifs. Ils demeurent trop neutres à mon gout.
Cela reste une très bonne B.D. qui remet en lumière un destin de femme extraordinaire.
Factotum n.m. (lat facere, faire, et totum, tout). Personne qui s'occupe un peu de tout, notamment des travaux mineurs.
Petit Larousse Illustré.
Définition qui correspond exactement à Sylve, factotum de son état. Une Personne qui s'occupe de tout, certes, mais à un niveau d'expertise inégalé que ce soit pour organiser le diner ou pour combattre des ennemis. C'est dire si la déchéance est grande si l'on met en doute son honneur!
Je remercie l'éditeur ActuSF et Babelio pour l'envoi de ce livre m'ayant permis une très agréable découverte. Il est vrai que lorsque que je l'ai sélectionné dans la liste Masse Critique, je n'avais absolument pas vu que c'était un tome 2. D'ailleurs ce n'est pas du tout mis sur la couverture. Une raison à cela je pense, c'est que ça se lit de façon totalement indépendante. Enfin il me semble vu que je n'ai pas lu le tome un. Peut être que les lecteurs du tome 1 comprendront plus vite certains points de l'univers. C'est vrai que j'ai mis plusieurs chapitres avant de comprendre le fonctionnement de Civilisation et de ses différentes baronnies, que j'ai mis du temps à comprendre qu'est ce que c'était un "mi-homme" et qu'elle forme prenait la magie. Mais rien d'insurmontable.
J'ai bien aimé cet univers, un peu original, de Civilisation. Le pays se compose de 5 baronnies. Anasterry faisait l'objet du premier tome, on s'intéresse ici à Grish-mère. Une baronnie féministe et matriarcale, un peu à l'image des amazones. Un prétexte pour nous faire réfléchir sur l'égalité homme-femme. Et l'on parle pas mal de Landor, qui abrite l'école des factotums dont est issu Sylve. Au delà de Civilisation, se trouve Outre-Civilisation dont on parle très peu mais qu'on fini par comprendre être le pays des mi-hommes (races mi humaines mi autre chose) plus ou moins en guerre. Un autre prétexte pour parler de la peur de l'étranger et du racisme.
J'ai bien aimé les personnages également, souvent ambigus ou ayant une capacité de développement impressionnante. Ainsi notre héros va nous apparaitre tout de suite sympathique. Au début de l'histoire il est en fuite autant qu'en quête. C'est qu'on l'accuse complice d'un vol et son honneur ainsi que son emploi de factotum sont mis en péril. Il va donc, avec ses capacités hors norme pour le combat et l'observation (et tout un tas d'autres choses), décider de rechercher l'homme qui a volé son employeur ainsi que l'objet du délit. Puis on s'aperçoit que c'est un homme rigide, raciste, homophobe, orgueilleux, hautain et prétentieux. Avec en plus l'esprit étriqué par une éducation trop rigoriste. Bref... franchement des fois il ne parait pas sous son meilleur jour. Mais il va progressivement se libérer de ce carcan, des idées qu'on lui a fourré dans le crane, pour devenir à la fin de l'histoire quelqu'un d'autre. Un bon point même si certaines ficelles sont un peu grosses comme l'homophobie cachant une attirance sexuelle inavouée... mais là encore c'est prétexte pour parler de l'homophobie.
Ce qui m'a moins plut, c'est le style d'écriture. A coté du récit narratif, s'entrecoupe des pensées des personnages. Je pensais au départ que ça rendrait la lecture étrange, et bien pas du tout, c'est très bien passé. Cela donne même un petit coté humoristique décalé plutôt plaisant et rafraichissant. Non ce que j'ai eu du mal c'est l'utilisation à tir larigot de mots vulgaires, que ce soit dans les pensées des personnages (ce que l'on peut comprendre) où dans la narration pourtant pas à la première personne (beaucoup plus perturbant). Ainsi s'enchaine les "tronches de tantouzes", "se peler les miches", "couter une blinde", "autre chose à branler", "bouffer de la merde", " foutre la gerbe", "chatte poilue" et autres "glandeuse de gonzesse" . Même si j'ai fini par m'y habituer ça m'a sérieusement gêné dans ma lecture. Surtout qu'il y a quelques phrases à rallonge pas très claires qui nécessitaient parfois une relecture plus lente pour bien en saisir le sens. Et une relecture plus attentive de la part de l'auteur aurait permis de corriger les quelques fautes d'orthographes et nombreuses coquilles glissées dans le texte... Ca aussi c'est un peu désagréable...
J'ai terminé sur les points négatifs mais globalement ce fut une lecture sympathique qui a permis d'aborder des thèmes d'actualités comme l'homophobie, le racisme ou l'égalité homme-femme. Le récit comporte en plus beaucoup de retournements de situation, un joli développement et une fin adaptée qui nous laisse l'envie d'en apprendre plus sur l'univers.
Petit Larousse Illustré.
Définition qui correspond exactement à Sylve, factotum de son état. Une Personne qui s'occupe de tout, certes, mais à un niveau d'expertise inégalé que ce soit pour organiser le diner ou pour combattre des ennemis. C'est dire si la déchéance est grande si l'on met en doute son honneur!
Je remercie l'éditeur ActuSF et Babelio pour l'envoi de ce livre m'ayant permis une très agréable découverte. Il est vrai que lorsque que je l'ai sélectionné dans la liste Masse Critique, je n'avais absolument pas vu que c'était un tome 2. D'ailleurs ce n'est pas du tout mis sur la couverture. Une raison à cela je pense, c'est que ça se lit de façon totalement indépendante. Enfin il me semble vu que je n'ai pas lu le tome un. Peut être que les lecteurs du tome 1 comprendront plus vite certains points de l'univers. C'est vrai que j'ai mis plusieurs chapitres avant de comprendre le fonctionnement de Civilisation et de ses différentes baronnies, que j'ai mis du temps à comprendre qu'est ce que c'était un "mi-homme" et qu'elle forme prenait la magie. Mais rien d'insurmontable.
J'ai bien aimé cet univers, un peu original, de Civilisation. Le pays se compose de 5 baronnies. Anasterry faisait l'objet du premier tome, on s'intéresse ici à Grish-mère. Une baronnie féministe et matriarcale, un peu à l'image des amazones. Un prétexte pour nous faire réfléchir sur l'égalité homme-femme. Et l'on parle pas mal de Landor, qui abrite l'école des factotums dont est issu Sylve. Au delà de Civilisation, se trouve Outre-Civilisation dont on parle très peu mais qu'on fini par comprendre être le pays des mi-hommes (races mi humaines mi autre chose) plus ou moins en guerre. Un autre prétexte pour parler de la peur de l'étranger et du racisme.
J'ai bien aimé les personnages également, souvent ambigus ou ayant une capacité de développement impressionnante. Ainsi notre héros va nous apparaitre tout de suite sympathique. Au début de l'histoire il est en fuite autant qu'en quête. C'est qu'on l'accuse complice d'un vol et son honneur ainsi que son emploi de factotum sont mis en péril. Il va donc, avec ses capacités hors norme pour le combat et l'observation (et tout un tas d'autres choses), décider de rechercher l'homme qui a volé son employeur ainsi que l'objet du délit. Puis on s'aperçoit que c'est un homme rigide, raciste, homophobe, orgueilleux, hautain et prétentieux. Avec en plus l'esprit étriqué par une éducation trop rigoriste. Bref... franchement des fois il ne parait pas sous son meilleur jour. Mais il va progressivement se libérer de ce carcan, des idées qu'on lui a fourré dans le crane, pour devenir à la fin de l'histoire quelqu'un d'autre. Un bon point même si certaines ficelles sont un peu grosses comme l'homophobie cachant une attirance sexuelle inavouée... mais là encore c'est prétexte pour parler de l'homophobie.
Ce qui m'a moins plut, c'est le style d'écriture. A coté du récit narratif, s'entrecoupe des pensées des personnages. Je pensais au départ que ça rendrait la lecture étrange, et bien pas du tout, c'est très bien passé. Cela donne même un petit coté humoristique décalé plutôt plaisant et rafraichissant. Non ce que j'ai eu du mal c'est l'utilisation à tir larigot de mots vulgaires, que ce soit dans les pensées des personnages (ce que l'on peut comprendre) où dans la narration pourtant pas à la première personne (beaucoup plus perturbant). Ainsi s'enchaine les "tronches de tantouzes", "se peler les miches", "couter une blinde", "autre chose à branler", "bouffer de la merde", " foutre la gerbe", "chatte poilue" et autres "glandeuse de gonzesse" . Même si j'ai fini par m'y habituer ça m'a sérieusement gêné dans ma lecture. Surtout qu'il y a quelques phrases à rallonge pas très claires qui nécessitaient parfois une relecture plus lente pour bien en saisir le sens. Et une relecture plus attentive de la part de l'auteur aurait permis de corriger les quelques fautes d'orthographes et nombreuses coquilles glissées dans le texte... Ca aussi c'est un peu désagréable...
J'ai terminé sur les points négatifs mais globalement ce fut une lecture sympathique qui a permis d'aborder des thèmes d'actualités comme l'homophobie, le racisme ou l'égalité homme-femme. Le récit comporte en plus beaucoup de retournements de situation, un joli développement et une fin adaptée qui nous laisse l'envie d'en apprendre plus sur l'univers.
Le docteur James Barry est un médecin britannique, exerçant aux colonies. Il est un excellent praticien. Il a des idées très progressistes sur la chirurgie, sur l'hygiène, sur la psychiatrie. Il est extrêmement intransigeant avec les établissements qu'il contrôle. de fait, il est connu pour son caractère de cochon.
Sauf que le docteur James Barry n'existe pas.
Sous son uniforme boutonné jusqu'au cou en toutes circonstances, se cache un corps féminin : celui de Margaret Bulkley. Car en ce début de 19ème siècle, comme le dit Stendhal, "D'après le système actuel de l'éducation des jeunes filles, tous les génies qui naissent femmes sont perdus pour le bonheur du public."
Alors, pour que ne se perde pas son authentique génie, Margaret, aidée par de riches protecteurs, va dissimuler toute sa vie son identité féminine, et accomplir une brillante carrière.
Cet album s'inspire d'épisodes réels de la vie du faux Dr Barry, et imagine le reste de façon convaincante. Les dessins d'Agnès Maupré, colorés, dynamiques, accompagnent parfaitement le récit.
Le petit bémol, c'est la narration faite de flashbacks qui m'a plutôt perdue et ne m'a pas convaincue. Étant donné qu'on connait dès le début le secret du docteur, une narration chronologique, posant les personnages de façon plus linéaire aurait été tout aussi efficace à mon humble avis.
Sauf que le docteur James Barry n'existe pas.
Sous son uniforme boutonné jusqu'au cou en toutes circonstances, se cache un corps féminin : celui de Margaret Bulkley. Car en ce début de 19ème siècle, comme le dit Stendhal, "D'après le système actuel de l'éducation des jeunes filles, tous les génies qui naissent femmes sont perdus pour le bonheur du public."
Alors, pour que ne se perde pas son authentique génie, Margaret, aidée par de riches protecteurs, va dissimuler toute sa vie son identité féminine, et accomplir une brillante carrière.
Cet album s'inspire d'épisodes réels de la vie du faux Dr Barry, et imagine le reste de façon convaincante. Les dessins d'Agnès Maupré, colorés, dynamiques, accompagnent parfaitement le récit.
Le petit bémol, c'est la narration faite de flashbacks qui m'a plutôt perdue et ne m'a pas convaincue. Étant donné qu'on connait dès le début le secret du docteur, une narration chronologique, posant les personnages de façon plus linéaire aurait été tout aussi efficace à mon humble avis.
Qu'est-ce que j'ai rigolé !
J'aime beaucoup l'héroïne, une ado au QI un peu trop élevé qui a peur d'être considérée comme un monstre par les autres et fait tout pour se fondre dans la masse. Ses trois copines "normales" sont des caricatures d'ado qu'on a l'impression de connaître. Enfin la fille gothique flippante met du piment et du challenge.
Les gags en une page m'ont rappelé le premier épisode de Lou. Mais le dessin est bien plus détaillé et cocasse. Les couleurs pêchues et kawaï font très ado ce qui va avec le thème principal. Suis-je en train de dire que c'est une BD pour ado ? Que nenni, c'est une BD à différents niveaux de lecture (comme un bon vieux Astérix). C'est aussi une BD pour geek, pour gothiques, pour profs, pour parents d'ados...que sais-je encore... Un petit exemple : Alyssa explique à son chien la théorie de Noam Chomsky du choix induit.
La page qui m'a fait me bidonner : la scène qu'Alyssa fait à sa mère dans un magasin avant de s'exclamer "Comment juges-tu ma performance ?"
Cette BD est parfaite pour un fonds de collège ou pour offrir à une ado (comme ça vous pouvez la lire discrétos en plus !)
Lien : http://lireetclaire.wordpres..
J'aime beaucoup l'héroïne, une ado au QI un peu trop élevé qui a peur d'être considérée comme un monstre par les autres et fait tout pour se fondre dans la masse. Ses trois copines "normales" sont des caricatures d'ado qu'on a l'impression de connaître. Enfin la fille gothique flippante met du piment et du challenge.
Les gags en une page m'ont rappelé le premier épisode de Lou. Mais le dessin est bien plus détaillé et cocasse. Les couleurs pêchues et kawaï font très ado ce qui va avec le thème principal. Suis-je en train de dire que c'est une BD pour ado ? Que nenni, c'est une BD à différents niveaux de lecture (comme un bon vieux Astérix). C'est aussi une BD pour geek, pour gothiques, pour profs, pour parents d'ados...que sais-je encore... Un petit exemple : Alyssa explique à son chien la théorie de Noam Chomsky du choix induit.
La page qui m'a fait me bidonner : la scène qu'Alyssa fait à sa mère dans un magasin avant de s'exclamer "Comment juges-tu ma performance ?"
Cette BD est parfaite pour un fonds de collège ou pour offrir à une ado (comme ça vous pouvez la lire discrétos en plus !)
Lien : http://lireetclaire.wordpres..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Isabelle Bauthian
Lecteurs de Isabelle Bauthian (1016)Voir plus
Quiz
Voir plus
le médecin malgré lui
Martine a combien d'enfants?
4
2
3
11 questions
54 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur54 lecteurs ont répondu