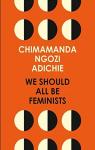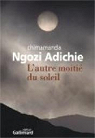Critiques de Chimamanda Ngozi Adichie (1161)
♫ «Vois-tu mon chéri, pour te plaire j'ai fait quelque chose de bien gentil,
j'ai fait ce que font toutes les femmes en c'moment pour être tout à fait dans l'mouv'ment».
Elle enleva gentiment son chapeau et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt
qu'elle s'était fait couper les ch'veux ♪
Comme l’évoque cette vieille chanson de 1924, la coupe de cheveux, façon américaine tout de même, s’avère être le fil rouge de ce roman nigérian titré « Americanah ».
Précisant tout de suite que je suis un homme et que moins je passe de temps chez le coiffeur mieux je me porte, comment se fait-il que je veuille découvrir à ce point une histoire qui se déroule pendant des heures dans un salon de coiffure ?
Bien sûr, c’est ma soif de curiosité sur le Nigéria qui m’a guidé sur ce livre…
Par exemple, je sais comme bon nombre d'entre vous que les joueurs de football du Nigéria portent des tuniques vertes et qu’ils sont surnommés « les Super Eagles » ou bien encore que la secte Boko Haram sème la terreur dans le nord du pays.
Mais saviez-vous que la capitale de ce géant d’Afrique de plus de 177 millions d'habitants et première puissance économique du continent s’appelle "Abuja" ?
Connaissiez-vous le président nigérian qui doit surement avoir beaucoup plus de chance avec la météo que le notre ainsi nommé Goodluck Jonathan ?
Vous n’étiez pas au courant. Moi non plus je l’avoue. Et je n’avais jamais entendu parler de ce livre et de cette auteure nigériane il y a encore un mois.
Pour tout dire, je n’aurais jamais croisé la route d’Ifemelu, l’héroine d’Americanah si je n’avais pas été invité à participer à une rencontre avec « Chimamanda Ngozi Adichie », cette magnifique écrivaine nigériane (dans tous les sens du terme) qui partage actuellement sa vie entre Lagos et New York.
Qui plus est, ce roman n’est à proprement parlé un livre sur le Nigéria mais sur les « Americanah ». C’est ainsi que l’on surnomme les nigérians qui ont tenté l’aventure dans le pays de l’oncle Sam avant de revenir au Nigéria pour faire fortune ou réaliser leurs rêves les plus fous.
Comme quoi, moi qui adore les romans américains, je n’ai rien perdu au change…
C’est ainsi que, Ifemelu une jeune femme nigériane, décide de quitter le Nigéria pour effectuer ses études aux Etats-Unis, pensant retrouver dans quelques mois son petit copain, Obinze, impatient de la rejoindre avant de régler quelques problèmes administratifs habituels.
Mais rien ne va se passer comme prévu et Ifemelu va traverser les pires difficultés pour d'abord survivre dans ce nouvel environnement et par la suite, réussir à s’adapter au style de vie américain.
Plus dur encore, Ifemelu va découvrir pour la première de sa vie qu’elle est noire. Noire au milieu d'une société faite pour les blancs…
Dénonçant à la fois le racisme et la difficulté de s’intégrer aux Etats-Unis pour un noir, Chimamanda Ngozi Adichie pioche à travers ses expériences personnelles, celles de sa famille ou de ses amis le substrat indispensable pour brosser le portrait de l’Amérique vis-à-vis des immigrés africains et plus généralement de la population noire.
A la fois engagé et plein d'humour, ce roman fait la part belle à une histoire d’amour impossible dont on ne connaîtra l’issue qu’à la toute fin du livre.
A ce sujet, la principale critique que j'objecterais, concernant ce livre par ailleurs remarquablement bien écrit et particulièrement intéressant, est justement cette trop longue attente.
Comme l’héroïne du livre, j’ai eu l’impression d’attendre des plombes dans ce salon de coiffure et de me priver ainsi d’une fin plus aboutie et beaucoup moins concise que celle proposée. Je voyais les pages défiler et décomptais les pages restantes un peu affolé. Plus que 200 pages… Plus que 100 pages… Plus que 50 pages… Ouf enfin !
Quoi qu’il en soit, que vous ayez les cheveux en bataille, en brosse, au bol, au carré, en triangle, en losange, tressés, ondulés, frisés ou lissés que sais je, n’hésitez pas une seule seconde à découvrir cet excellent ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie dont la signature manuscrite restera gravée à tout jamais dans mon exemplaire offert par Gallimard.
Merci encore à Babélio et bon vol pour votre prochain voyage inoubliable au Nigéria et aux Etats-Unis !
Ps : Petite remarque au passage, j'ai l'impression d'appartenir à une espèce en voie de disparition, voire d'extinction lorsque que l'on comptabilise le nombre d'hommes qui étaient présents dans la salle par rapport au nombre de femmes ! Il ne manquerait plus que je finisse dans un zoo pour lecteurs...
j'ai fait ce que font toutes les femmes en c'moment pour être tout à fait dans l'mouv'ment».
Elle enleva gentiment son chapeau et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt
qu'elle s'était fait couper les ch'veux ♪
Comme l’évoque cette vieille chanson de 1924, la coupe de cheveux, façon américaine tout de même, s’avère être le fil rouge de ce roman nigérian titré « Americanah ».
Précisant tout de suite que je suis un homme et que moins je passe de temps chez le coiffeur mieux je me porte, comment se fait-il que je veuille découvrir à ce point une histoire qui se déroule pendant des heures dans un salon de coiffure ?
Bien sûr, c’est ma soif de curiosité sur le Nigéria qui m’a guidé sur ce livre…
Par exemple, je sais comme bon nombre d'entre vous que les joueurs de football du Nigéria portent des tuniques vertes et qu’ils sont surnommés « les Super Eagles » ou bien encore que la secte Boko Haram sème la terreur dans le nord du pays.
Mais saviez-vous que la capitale de ce géant d’Afrique de plus de 177 millions d'habitants et première puissance économique du continent s’appelle "Abuja" ?
Connaissiez-vous le président nigérian qui doit surement avoir beaucoup plus de chance avec la météo que le notre ainsi nommé Goodluck Jonathan ?
Vous n’étiez pas au courant. Moi non plus je l’avoue. Et je n’avais jamais entendu parler de ce livre et de cette auteure nigériane il y a encore un mois.
Pour tout dire, je n’aurais jamais croisé la route d’Ifemelu, l’héroine d’Americanah si je n’avais pas été invité à participer à une rencontre avec « Chimamanda Ngozi Adichie », cette magnifique écrivaine nigériane (dans tous les sens du terme) qui partage actuellement sa vie entre Lagos et New York.
Qui plus est, ce roman n’est à proprement parlé un livre sur le Nigéria mais sur les « Americanah ». C’est ainsi que l’on surnomme les nigérians qui ont tenté l’aventure dans le pays de l’oncle Sam avant de revenir au Nigéria pour faire fortune ou réaliser leurs rêves les plus fous.
Comme quoi, moi qui adore les romans américains, je n’ai rien perdu au change…
C’est ainsi que, Ifemelu une jeune femme nigériane, décide de quitter le Nigéria pour effectuer ses études aux Etats-Unis, pensant retrouver dans quelques mois son petit copain, Obinze, impatient de la rejoindre avant de régler quelques problèmes administratifs habituels.
Mais rien ne va se passer comme prévu et Ifemelu va traverser les pires difficultés pour d'abord survivre dans ce nouvel environnement et par la suite, réussir à s’adapter au style de vie américain.
Plus dur encore, Ifemelu va découvrir pour la première de sa vie qu’elle est noire. Noire au milieu d'une société faite pour les blancs…
Dénonçant à la fois le racisme et la difficulté de s’intégrer aux Etats-Unis pour un noir, Chimamanda Ngozi Adichie pioche à travers ses expériences personnelles, celles de sa famille ou de ses amis le substrat indispensable pour brosser le portrait de l’Amérique vis-à-vis des immigrés africains et plus généralement de la population noire.
A la fois engagé et plein d'humour, ce roman fait la part belle à une histoire d’amour impossible dont on ne connaîtra l’issue qu’à la toute fin du livre.
A ce sujet, la principale critique que j'objecterais, concernant ce livre par ailleurs remarquablement bien écrit et particulièrement intéressant, est justement cette trop longue attente.
Comme l’héroïne du livre, j’ai eu l’impression d’attendre des plombes dans ce salon de coiffure et de me priver ainsi d’une fin plus aboutie et beaucoup moins concise que celle proposée. Je voyais les pages défiler et décomptais les pages restantes un peu affolé. Plus que 200 pages… Plus que 100 pages… Plus que 50 pages… Ouf enfin !
Quoi qu’il en soit, que vous ayez les cheveux en bataille, en brosse, au bol, au carré, en triangle, en losange, tressés, ondulés, frisés ou lissés que sais je, n’hésitez pas une seule seconde à découvrir cet excellent ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie dont la signature manuscrite restera gravée à tout jamais dans mon exemplaire offert par Gallimard.
Merci encore à Babélio et bon vol pour votre prochain voyage inoubliable au Nigéria et aux Etats-Unis !
Ps : Petite remarque au passage, j'ai l'impression d'appartenir à une espèce en voie de disparition, voire d'extinction lorsque que l'on comptabilise le nombre d'hommes qui étaient présents dans la salle par rapport au nombre de femmes ! Il ne manquerait plus que je finisse dans un zoo pour lecteurs...
Chimamanda Ngozi Achidie - Nous sommes tous des féministes - Folio inédit - 2 euros - 87 pages - lu en février 2018.
Un essai suivi d'une nouvelle "Les marieuses" tirée de son recueil de nouvelles "Autour de ton cou". Son oeuvre à ce jour a été traduite en 30 langues.
"Nous sommes tous des féministes" est une version modifiée d'une conférence donnée par Chimamanda en 2012, lors d'un colloque annuel consacré à l'Afrique.
Chimamanda nous explique que le terme de Féminisme - que le concept même de féminise - est limité par les stéréotypes.
Son livre nous raconte sa jeunesse, les différences de traitement entre les filles/femmes et garçons/hommes.
Elle décide d'être : "Une Féministe Africaine Heureuse" qui ne déteste pas les hommes, qui aime se maquiller, porter des talons hauts, non pas pour s'attirer le regard des hommes, mais pour son propre plaisir.
Elle nous raconte les pressions exercées sur les filles/femmes, déjà à l'école
où les filles n'ont pas le droit d'être chef de classe. Les filles sont reléguées au second plan.
Chimamanda nous présente ainsi quantité d'exemples de la vie quotidienne où les femmes passent pour des êtres inférieurs, voire transparentes.
Et tout cela sans aucune rancoeur, avec même beaucoup d'humour.
La nouvelle "Les marieuses", c'est dur, c'est l'histoire d'une jeune femme Chinaza, mariée contre son gré à un homme choisi par sa famille.
Pour moi, le féminisme, ce n'est pas être "contre les hommes", c'est oeuvrer pour que les femmes soient acceptées partout dans le monde comme ayant les mêmes droits, être l'égale des hommes, nos seules différences sont physiques mais complémentaires.
C'est au travers de ses livres, ses conférences que Chimamanda travaille à faire changer les mentalités, lentement mais sûrement. Bravo Madame, continuez à défendre la cause des femmes de cette manière, non violente, mais tellement parlante. A lire, aussi bien par les hommes que par les femmes.
Un essai suivi d'une nouvelle "Les marieuses" tirée de son recueil de nouvelles "Autour de ton cou". Son oeuvre à ce jour a été traduite en 30 langues.
"Nous sommes tous des féministes" est une version modifiée d'une conférence donnée par Chimamanda en 2012, lors d'un colloque annuel consacré à l'Afrique.
Chimamanda nous explique que le terme de Féminisme - que le concept même de féminise - est limité par les stéréotypes.
Son livre nous raconte sa jeunesse, les différences de traitement entre les filles/femmes et garçons/hommes.
Elle décide d'être : "Une Féministe Africaine Heureuse" qui ne déteste pas les hommes, qui aime se maquiller, porter des talons hauts, non pas pour s'attirer le regard des hommes, mais pour son propre plaisir.
Elle nous raconte les pressions exercées sur les filles/femmes, déjà à l'école
où les filles n'ont pas le droit d'être chef de classe. Les filles sont reléguées au second plan.
Chimamanda nous présente ainsi quantité d'exemples de la vie quotidienne où les femmes passent pour des êtres inférieurs, voire transparentes.
Et tout cela sans aucune rancoeur, avec même beaucoup d'humour.
La nouvelle "Les marieuses", c'est dur, c'est l'histoire d'une jeune femme Chinaza, mariée contre son gré à un homme choisi par sa famille.
Pour moi, le féminisme, ce n'est pas être "contre les hommes", c'est oeuvrer pour que les femmes soient acceptées partout dans le monde comme ayant les mêmes droits, être l'égale des hommes, nos seules différences sont physiques mais complémentaires.
C'est au travers de ses livres, ses conférences que Chimamanda travaille à faire changer les mentalités, lentement mais sûrement. Bravo Madame, continuez à défendre la cause des femmes de cette manière, non violente, mais tellement parlante. A lire, aussi bien par les hommes que par les femmes.
Ce livre est le second roman publié par Chimamanda Ngozi Adichie, auteur qui vit au Nigéria après un séjour aux Etats-Unis pour ses études.
Autant dire tout de suite qu’avant cette opération entre Babelio et les éditions Gallimard, je n’avais jamais entendu parler d’elle.
Découverte donc !
D’autant que cette lecture était accompagnée d’une rencontre avec l’auteur qui a permis d’éclairer bien des points de ce récit.
Découverte d’un auteur bien sur, mais également découverte d’une œuvre, d’un travail, d’un style particulier, d’audaces que nous ne nous permettons plus.
Ce livre décrit le parcours de deux jeunes Nigérians d’un niveau social plutôt privilégié (Enseignants, universitaires…) conduits à l’immigration par la situation de leur pays, et particulièrement d’Ifemelu, une jeune femme . qui part faire des études aux Etats-Unis. Son ami d’enfance (Voire un peu plus….), Oblinze part lui de son côté en Angleterre. Il reviendra comme nombre de ses congènères faire fortune au Nigéria. On peut rappeler à cette occasion que ce pays est politiquement peu stable (C’est un doux euphémisme) et que la moyenne démographique actuelle est de six enfants par femme.
Acceder à une position sociale plus importante est donc à la portée de ceux qui ont eu d’autres modèles et reviennent avec des Savoir-Faire.
Après une intégration à la société Américaine notamment par les livres et la tenue d’un blog destiné aux Africains en Amérique, Ifemelu va traverser une sorte de crise existentielle (comme cela arrive à bien d’autres) et remettre en cause sa situation.
En effet, après une phase d’Américanisation à marche forcée (mode de vie, accent américain….) elle va décider de reprendre son identité Africaine et de rentrer au pays, retrouver ce et ceux qu’elle y avait laissé.
Elle retrouve alors son identité réelle.
C’est en fait l’histoire simple de deux jeunes gens amoureux, séparés et qui auront vécu des aventures banales… et pourtant pas aussi simples.
Mais c’est surtout l’occasion de parler franchement du ressentit des déracinés, en fait du racisme.
Ce n’est pas l’acte raciste odieux dont il est sujet ici, mais bien du racisme au quotidien, celui qui s’installe insidieusement dans nos cultures, dans nos pensées et qui, sans éclat influence notre façon de voir la société. (Il n’y a par exemple plus de noirs en France : Il y a des blacks !)
J’ai beaucoup aimé ce passage dans lequel Ifemelu explique s’être rendu compte qu’elle était noire à l’aéroport aux Etats-Unis. En effet à son départ, tout le monde était noir et il n’y avait pas de différence en termes de couleur de peau.
Les choses n’existent que parce qu’elles ont un contraire.
Un thème est récurent dans ce livre : les cheveux comme élément de différenciation entre les personnes, entre les blancs et les noirs. Cheveux crépus, lisses, droits, tombants, bruns blonds ou roux….
Ce n’est pas un hasard si le livre commence dans un salon de coiffure où Ifemelu va passe six heures à se faire tresser les cheveux, et aura ainsi le temps de passer ses expériences de vie en revue.
Ce qui m’a le plus surpris dans ce livre, c’est la franchise avec laquelle sont abordées les notions de race, de différence culturelle, sociétales, etc.
On a tout à coup l’impression qu’en France aborder ainsi ces sujets aurait conduit à des polémiques tenaces.
C’est à travers une peinture de l’Afrique et de sa culture, de l’Amérique et de ses travers que sont abordés la plupart de nos problèmes de société.
L’histoire d’Ifemelu et d’Oblinze, bien qu’en grande partie basée sur l’expérience personnelle de l’auteur, n’est en fait qu’un prétexte à un regard sociologique de notre monde.
Chimamanda Ngozi Adichie aborde librement la notion de race et refuse de se cacher derrière une pseudo uniformisation de tous les êtres. Elle accepte les différences et les respecte.
Elle nous livre en tout cas un livre drôle, rythmé, dense et qui conduit le lecteur à la réflexion
Très jolie découverte, donc !
Autant dire tout de suite qu’avant cette opération entre Babelio et les éditions Gallimard, je n’avais jamais entendu parler d’elle.
Découverte donc !
D’autant que cette lecture était accompagnée d’une rencontre avec l’auteur qui a permis d’éclairer bien des points de ce récit.
Découverte d’un auteur bien sur, mais également découverte d’une œuvre, d’un travail, d’un style particulier, d’audaces que nous ne nous permettons plus.
Ce livre décrit le parcours de deux jeunes Nigérians d’un niveau social plutôt privilégié (Enseignants, universitaires…) conduits à l’immigration par la situation de leur pays, et particulièrement d’Ifemelu, une jeune femme . qui part faire des études aux Etats-Unis. Son ami d’enfance (Voire un peu plus….), Oblinze part lui de son côté en Angleterre. Il reviendra comme nombre de ses congènères faire fortune au Nigéria. On peut rappeler à cette occasion que ce pays est politiquement peu stable (C’est un doux euphémisme) et que la moyenne démographique actuelle est de six enfants par femme.
Acceder à une position sociale plus importante est donc à la portée de ceux qui ont eu d’autres modèles et reviennent avec des Savoir-Faire.
Après une intégration à la société Américaine notamment par les livres et la tenue d’un blog destiné aux Africains en Amérique, Ifemelu va traverser une sorte de crise existentielle (comme cela arrive à bien d’autres) et remettre en cause sa situation.
En effet, après une phase d’Américanisation à marche forcée (mode de vie, accent américain….) elle va décider de reprendre son identité Africaine et de rentrer au pays, retrouver ce et ceux qu’elle y avait laissé.
Elle retrouve alors son identité réelle.
C’est en fait l’histoire simple de deux jeunes gens amoureux, séparés et qui auront vécu des aventures banales… et pourtant pas aussi simples.
Mais c’est surtout l’occasion de parler franchement du ressentit des déracinés, en fait du racisme.
Ce n’est pas l’acte raciste odieux dont il est sujet ici, mais bien du racisme au quotidien, celui qui s’installe insidieusement dans nos cultures, dans nos pensées et qui, sans éclat influence notre façon de voir la société. (Il n’y a par exemple plus de noirs en France : Il y a des blacks !)
J’ai beaucoup aimé ce passage dans lequel Ifemelu explique s’être rendu compte qu’elle était noire à l’aéroport aux Etats-Unis. En effet à son départ, tout le monde était noir et il n’y avait pas de différence en termes de couleur de peau.
Les choses n’existent que parce qu’elles ont un contraire.
Un thème est récurent dans ce livre : les cheveux comme élément de différenciation entre les personnes, entre les blancs et les noirs. Cheveux crépus, lisses, droits, tombants, bruns blonds ou roux….
Ce n’est pas un hasard si le livre commence dans un salon de coiffure où Ifemelu va passe six heures à se faire tresser les cheveux, et aura ainsi le temps de passer ses expériences de vie en revue.
Ce qui m’a le plus surpris dans ce livre, c’est la franchise avec laquelle sont abordées les notions de race, de différence culturelle, sociétales, etc.
On a tout à coup l’impression qu’en France aborder ainsi ces sujets aurait conduit à des polémiques tenaces.
C’est à travers une peinture de l’Afrique et de sa culture, de l’Amérique et de ses travers que sont abordés la plupart de nos problèmes de société.
L’histoire d’Ifemelu et d’Oblinze, bien qu’en grande partie basée sur l’expérience personnelle de l’auteur, n’est en fait qu’un prétexte à un regard sociologique de notre monde.
Chimamanda Ngozi Adichie aborde librement la notion de race et refuse de se cacher derrière une pseudo uniformisation de tous les êtres. Elle accepte les différences et les respecte.
Elle nous livre en tout cas un livre drôle, rythmé, dense et qui conduit le lecteur à la réflexion
Très jolie découverte, donc !
Chimamanda Ngozi Adiche dispose d'un talent de narration extraordinaire.C'est son deuxième roman que je viens de lire après "L'autre moitié du soleil",et j'en sors toujours aussi épatée.
L'histoire débute avec Ifemelu,une jeune Nigériane ,dans la trentaine,vivant depuis treize ans aux États-Unis,qui décide de rentrer dans son pays laissant tomber son blog à succès et son petit ami.De là ,flashback sur sa vie antérieure ,sa jeunesse au Nigéria ,son grand amour avec Obinze et ses treize années américaines.Parallélement ,on va faire la connaissance d'Obinze et de son propre parcours.Les difficultés de l'émigration,de l'immigration,le racisme actuel aux Etats-Unis,les relations interraciales sont au coeur de ce récit passionnant.Adichie,magicienne de la langue en quelques lignes nous croque des portraits de personnages appartenant à divers communautés:les WASP,les Noirs américains,les noirs non-américains aux E.U.,et au Nigéria,les Americanahs ou autres Nigérians ayant vécus à l'étranger,les nouveaux riches...avec leurs faiblesses,leurs complexes,leurs aspirations,leur recherche d'identité...truculent!C'est aussi une magnifique histoire d'amour,la construction est excellente,le style fluide la prose(v.o.)trés belle,et j'ai adoré la Fin!
L'histoire débute avec Ifemelu,une jeune Nigériane ,dans la trentaine,vivant depuis treize ans aux États-Unis,qui décide de rentrer dans son pays laissant tomber son blog à succès et son petit ami.De là ,flashback sur sa vie antérieure ,sa jeunesse au Nigéria ,son grand amour avec Obinze et ses treize années américaines.Parallélement ,on va faire la connaissance d'Obinze et de son propre parcours.Les difficultés de l'émigration,de l'immigration,le racisme actuel aux Etats-Unis,les relations interraciales sont au coeur de ce récit passionnant.Adichie,magicienne de la langue en quelques lignes nous croque des portraits de personnages appartenant à divers communautés:les WASP,les Noirs américains,les noirs non-américains aux E.U.,et au Nigéria,les Americanahs ou autres Nigérians ayant vécus à l'étranger,les nouveaux riches...avec leurs faiblesses,leurs complexes,leurs aspirations,leur recherche d'identité...truculent!C'est aussi une magnifique histoire d'amour,la construction est excellente,le style fluide la prose(v.o.)trés belle,et j'ai adoré la Fin!
Ses livres partout traduits et son engagement contre le racisme et le sexisme en Afrique et dans le monde ont fait de Chimamanda Ngozi Adichie, non seulement une grande dame de la littérature nigériane, dans la lignée de Chinua Achebe et de Wole Soyinka, mais aussi l’une des personnalités africaines les plus influentes qui soient, véritable icône internationale que l’on s’arrache pour des conférences et des entretiens. Multi-consacrée par les reconnaissances les plus prestigieuses – elle est notamment membre de l’Académie américaine des arts et des lettres –, elle est citée comme l’un des plus grands auteurs de sa génération, la BBC citant en 2019 L’autre moitié du soleil, son livre jugé le plus réussi, parmi les « 100 romans qui ont façonné le monde ».
L’autre moitié du soleil, c’est la terrible histoire du Biafra, cette éphémère république née en 1967 de la sécession de la partie sud-est du Nigeria, qui choisit de frapper son drapeau du symbole d’un demi-soleil. Oscillant entre le début et la fin des années soixante, le récit évoque l’euphorie post-indépendance du Nigeria, vite empoisonnée par les graines de zizanie germées de l’artificiel découpage des frontières du pays par les puissances coloniales européennes, et s’appesantit sur la courte existence du Biafra, réintégré – avec ses précieux gisements de pétrole – dans le giron nigérian après trois ans d’une guerre civile et d’un blocus qui devaient faire périr, de la famine bien plus encore que des combats, plus d’un million de Biafrais, majoritairement de l’ethnie Ibo.
Dans ce cadre historique où vient d’ailleurs s’inscrire l’histoire familiale de l’auteur – ses deux grands-pères n’ont pas survécu aux camps de réfugiés du Biafra –, le lecteur est emporté par le souffle romanesque d’une fiction peuplée d’une myriade de personnages gravitant autour de deux sœurs jumelles, Olanna et Kainene, issues de l’ethnie Ibo en même temps que des classes aisées nigérianes. La première, liée à l’universitaire Odenigbo, évolue au coeur de l’intelligentsia du pays, tandis que la seconde, unie à Richard, un Anglais blanc bien décidé à devenir aussi Ibo que possible, se démène pour reprendre la gestion des entreprises paternelles. La tourmente s’abattant bientôt sur leur monde, Richard, devenu peu à peu correspondant de guerre, tentera d’intéresser la presse internationale au sort du Biafra. Mais c’est Ugwu, un jeune et pauvre villageois entré au service d’Olanna et Odenigbo, qui entreprendra véritablement la relation, de l’intérieur, du calvaire des Ibos et des Biafrais, étape essentielle pour que cette histoire ne devienne pas le trou noir de la mémoire nigériane, et pour que les traumatismes puissent trouver les moyens de guérir un jour.
« Imagine des enfants aux bras comme des allumettes, Le ventre en ballon de foot, peau tendue à craquer. C’était le kwashiorkor – mot compliqué, Un mot pas encore assez hideux, un péché. » « Ugwu l’avait remercié et avait secoué la tête en réalisant que jamais il ne pourrait traduire cet enfant sur le papier, jamais il ne pourrait décrire assez fidèlement la peur qui voilait les yeux des mères au camp de réfugiés quand les bombardiers surgissaient du ciel et attaquaient. Il ne pourrait jamais décrire ce qu’il y avait de terriblement lugubre à bombarder des gens qui ont faim. »
Preuve par l’exemple que, pour reprendre les mots de l’auteur, « Il est temps que les Africains racontent eux-mêmes leurs histoires. », ce livre cathartique, parfois qualifié de tolstoïen, participe du devoir de mémoire, alors que le Nigeria, mal cicatrisé, peine encore à trouver son unité. C’est aussi une œuvre romanesque portée par un grand souffle, que l’on peut retrouver au cinéma puisqu’elle fut adaptée au grand écran en 2013, sous le même titre, par l’écrivain et réalisateur anglo-nigérian Biyi Bandele.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
L’autre moitié du soleil, c’est la terrible histoire du Biafra, cette éphémère république née en 1967 de la sécession de la partie sud-est du Nigeria, qui choisit de frapper son drapeau du symbole d’un demi-soleil. Oscillant entre le début et la fin des années soixante, le récit évoque l’euphorie post-indépendance du Nigeria, vite empoisonnée par les graines de zizanie germées de l’artificiel découpage des frontières du pays par les puissances coloniales européennes, et s’appesantit sur la courte existence du Biafra, réintégré – avec ses précieux gisements de pétrole – dans le giron nigérian après trois ans d’une guerre civile et d’un blocus qui devaient faire périr, de la famine bien plus encore que des combats, plus d’un million de Biafrais, majoritairement de l’ethnie Ibo.
Dans ce cadre historique où vient d’ailleurs s’inscrire l’histoire familiale de l’auteur – ses deux grands-pères n’ont pas survécu aux camps de réfugiés du Biafra –, le lecteur est emporté par le souffle romanesque d’une fiction peuplée d’une myriade de personnages gravitant autour de deux sœurs jumelles, Olanna et Kainene, issues de l’ethnie Ibo en même temps que des classes aisées nigérianes. La première, liée à l’universitaire Odenigbo, évolue au coeur de l’intelligentsia du pays, tandis que la seconde, unie à Richard, un Anglais blanc bien décidé à devenir aussi Ibo que possible, se démène pour reprendre la gestion des entreprises paternelles. La tourmente s’abattant bientôt sur leur monde, Richard, devenu peu à peu correspondant de guerre, tentera d’intéresser la presse internationale au sort du Biafra. Mais c’est Ugwu, un jeune et pauvre villageois entré au service d’Olanna et Odenigbo, qui entreprendra véritablement la relation, de l’intérieur, du calvaire des Ibos et des Biafrais, étape essentielle pour que cette histoire ne devienne pas le trou noir de la mémoire nigériane, et pour que les traumatismes puissent trouver les moyens de guérir un jour.
« Imagine des enfants aux bras comme des allumettes, Le ventre en ballon de foot, peau tendue à craquer. C’était le kwashiorkor – mot compliqué, Un mot pas encore assez hideux, un péché. » « Ugwu l’avait remercié et avait secoué la tête en réalisant que jamais il ne pourrait traduire cet enfant sur le papier, jamais il ne pourrait décrire assez fidèlement la peur qui voilait les yeux des mères au camp de réfugiés quand les bombardiers surgissaient du ciel et attaquaient. Il ne pourrait jamais décrire ce qu’il y avait de terriblement lugubre à bombarder des gens qui ont faim. »
Preuve par l’exemple que, pour reprendre les mots de l’auteur, « Il est temps que les Africains racontent eux-mêmes leurs histoires. », ce livre cathartique, parfois qualifié de tolstoïen, participe du devoir de mémoire, alors que le Nigeria, mal cicatrisé, peine encore à trouver son unité. C’est aussi une œuvre romanesque portée par un grand souffle, que l’on peut retrouver au cinéma puisqu’elle fut adaptée au grand écran en 2013, sous le même titre, par l’écrivain et réalisateur anglo-nigérian Biyi Bandele.
Lien : https://leslecturesdecanneti..
Ce n'est pas seulement la fuite devant la guerre ou la pauvreté qui contraint à l'exil.
Le Nigeria des années 90 perd les forces vives intellectuelles de sa population, étudiants diplômés mais sans avenir dans leur patrie, désirant "échapper à la léthargie pesante du manque de choix". Instabilité politique, corruption et chômage représentent un mur infranchissable. Ces jeunes adultes aisés, convaincus que leur réussite est ailleurs, tentent études supérieures ou travail aux Etats Unis ou en Grande-Bretagne, pour construire un avenir professionnel avec une énergie et un courage remarquables. Ils y sont confrontés à la clandestinité, à la pauvreté, aux trafics de papiers, à l'illégalité de mariages blancs, à la prison: un autre monde pour ces classes moyennes africaines.
L'exil, c'est l'adaptation, difficile, en dépit de l'entraide et de la diaspora nigériane. C'est aussi la séparation: Ifemelu, envolée vers Philadelphie perd Obinze, son amour de jeunesse parti vers Londres. Alors qu'il subit l'humiliation de l'expulsion, elle devient une star de la blogosphère, observatrice sans relâche des différences culturelles entre les africains et les afro américains.
L'immersion américaine, c'est la conscience de la négritude, du racisme et de ses subtilités, dont elle peut parler avec un point de vue extérieur, avec humour et ironie.
Quinze ans plus tard, le retour à Lagos, entre le désir de faire fortune ou l'espoir idéaliste de changer le pays, s'annonce plus difficile que prévu, pour elle comme pour ces adultes construits entre deux cultures et passant souvent pour arrogants et supérieurs. A travers ses personnages, attachants et généreux, l'auteure décortique une société nigériane faites de contradictions, en y faisant la part belle aux femmes.
Et la coiffure dans tout cela? La symbolique des problèmes capillaires, pouvant être agaçante mais aussi instructive et amusante, pose la question de l'identité noire dans une société où la beauté est perçue comme blanche et lisse. Une identité liée au pouvoir économique et politique, une pression sociale pour trouver emploi et reconnaissance, un racisme de plus, insidieux et auto imposé.
Alors naturel ou lissé le brushing?
Magistrale histoire d'amour, aventures mouvementées des parcours d'émigration, satire sociale, Americanah est un gros livre dense, fouillé, drôle, grave, captivant, addictif, ...épatant comme disait Bernard Pivot!
Le Nigeria des années 90 perd les forces vives intellectuelles de sa population, étudiants diplômés mais sans avenir dans leur patrie, désirant "échapper à la léthargie pesante du manque de choix". Instabilité politique, corruption et chômage représentent un mur infranchissable. Ces jeunes adultes aisés, convaincus que leur réussite est ailleurs, tentent études supérieures ou travail aux Etats Unis ou en Grande-Bretagne, pour construire un avenir professionnel avec une énergie et un courage remarquables. Ils y sont confrontés à la clandestinité, à la pauvreté, aux trafics de papiers, à l'illégalité de mariages blancs, à la prison: un autre monde pour ces classes moyennes africaines.
L'exil, c'est l'adaptation, difficile, en dépit de l'entraide et de la diaspora nigériane. C'est aussi la séparation: Ifemelu, envolée vers Philadelphie perd Obinze, son amour de jeunesse parti vers Londres. Alors qu'il subit l'humiliation de l'expulsion, elle devient une star de la blogosphère, observatrice sans relâche des différences culturelles entre les africains et les afro américains.
L'immersion américaine, c'est la conscience de la négritude, du racisme et de ses subtilités, dont elle peut parler avec un point de vue extérieur, avec humour et ironie.
Quinze ans plus tard, le retour à Lagos, entre le désir de faire fortune ou l'espoir idéaliste de changer le pays, s'annonce plus difficile que prévu, pour elle comme pour ces adultes construits entre deux cultures et passant souvent pour arrogants et supérieurs. A travers ses personnages, attachants et généreux, l'auteure décortique une société nigériane faites de contradictions, en y faisant la part belle aux femmes.
Et la coiffure dans tout cela? La symbolique des problèmes capillaires, pouvant être agaçante mais aussi instructive et amusante, pose la question de l'identité noire dans une société où la beauté est perçue comme blanche et lisse. Une identité liée au pouvoir économique et politique, une pression sociale pour trouver emploi et reconnaissance, un racisme de plus, insidieux et auto imposé.
Alors naturel ou lissé le brushing?
Magistrale histoire d'amour, aventures mouvementées des parcours d'émigration, satire sociale, Americanah est un gros livre dense, fouillé, drôle, grave, captivant, addictif, ...épatant comme disait Bernard Pivot!
L’autre moitié du soleil, c’est le soleil de l'est, celui qui annonce l’aube d’une nouvelle vie au sein d’une nouvelle patrie, c'est le drapeau du Biafra.
Ce roman se déroule dans les années 60 dans la région est du Nigéria peuplée aux deux tiers par les Igbos majoritairement chrétiens. On y suit en particulier les jumelles Olanna et Kainene qui se sont éloignées l'une de l'autre. Chacune de son côté vit un quotidien banal, avec son lot de petits bonheurs et de déceptions, mais qui les rend profondément attachantes. Le monde de Kainene est encré dans la réalité, elle travaille dans l'entreprise de son père et n'entretient pas beaucoup d'illusions sur la vie. Olanna est une intellectuelle et avec son amant Odenigbo, leurs ami(e)s et relations, ils parlent politique et refont le monde.
Or, depuis l'indépendance en 1960 les tensions entre les Igbos et les autres principales ethnies du pays, les Haoussa-Foulani (nord) et les Yorouba (sud-ouest) à majorité musulmane ne cessent de monter. Cet état de fait va entraîner un bouleversement majeur dans la vie des deux sœurs igbos car après moult bouleversements politiques, un coup d’État militaire installe Yakubu Gawon au pouvoir et pousse la région du Nigéria oriental à faire sécession.
Ainsi le 30 mai 1967, son gouverneur militaire Odumegwu Ojukwu, proclame la "République indépendante du Biafra".
Malheureusement pour le Biafra, c'est la région du Nigéria la plus riche en ressources agricoles, minières et avant tout pétrolières puisqu'il recèle les deux tiers des réserves de pétrole du pays. Cette sécession ne sera donc pas tolérée et Gowon lance les hostilités pour récupérer son territoire : blocus alimentaire, offensives armées et bombardements aériens vont devenir le quotidien de nos personnages. Ils vont subir de plein fouet les conséquences de cette guerre soutenue par la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique et leur vie vire alors du banal au tragique.
Ce roman est pour moi une réelle prouesse car Chimamanda Ngozie Adichie nous "attrape" avec des personnages qui n'aspirent qu'à une vie simple et tranquille comme nous tous et qui vont être confrontés à ce qu’il y a de pire en ce monde, la guerre.
On les aime Olanna, Kainene, Ugwu, Richard, Odenigbo, Madu et tous les autres, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, on a peur pour eux, on pleure avec eux, on est heureux avec eux. Ainsi, tout le génie de l'auteure se révèle, car sans qu'on s'en aperçoive, on lit une page d’Histoire, celle de la Guerre du Biafra (1967-1970).
Une guerre qui n’a pas concerné grand monde. Nous regardions au journal télévisé ces enfants au ventre gonflé, ces os saillants et, au mieux, on versait une larme. On se dépêchait de "finir notre assiette" avant de sortir de table et on oubliait bien vite. Et pourtant cette guerre a fait plus d'un million de mort et rayé le Biafra de la carte. Ainsi, pour la citer, "le monde s’est tu pendant que nous mourrions", or, Chimamanda Ngozie Adichie ne serait pas là si ses parents Igbos n'avaient pas survécus et nous serions privés de cet excellent roman et de sa brillante auteure.
Ce roman se déroule dans les années 60 dans la région est du Nigéria peuplée aux deux tiers par les Igbos majoritairement chrétiens. On y suit en particulier les jumelles Olanna et Kainene qui se sont éloignées l'une de l'autre. Chacune de son côté vit un quotidien banal, avec son lot de petits bonheurs et de déceptions, mais qui les rend profondément attachantes. Le monde de Kainene est encré dans la réalité, elle travaille dans l'entreprise de son père et n'entretient pas beaucoup d'illusions sur la vie. Olanna est une intellectuelle et avec son amant Odenigbo, leurs ami(e)s et relations, ils parlent politique et refont le monde.
Or, depuis l'indépendance en 1960 les tensions entre les Igbos et les autres principales ethnies du pays, les Haoussa-Foulani (nord) et les Yorouba (sud-ouest) à majorité musulmane ne cessent de monter. Cet état de fait va entraîner un bouleversement majeur dans la vie des deux sœurs igbos car après moult bouleversements politiques, un coup d’État militaire installe Yakubu Gawon au pouvoir et pousse la région du Nigéria oriental à faire sécession.
Ainsi le 30 mai 1967, son gouverneur militaire Odumegwu Ojukwu, proclame la "République indépendante du Biafra".
Malheureusement pour le Biafra, c'est la région du Nigéria la plus riche en ressources agricoles, minières et avant tout pétrolières puisqu'il recèle les deux tiers des réserves de pétrole du pays. Cette sécession ne sera donc pas tolérée et Gowon lance les hostilités pour récupérer son territoire : blocus alimentaire, offensives armées et bombardements aériens vont devenir le quotidien de nos personnages. Ils vont subir de plein fouet les conséquences de cette guerre soutenue par la Grande-Bretagne et l'Union Soviétique et leur vie vire alors du banal au tragique.
Ce roman est pour moi une réelle prouesse car Chimamanda Ngozie Adichie nous "attrape" avec des personnages qui n'aspirent qu'à une vie simple et tranquille comme nous tous et qui vont être confrontés à ce qu’il y a de pire en ce monde, la guerre.
On les aime Olanna, Kainene, Ugwu, Richard, Odenigbo, Madu et tous les autres, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, on a peur pour eux, on pleure avec eux, on est heureux avec eux. Ainsi, tout le génie de l'auteure se révèle, car sans qu'on s'en aperçoive, on lit une page d’Histoire, celle de la Guerre du Biafra (1967-1970).
Une guerre qui n’a pas concerné grand monde. Nous regardions au journal télévisé ces enfants au ventre gonflé, ces os saillants et, au mieux, on versait une larme. On se dépêchait de "finir notre assiette" avant de sortir de table et on oubliait bien vite. Et pourtant cette guerre a fait plus d'un million de mort et rayé le Biafra de la carte. Ainsi, pour la citer, "le monde s’est tu pendant que nous mourrions", or, Chimamanda Ngozie Adichie ne serait pas là si ses parents Igbos n'avaient pas survécus et nous serions privés de cet excellent roman et de sa brillante auteure.
Dans ce premier roman de Chimamanda Ngozi Adichie, Kambili, une jeune Nigériane de 15 ans, nous raconte son calvaire sous le joug d'un père, certes adoré d'elle comme de beaucoup pour ses bonnes oeuvres, homme courageux, pieux catholique et riche entrepreneur, mais surtout tyran fanatique et violent dans sa famille. Puis son épanouissement auprès de Tatie Ifeoma et ses enfants, libres, bienveillants et joyeux.
Si le thème des violences familiales est (malheureusement) assez classique en littérature, l'originalité vient ici de l'ambivalence du père, côté pile un homme bon prêt à risquer sa vie pour lutter contre la dictature au Nigéria ou à aider sa communauté à bâtir des écoles, et côté face un fils qui a renié son père non-catholique, un mari qui frappe sa femme et un père qui n'a aucune tolérance pour les faiblesses de ses enfants.
Le point de vue de Kambili est très intéressant, car on la voit évoluer, ouvrir et apprendre à penser par elle-même. Elle aime et admire son père, toujours, mais découvre peu à peu une autre façon de vivre, avec moins d'argent et plus de tendresse, de rires, de curiosité, de réflexion personnelle...
Le Nigéria est très bien raconté : celui des pauvres comme celui des riches, les atteintes aux libertés comme la corruption, mais aussi la cuisine, l'habillement, les traditions, les paysages ou les voitures qui manquent d'essence.
En lisant, j'ai parfois été agacée par la lenteur, voire la langueur de l'histoire. Mais écrire ce commentaire me fait réaliser qu'elle tient surtout à la personnalité grave et calme de la narratrice Kambili. Et, comme Kambili, l'histoire recèle de trésors sous ses dehors tranquilles et un peu ennuyeux.
Si le thème des violences familiales est (malheureusement) assez classique en littérature, l'originalité vient ici de l'ambivalence du père, côté pile un homme bon prêt à risquer sa vie pour lutter contre la dictature au Nigéria ou à aider sa communauté à bâtir des écoles, et côté face un fils qui a renié son père non-catholique, un mari qui frappe sa femme et un père qui n'a aucune tolérance pour les faiblesses de ses enfants.
Le point de vue de Kambili est très intéressant, car on la voit évoluer, ouvrir et apprendre à penser par elle-même. Elle aime et admire son père, toujours, mais découvre peu à peu une autre façon de vivre, avec moins d'argent et plus de tendresse, de rires, de curiosité, de réflexion personnelle...
Le Nigéria est très bien raconté : celui des pauvres comme celui des riches, les atteintes aux libertés comme la corruption, mais aussi la cuisine, l'habillement, les traditions, les paysages ou les voitures qui manquent d'essence.
En lisant, j'ai parfois été agacée par la lenteur, voire la langueur de l'histoire. Mais écrire ce commentaire me fait réaliser qu'elle tient surtout à la personnalité grave et calme de la narratrice Kambili. Et, comme Kambili, l'histoire recèle de trésors sous ses dehors tranquilles et un peu ennuyeux.
Ce qu'il y a d'enthousiasmant à lire Americanah c'est qu'en entrant dans la vie de la narratrice, on a autant la sensation de la laisser entrer dans la nôtre. Bien que traitant de la conscience de l'identité raciale aux États-Unis dans toutes ses nuances, il y a quelque chose de familier ou de chaleureux dans ce roman. La personnalité d'Ifemelu double de l'auteure y participe grandement avec son intelligence intuitive, sa détermination et ses certitudes effilées, son refus de lisser ses cheveux témoignant de son refus de lisser son caractère, son humour, ses moments de désarroi et de stupéfaction.
Surtout avec une lucidité et une connivence rafraîchissantes, elle nous tend une loupe sous les yeux pour nous montrer le reflet de la somme des croyances et des comportements maladroits, la myriade de mots condescendants et les masques que l'on s'efforce de porter en société. L'exercice est sur ce point réussi.
Un esprit libre, l'oeil qui guette, une langue râpeuse à souhait,...j'ai tout aimé dans ce livre miroir qui reflète à travers le parcours d'une jeune Nigériane aux États-Unis, une critique sociale qui n'épargne personne. Il n'y a pas de discours sociologiques ou savants, simplement une fiction qui met habilement en lumière le déracinement culturel avec son cortège de sentiments inconfortables, l'identité pensée comme tension interne.
En réalité, j'ai presque tout aimé dans ce roman. Une vie amoureuse un peu moins théâtrale n'aurait nullement nui à l'ampleur romanesque du récit.
Surtout avec une lucidité et une connivence rafraîchissantes, elle nous tend une loupe sous les yeux pour nous montrer le reflet de la somme des croyances et des comportements maladroits, la myriade de mots condescendants et les masques que l'on s'efforce de porter en société. L'exercice est sur ce point réussi.
Un esprit libre, l'oeil qui guette, une langue râpeuse à souhait,...j'ai tout aimé dans ce livre miroir qui reflète à travers le parcours d'une jeune Nigériane aux États-Unis, une critique sociale qui n'épargne personne. Il n'y a pas de discours sociologiques ou savants, simplement une fiction qui met habilement en lumière le déracinement culturel avec son cortège de sentiments inconfortables, l'identité pensée comme tension interne.
En réalité, j'ai presque tout aimé dans ce roman. Une vie amoureuse un peu moins théâtrale n'aurait nullement nui à l'ampleur romanesque du récit.
On peut avoir plusieurs temps dans un poème. Le dernier quatrain n’est pas forcément celui que l’on préfère. La fin n’éclaire par forcément un roman. Mais une nouvelle est toute tendue vers sa chute. Toute sa saveur s’y révèle. On pourrait ajouter qu’une chute est rétroactive dans la mesure où elle colore toute la nouvelle d’une façon tragique, cynique ou joyeuse. Avec ces deux nouvelles vous ne serez pas déçus.
« Parce qu’ils avaient le ventre plein, les américains avaient le temps d’avoir peur que leurs enfants aient une maladie rare sur laquelle ils venaient de lire un article. » Chimamanda Ngozi Adichie part de ce qu’elle connait, l’immigration nigérienne aux Etats-Unis. Pour parfaire son processus de création littéraire, comme d’autres auteurs contemporains, en France David Lopez, elle est passée par des études universitaires de création littéraire, comme si non seulement être écrivain pouvait s’apprendre, relever d’une technique, d’exercices, mais en plus on pouvait y exceller au sortir d’une telle « masterclass » (d’ailleurs qu’en pensez-vous ?), ce qui semble de plus en plus répandu (voir le succès de Colum McCann « Lettres à un jeune auteur » récemment paru ou le master de l’écrivain Vincent Message à Paris).
« N’est-ce donc rien, pour vous, que d’être la fête de quelqu’un ? » Roland Barthes. S’illusionner. Se désillusionner. Un regard un peu appuyé, un rapprochement désinvolte, le sentiment qu’on nous observe, l’impression que ça y est on intéresse l’autre, on lui plaît….
C’est tout l’attrait de la première nouvelle « lundi de la semaine dernière », tout ce petit monde intérieur incroyablement addictif et réconfortant que l’on se créé, tout ce courage que l’on cherche en nous pour donner un coup de pouce au destin, dans l’intuition ou l’illusion d’avoir tapé dans l’œil de quelqu’un…
Les moments de gênes sont particulièrement bien déroulés, ces moments qu’on veut vite oublier dans nos quotidiens mais qui sous la plume de l’écrivaine nigérienne nous sont rapportés dans tous leurs méandres, ces instants qui durent une plombe tant on est mal à l’aise…
Certes les personnages portent avec eux l’immigration, le contraste entre les afro-américains et les nigériens, le melting pot des grandes villes américaines pleines de cultures entrechoquées, mais ce sont aussi des histoires de séduction, de désir, d’homosexualité encore trop corsetée, d’incapacité à tourner la page d’un amour toxique.
Un style résolument visuel, en partie peut-être à cause de l’invasion culturelle américaine qui, avec tout son cinéma et sa télévision a fini par créer en chacun de nous un imaginaire très dense qu’il est aisé de convoquer lors de sa lecture.
Qu’en pensez-vous ?
« Parce qu’ils avaient le ventre plein, les américains avaient le temps d’avoir peur que leurs enfants aient une maladie rare sur laquelle ils venaient de lire un article. » Chimamanda Ngozi Adichie part de ce qu’elle connait, l’immigration nigérienne aux Etats-Unis. Pour parfaire son processus de création littéraire, comme d’autres auteurs contemporains, en France David Lopez, elle est passée par des études universitaires de création littéraire, comme si non seulement être écrivain pouvait s’apprendre, relever d’une technique, d’exercices, mais en plus on pouvait y exceller au sortir d’une telle « masterclass » (d’ailleurs qu’en pensez-vous ?), ce qui semble de plus en plus répandu (voir le succès de Colum McCann « Lettres à un jeune auteur » récemment paru ou le master de l’écrivain Vincent Message à Paris).
« N’est-ce donc rien, pour vous, que d’être la fête de quelqu’un ? » Roland Barthes. S’illusionner. Se désillusionner. Un regard un peu appuyé, un rapprochement désinvolte, le sentiment qu’on nous observe, l’impression que ça y est on intéresse l’autre, on lui plaît….
C’est tout l’attrait de la première nouvelle « lundi de la semaine dernière », tout ce petit monde intérieur incroyablement addictif et réconfortant que l’on se créé, tout ce courage que l’on cherche en nous pour donner un coup de pouce au destin, dans l’intuition ou l’illusion d’avoir tapé dans l’œil de quelqu’un…
Les moments de gênes sont particulièrement bien déroulés, ces moments qu’on veut vite oublier dans nos quotidiens mais qui sous la plume de l’écrivaine nigérienne nous sont rapportés dans tous leurs méandres, ces instants qui durent une plombe tant on est mal à l’aise…
Certes les personnages portent avec eux l’immigration, le contraste entre les afro-américains et les nigériens, le melting pot des grandes villes américaines pleines de cultures entrechoquées, mais ce sont aussi des histoires de séduction, de désir, d’homosexualité encore trop corsetée, d’incapacité à tourner la page d’un amour toxique.
Un style résolument visuel, en partie peut-être à cause de l’invasion culturelle américaine qui, avec tout son cinéma et sa télévision a fini par créer en chacun de nous un imaginaire très dense qu’il est aisé de convoquer lors de sa lecture.
Qu’en pensez-vous ?
C'est le top des romans ...capillaires! Loin devant Des milliards de tapis de cheveux! Nattes, tresses, collées ou pas, extensions, boucles, défrisants, rien ne manque, et surtout pas l'ambiance du salon de coiffure où les échanges informels, bien au- delà des considérations météorologiques, en disent long sur le monde où nous vivons. La coiffure, souci quotidien de l'auteur, témoin de l'appartenance à un groupe, est ici un baromètre qui mesure le degré de conscience de la différence qui isole, et rend difficile l'acceptation de ce que l'on est.
Mais ce débat n'a lieu qu'au delà de l'Atlantique, lorsque le voyage qui a bercé les rêves de la jeunesse nigériane , vous fait juste prendre conscience que vous avez la peau foncée, afro-américaine ou Américain-Africain, et là deux solutions : tenter de s’assimiler au risque de se perdre, ou de lancer le débat, quoi de mieux qu’un blog pour le faire, ce sont les premiers pas qui coûtent.
Quinze ans aux Etats unis : le temps de vivre quelques histoires d’amour, jusqu’à ce que le cocktail de la nostalgie épicée d’un trait d’illusions perdues, et c’est le retour, dans un pays qui a continué à évoluer sans vous : les amis ont vieilli, la mondialisation est passée par là, et l’amour de sa vie a construit un nid avec quelqu’un d’autre. C’est comme cela que le questionnement existentiel choisit d’autres cibles.
Loin de couper les cheveux en quatre (c’est facile, mais je n’ai pas pu m’en empêcher) ce roman est un magnifique état des lieux des relatons humaines, avec au coeur du problème l’évolution de ce que l’on a appelle plus le racisme, mais qui cache sous des vocables politiquement corrects une réelle ségrégation. Le lexique ne suffit pas à effacer des siècles de confrontations plus ou moins violentes.
Le sujet n’est pas uniquement américain : en France, on n’est pas toujours net avec la cohabitaient. Dans une émission littéraire télévisée, l’auteur faisait remarquer qu’ici, on ne dit plus noir, mais black, comme on dit afro-américain plus à l’Ouest.
A travers le partage du parcours de la jeune nigériane, l’auteur crée de façon très adroite une belle connivence entre le lecteur et Ifemulu, et l’empathie grandit avec les pages qui se tournent.
La dernière partie traine un peu, et le dénouement se fait désirer, c’est le seul bémol pour cette lecture passionnante.
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Mais ce débat n'a lieu qu'au delà de l'Atlantique, lorsque le voyage qui a bercé les rêves de la jeunesse nigériane , vous fait juste prendre conscience que vous avez la peau foncée, afro-américaine ou Américain-Africain, et là deux solutions : tenter de s’assimiler au risque de se perdre, ou de lancer le débat, quoi de mieux qu’un blog pour le faire, ce sont les premiers pas qui coûtent.
Quinze ans aux Etats unis : le temps de vivre quelques histoires d’amour, jusqu’à ce que le cocktail de la nostalgie épicée d’un trait d’illusions perdues, et c’est le retour, dans un pays qui a continué à évoluer sans vous : les amis ont vieilli, la mondialisation est passée par là, et l’amour de sa vie a construit un nid avec quelqu’un d’autre. C’est comme cela que le questionnement existentiel choisit d’autres cibles.
Loin de couper les cheveux en quatre (c’est facile, mais je n’ai pas pu m’en empêcher) ce roman est un magnifique état des lieux des relatons humaines, avec au coeur du problème l’évolution de ce que l’on a appelle plus le racisme, mais qui cache sous des vocables politiquement corrects une réelle ségrégation. Le lexique ne suffit pas à effacer des siècles de confrontations plus ou moins violentes.
Le sujet n’est pas uniquement américain : en France, on n’est pas toujours net avec la cohabitaient. Dans une émission littéraire télévisée, l’auteur faisait remarquer qu’ici, on ne dit plus noir, mais black, comme on dit afro-américain plus à l’Ouest.
A travers le partage du parcours de la jeune nigériane, l’auteur crée de façon très adroite une belle connivence entre le lecteur et Ifemulu, et l’empathie grandit avec les pages qui se tournent.
La dernière partie traine un peu, et le dénouement se fait désirer, c’est le seul bémol pour cette lecture passionnante.
Lien : http://kittylamouette.blogsp..
Ayant moi-même fait l'acquisition de cet ouvrage pour la médiathèque pour laquelle je travaille, car sa quatrième de couv' m'avait intriguée, je tenais à vérifier ce qu'il en était réellement quant au contenu, savoir à quel types de lecteurs je pourrai le conseiller et surtout assouvir ma curiosité en constatant si l'écriture était belle, bien que je savais d'avance que le contenu serait, quant à lui, extrêmement dur !
La perte d'un être cher est toujours un événement bouleversant, pour ne pas dire traumatisant alors imaginez-vous celle d'un père, qui se produit en pleine période de pandémie (celle que nous traversons et subissons actuellement et ce, depuis près de deux ans) , alors que les aéroports sont paralysés, que l'interdiction de voyager à l'étranger est de rigueur et que cette fameuse personne, que l'on avait pris l'habitude de ne voir plus que par écran interposé vit dans un pays qui n'est plus le vôtre ! Eh bien, c'est ce qui est arrivé à notre auteure, Chimamanda Ngozi Adichie, d'origine nigérienne mais vivant actuellement aux Etats-Unis. Alors que frères et sœurs sont répartis sur trois continents différents, le chagrin est décuplé et les remords aussi ! La culpabilité aussi s'invite parfois et l'auteures nous livre ici un témoignage bouleversant des épreuves qu'elle a dues endurer tout au long de cette période sans toutefois tomber dans le pathos !
Un court essai, extrêmement bien écrit mais ô combien lourd de sens ! A découvrir et à faire découvrir mais tout en sachant dans quoi vous vous embarquez car il est impossible de ressortir indemne d'une telle lecture et pourtant, cette dernière m'a permis de relativiser sur bien des points et elle nous fait prendre conscience combien la vie est précieuse et mérite d'être vécue ! Un brillant hommage à un brillant professeur e'université mais avant tout à un homme, un père !
La perte d'un être cher est toujours un événement bouleversant, pour ne pas dire traumatisant alors imaginez-vous celle d'un père, qui se produit en pleine période de pandémie (celle que nous traversons et subissons actuellement et ce, depuis près de deux ans) , alors que les aéroports sont paralysés, que l'interdiction de voyager à l'étranger est de rigueur et que cette fameuse personne, que l'on avait pris l'habitude de ne voir plus que par écran interposé vit dans un pays qui n'est plus le vôtre ! Eh bien, c'est ce qui est arrivé à notre auteure, Chimamanda Ngozi Adichie, d'origine nigérienne mais vivant actuellement aux Etats-Unis. Alors que frères et sœurs sont répartis sur trois continents différents, le chagrin est décuplé et les remords aussi ! La culpabilité aussi s'invite parfois et l'auteures nous livre ici un témoignage bouleversant des épreuves qu'elle a dues endurer tout au long de cette période sans toutefois tomber dans le pathos !
Un court essai, extrêmement bien écrit mais ô combien lourd de sens ! A découvrir et à faire découvrir mais tout en sachant dans quoi vous vous embarquez car il est impossible de ressortir indemne d'une telle lecture et pourtant, cette dernière m'a permis de relativiser sur bien des points et elle nous fait prendre conscience combien la vie est précieuse et mérite d'être vécue ! Un brillant hommage à un brillant professeur e'université mais avant tout à un homme, un père !
Publié au mois d 'octobre 2003, "L 'hiibiscus pourpre"est le premier roman de l 'écrivaine nigériane ,Chimamanda Ngozi Adichie .Ce livre va servir de rampe de lancement à la carrière littéraire de son auteure .S 'ensuivent alors d'autres romans tels que : L'autre moitié du soleil ,Autour de ton cou, Nous sommes tous de Féministes et un de ses grands succès : Américanah etc...Ses différents romans vont contribuer à la notoriété de Chimamanda devenant ainsi une des grandes femmes de Lettres africaine .C 'est une militante des Droits de la Femme .A ce propos , elle disait :" Je suis une féministe heureuse !".Elle passe sa vie entre les USA et le Nigéria .
Dans" L'hibiscus pourpre", l 'auteure nous entraîne dans la vie d 'une famille chrétienne aisée ,sur fond de tumultes politiques des années 80 .Le récit est raconté par Kambili ,une jeune fille de quinze ans qui prend conscience de sa voix face à l'instabilité qui règne dans sa famille comme dans son pays .A travers les parcours des personnages du récit , l'auteure analyse les profondes séquelles du colonialisme et la violence engendrée par celui-ci tant sur le plan national que dans l 'intimité des Négirians .
Kambili est témoin et victime de plusieurs formes
d'oppression et la première qu 'elle subit est d 'ordre familial .Son père Eugène se montre en société tel un
symbole de générosité , toujours prêt à aider les plus démunis , à assister à tous les événements catholiques , à
lutter pour la liberté d 'expression à travers son journal ,il
conteste fermement les abus du pouvoir des politiciens .
Mais dans sa maison , il dicte à sa famille ses quatre volontés .Il ne tolère aucune incartade ou déviance .Il est irascible , intolérant , rigoriste et fanatique à l'extrême .
Au cours d 'un séjour chez leur tante Ifeoma qui élève seule ses trois enfants , Jaja et Kambili découvrent un foyer calme , paisible où il fait bon d 'y vivre .Les enfants
discutent entre eux et rient .Ils désirent , eux aussi vivre
dans un tel climat .Et de là va changer leur attitude envers
le père tyrannique .Il y a une prise de conscience chez-eux
Une fois que Jaja et Kambili retourneront chez-eux comment ou de quelle façon vont évoluer les rapports entre le père despotique et sa progéniture ? Là est toute la
question .
Un bon livre pour une écrivaine débutante .
Dans" L'hibiscus pourpre", l 'auteure nous entraîne dans la vie d 'une famille chrétienne aisée ,sur fond de tumultes politiques des années 80 .Le récit est raconté par Kambili ,une jeune fille de quinze ans qui prend conscience de sa voix face à l'instabilité qui règne dans sa famille comme dans son pays .A travers les parcours des personnages du récit , l'auteure analyse les profondes séquelles du colonialisme et la violence engendrée par celui-ci tant sur le plan national que dans l 'intimité des Négirians .
Kambili est témoin et victime de plusieurs formes
d'oppression et la première qu 'elle subit est d 'ordre familial .Son père Eugène se montre en société tel un
symbole de générosité , toujours prêt à aider les plus démunis , à assister à tous les événements catholiques , à
lutter pour la liberté d 'expression à travers son journal ,il
conteste fermement les abus du pouvoir des politiciens .
Mais dans sa maison , il dicte à sa famille ses quatre volontés .Il ne tolère aucune incartade ou déviance .Il est irascible , intolérant , rigoriste et fanatique à l'extrême .
Au cours d 'un séjour chez leur tante Ifeoma qui élève seule ses trois enfants , Jaja et Kambili découvrent un foyer calme , paisible où il fait bon d 'y vivre .Les enfants
discutent entre eux et rient .Ils désirent , eux aussi vivre
dans un tel climat .Et de là va changer leur attitude envers
le père tyrannique .Il y a une prise de conscience chez-eux
Une fois que Jaja et Kambili retourneront chez-eux comment ou de quelle façon vont évoluer les rapports entre le père despotique et sa progéniture ? Là est toute la
question .
Un bon livre pour une écrivaine débutante .
Americanah ! C’est le mot grinçant utilisé par les Nigérians restés au pays pour nommer leurs compatriotes partis vivre en Amérique. Une façon d’ironiser sur celles et ceux qui se font un devoir de corriger leur prononciation d’origine pour parler l’anglais comme les Américains.
Chimamanda Ngozy Adichie a été une Americanah. Elle est aujourd’hui une auteure majeure de la littérature anglophone contemporaine. Militante féministe et antiraciste, elle est considérée comme une intellectuelle de premier plan aux Etats-Unis, où elle s’était expatriée à l’âge de dix-neuf ans pour suivre des études universitaires. Aujourd’hui quadragénaire, elle partage sa vie entre Washington et Lagos. Nombre de ses ouvrages, romans, essais, poésies, ont été récompensés par des prix littéraires.
Fort de ses deux cents millions d’habitants, de ses importantes ressources en pétrole et de son économie diversifiée, on pourrait penser que le Nigeria ouvre des perspectives motivantes à ses jeunes, en tout cas à ceux qui ont la chance d’être issus de familles bourgeoises. Mais dans ce pays miné par l’instabilité politique, la corruption à grande échelle, la délinquance financière et des poussées de violence islamique, leur vie quotidienne est gâchée par l’immobilisme, l’incurie et la récurrence de grèves fréquentes.
A l’instar d’Ifemulu, personnage principale du roman et véritable double de l’auteure, nombreux sont les étudiants nigérians qui ont rêvé et rêvent encore de s’expatrier en Amérique. Ils y découvrent que l’Amérique n’est pas le pays de cocagne qu’ils avaient imaginé. « Rien de semblable aux jolies rues du Cosby show », constate tristement Ifemelu, lors de son arrivée à Brooklyn, où elle est hébergée par une cousine en échange de services ménagers. Elle n’est pas au bout de ses peines. Les études sont coûteuses et un visa d’étudiant n’autorise pas à travailler. Pour survivre, restent les petits boulots clandestins… quand ce n’est pas pire.
Americanah est un roman de mœurs, une critique drôle et féroce – mais jamais agressive ! – de la société américaine et de la bourgeoisie nigériane. Le talent de conteuse de l’auteure, son humour, son sens de la formule, la justesse de ses mots – parfaitement rendus par la traductrice – en font une lecture passionnante et jubilatoire tout au long de ses presque sept cents pages.
Le roman est aussi l’histoire de l’amour d’Ifemelu et d’Obinze. Ils sont adolescents quand ils se rencontrent. Ils tombent amoureux et sont convaincus qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Quand Ifemelu décide de partir pour l’Amerique, il est convenu qu’Obinze viendra la rejoindre rapidement. Mais rien ne se passe comme prévu. Ifemelu, en Amérique, vit des jours très difficiles et Obinze ne peut trouver mieux qu’une opportunité d’expatriation au Royaume Uni, une expérience qui se terminera de façon humiliante pour lui. Toujours est-il que leur relation se dissout...
Après bien des difficultés, Ifemelu finit par trouver ses marques en Amérique. Elle devient une blogueuse célèbre, dont les commentaires critiques et sarcastiques d’une Noire non américaine sur la société américaine font fureur. Elle avertit les Noirs qui viennent d’Afrique : c’est en arrivant en Amérique qu’elle avait pris conscience d’être une Noire. Une façon de dire qu’il n’y a de problème noir qu’en Amérique, héritage d’un passé, mémoire de l’esclavage, séquelle de la ségrégation. Un racisme avéré, que ne fait qu’attester un abus ridicule de formules « politiquement correctes ».
Quand quinze ans plus tard, Ifemelu décide de rentrer au Nigeria, elle y revoit Obinze. Il a fait fortune dans l’immobilier, est marié à une très jolie femme et est le père d’une petite fille. Quand ils se retrouvent, Ifemelu et Obinze constatent que, malgré leur si longue séparation, rien n’a changé entre eux. Comment cette histoire peut-elle se terminer ?
Je n’ai rien de commun avec Obinze, encore moins avec Ifemelu. Je ne suis pas nigérian, ni noir, je n’ai jamais vécu en Amérique, je ne me suis jamais demandé si les Noires devaient lisser leurs cheveux ou si elles devaient assumer des coiffures à l’afro ou à tresses, mais tout au long de ma lecture, je me suis trouvé en empathie totale avec ces deux personnages. Un ressenti dû à l’immense talent d’écriture de Chimamanda Ngozi Adichie.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Chimamanda Ngozy Adichie a été une Americanah. Elle est aujourd’hui une auteure majeure de la littérature anglophone contemporaine. Militante féministe et antiraciste, elle est considérée comme une intellectuelle de premier plan aux Etats-Unis, où elle s’était expatriée à l’âge de dix-neuf ans pour suivre des études universitaires. Aujourd’hui quadragénaire, elle partage sa vie entre Washington et Lagos. Nombre de ses ouvrages, romans, essais, poésies, ont été récompensés par des prix littéraires.
Fort de ses deux cents millions d’habitants, de ses importantes ressources en pétrole et de son économie diversifiée, on pourrait penser que le Nigeria ouvre des perspectives motivantes à ses jeunes, en tout cas à ceux qui ont la chance d’être issus de familles bourgeoises. Mais dans ce pays miné par l’instabilité politique, la corruption à grande échelle, la délinquance financière et des poussées de violence islamique, leur vie quotidienne est gâchée par l’immobilisme, l’incurie et la récurrence de grèves fréquentes.
A l’instar d’Ifemulu, personnage principale du roman et véritable double de l’auteure, nombreux sont les étudiants nigérians qui ont rêvé et rêvent encore de s’expatrier en Amérique. Ils y découvrent que l’Amérique n’est pas le pays de cocagne qu’ils avaient imaginé. « Rien de semblable aux jolies rues du Cosby show », constate tristement Ifemelu, lors de son arrivée à Brooklyn, où elle est hébergée par une cousine en échange de services ménagers. Elle n’est pas au bout de ses peines. Les études sont coûteuses et un visa d’étudiant n’autorise pas à travailler. Pour survivre, restent les petits boulots clandestins… quand ce n’est pas pire.
Americanah est un roman de mœurs, une critique drôle et féroce – mais jamais agressive ! – de la société américaine et de la bourgeoisie nigériane. Le talent de conteuse de l’auteure, son humour, son sens de la formule, la justesse de ses mots – parfaitement rendus par la traductrice – en font une lecture passionnante et jubilatoire tout au long de ses presque sept cents pages.
Le roman est aussi l’histoire de l’amour d’Ifemelu et d’Obinze. Ils sont adolescents quand ils se rencontrent. Ils tombent amoureux et sont convaincus qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Quand Ifemelu décide de partir pour l’Amerique, il est convenu qu’Obinze viendra la rejoindre rapidement. Mais rien ne se passe comme prévu. Ifemelu, en Amérique, vit des jours très difficiles et Obinze ne peut trouver mieux qu’une opportunité d’expatriation au Royaume Uni, une expérience qui se terminera de façon humiliante pour lui. Toujours est-il que leur relation se dissout...
Après bien des difficultés, Ifemelu finit par trouver ses marques en Amérique. Elle devient une blogueuse célèbre, dont les commentaires critiques et sarcastiques d’une Noire non américaine sur la société américaine font fureur. Elle avertit les Noirs qui viennent d’Afrique : c’est en arrivant en Amérique qu’elle avait pris conscience d’être une Noire. Une façon de dire qu’il n’y a de problème noir qu’en Amérique, héritage d’un passé, mémoire de l’esclavage, séquelle de la ségrégation. Un racisme avéré, que ne fait qu’attester un abus ridicule de formules « politiquement correctes ».
Quand quinze ans plus tard, Ifemelu décide de rentrer au Nigeria, elle y revoit Obinze. Il a fait fortune dans l’immobilier, est marié à une très jolie femme et est le père d’une petite fille. Quand ils se retrouvent, Ifemelu et Obinze constatent que, malgré leur si longue séparation, rien n’a changé entre eux. Comment cette histoire peut-elle se terminer ?
Je n’ai rien de commun avec Obinze, encore moins avec Ifemelu. Je ne suis pas nigérian, ni noir, je n’ai jamais vécu en Amérique, je ne me suis jamais demandé si les Noires devaient lisser leurs cheveux ou si elles devaient assumer des coiffures à l’afro ou à tresses, mais tout au long de ma lecture, je me suis trouvé en empathie totale avec ces deux personnages. Un ressenti dû à l’immense talent d’écriture de Chimamanda Ngozi Adichie.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Que se serait-il passé si Oliver Twist ou Anna Karenine étaient nés au Nigéria ? Peut-être seraient-ils devenus des Americanah comme Ifemelu... Ce n'est pas par hasard que j'évoque des classiques de la littérature pour débuter ma critique, car je ne serai pas étonnée que ce roman les rejoigne un jour tant il est riche et puissant.
Il nous retrace la vie d'Ifemelu, jeune bourgeoise nigériane qui part aux Etats-Unis pour ses études, et y découvre, pêle-mêle, qu'elle est noire, que la vie est dure et qu'elle a en elle bien plus de ressources qu'elle ne l'imaginait. En ce sens, c'est un livre très particulier et pourtant universel.
Particulier parce qu'il nous rappelle la condition des Noirs aux Etats-Unis au XXIè siècle, du racisme ordinaire aux discussions des intellectuels en passant par les problèmes capillaires liés aux cheveux crépus ou le sentiment d'exil.
Mais universel comme tous les romans d'apprentissage, car il y est question de doutes, de souffrance, de tâtonnements, d'amour, de famille, de honte, de résilience, de solitude, d'amitié, de joie, de rencontres, de quête...
Si on ajoute le talent d'Adichie pour raconter les histoires et dépeindre les émotions, on se retrouve avec un livre magistral. Félicitationah !
Il nous retrace la vie d'Ifemelu, jeune bourgeoise nigériane qui part aux Etats-Unis pour ses études, et y découvre, pêle-mêle, qu'elle est noire, que la vie est dure et qu'elle a en elle bien plus de ressources qu'elle ne l'imaginait. En ce sens, c'est un livre très particulier et pourtant universel.
Particulier parce qu'il nous rappelle la condition des Noirs aux Etats-Unis au XXIè siècle, du racisme ordinaire aux discussions des intellectuels en passant par les problèmes capillaires liés aux cheveux crépus ou le sentiment d'exil.
Mais universel comme tous les romans d'apprentissage, car il y est question de doutes, de souffrance, de tâtonnements, d'amour, de famille, de honte, de résilience, de solitude, d'amitié, de joie, de rencontres, de quête...
Si on ajoute le talent d'Adichie pour raconter les histoires et dépeindre les émotions, on se retrouve avec un livre magistral. Félicitationah !
Avec son roman Americanah, c'est un peu de l'âme de son pays et des propos sur les races et le racisme que nous livre Chimamanda Ngozi Adichie. Americanah c'est le parcours de Ifemelu, jeune adolescente jusqu'à l'âge de femme adulte. L'auteure raconte la vie de Ifemelu, ses études au Nigeria, son premier et grand amour qu'elle éprouve pour Obinze, son départ pour les États-Unis où elle poursuit ses études à l'Université. Ensuite, elle connaîtra la notoriété grâce à la tenue d'un Blog qu'elle a créé. Après quelques années et plusieurs aventures amoureuses, Ifemelu décide de rentrer au pays, un pays qu'elle trouve changé mais après tout ce temps vécut au USA, elle aussi est différente. Americanah, une lecture enrichissante.
Challenge Pavés 2015-2016
Challenge Pavés 2015-2016
Le moins qu’on puisse dire, c’est que je suis sortie de ma zone de confort avec ce roman historique qui nous plonge dans le Nigeria des années 60, au cœur d’un conflit dont je n’avais jamais entendu parler : la guerre du Biafra.
(À ce sujet, je me demande si je suis d’une ignorance crasse ou si l’Occident a vraiment la mémoire courte. J’ai cru comprendre que cette guerre avait été très médiatisée en son temps, mais je ne me rappelle pas avoir appris quoi que ce soit sur le sujet pendant mes années d’école, dans les années 90-2000… La seule chose qui s’en rapprocherait, ce serait le fameux cliché des « petits Africains qui meurent de faim », sur lequel l’autrice revient plusieurs fois au cours du roman.)
On suit le destin de deux sœurs jumelles, Olanna et Kainene, issues d’une classe aisée, dans un Nigeria tout juste indépendant qui ne tardera pas à basculer dans une guerre civile sanglante. Trois points de vue s’entremêlent : celui d’Olanna ; celui de Richard, aspirant écrivain blanc tombé amoureux du pays et de Kainene ; et celui d’Ugwu, le boy (domestique) d’Odenigbo, intellectuel idéaliste et compagnon d’Olanna.
Le roman est dur, très dur à lire, l’autrice ne nous épargne aucune des horreurs provoquées par la guerre et la manière dont celle-ci affecte les personnages. Les concernant, d’ailleurs, j’avoue que j’ai eu du mal à m’y attacher, et plusieurs m’ont même agacée (Odenigbo en particulier, Olanna et Richard également quoiqu’un peu moins, par contre j’ai bien aimé Ugwu et surtout Kainene – parce qu’on n’a jamais son point de vue, peut-être?) Pourtant, ces personnages ont une certaine profondeur psychologique, bien dépeinte par l’autrice, et en tant que lectrice, j’ai éprouvé tout au long du roman de l’empathie face à leur sort. Cela laisse à la lecture un sentiment troublant, peut-être voulu.
On ne peut pas dire que cette lecture soit plaisante, mais elle est définitivement saisissante. Le basculement dans l’horreur et la description des personnages obligé·es de la traverser, jour après jour, est très bien rendue, la façon dont cela vient relativiser tous les petits (et même les grands) drames du quotidien aussi. C’est long, oui, souvent pénible, mais cela rejoint bien le sentiment des personnages qui ont l’impression que ça n’en finit pas.
Rien à redire sur la qualité de l’écriture. Point bonus : j’ai lu ce livre en version audio et la performance d’Aïssa Maïga est époustouflante !
(À ce sujet, je me demande si je suis d’une ignorance crasse ou si l’Occident a vraiment la mémoire courte. J’ai cru comprendre que cette guerre avait été très médiatisée en son temps, mais je ne me rappelle pas avoir appris quoi que ce soit sur le sujet pendant mes années d’école, dans les années 90-2000… La seule chose qui s’en rapprocherait, ce serait le fameux cliché des « petits Africains qui meurent de faim », sur lequel l’autrice revient plusieurs fois au cours du roman.)
On suit le destin de deux sœurs jumelles, Olanna et Kainene, issues d’une classe aisée, dans un Nigeria tout juste indépendant qui ne tardera pas à basculer dans une guerre civile sanglante. Trois points de vue s’entremêlent : celui d’Olanna ; celui de Richard, aspirant écrivain blanc tombé amoureux du pays et de Kainene ; et celui d’Ugwu, le boy (domestique) d’Odenigbo, intellectuel idéaliste et compagnon d’Olanna.
Le roman est dur, très dur à lire, l’autrice ne nous épargne aucune des horreurs provoquées par la guerre et la manière dont celle-ci affecte les personnages. Les concernant, d’ailleurs, j’avoue que j’ai eu du mal à m’y attacher, et plusieurs m’ont même agacée (Odenigbo en particulier, Olanna et Richard également quoiqu’un peu moins, par contre j’ai bien aimé Ugwu et surtout Kainene – parce qu’on n’a jamais son point de vue, peut-être?) Pourtant, ces personnages ont une certaine profondeur psychologique, bien dépeinte par l’autrice, et en tant que lectrice, j’ai éprouvé tout au long du roman de l’empathie face à leur sort. Cela laisse à la lecture un sentiment troublant, peut-être voulu.
On ne peut pas dire que cette lecture soit plaisante, mais elle est définitivement saisissante. Le basculement dans l’horreur et la description des personnages obligé·es de la traverser, jour après jour, est très bien rendue, la façon dont cela vient relativiser tous les petits (et même les grands) drames du quotidien aussi. C’est long, oui, souvent pénible, mais cela rejoint bien le sentiment des personnages qui ont l’impression que ça n’en finit pas.
Rien à redire sur la qualité de l’écriture. Point bonus : j’ai lu ce livre en version audio et la performance d’Aïssa Maïga est époustouflante !
En ce jour d'été à Princeton, Ifemelu se trouve chez le coiffeur, et à un tournant de sa vie. Jeune Nigériane arrivée aux Etats-Unis treize ans plus tôt pour y faire ses études, elle a aujourd'hui décidé de rentrer au Nigeria. Pas nécessairement définitif, ce retour au pays fera d'elle une "Americanah", rentrant au bercail forte de son expérience à l'étranger pour se lancer dans les affaires ou dans la réalisation de ses rêves. Et peut-être pour renouer avec Obinze, son amour de jeunesse.
Assise chez le coiffeur, le cuir chevelu tiraillé par le tressage serré, elle se remémore ses années américaines et comment elle a pris conscience, en atterrissant aux USA, du fait qu'elle était Noire, avec pour corollaires le racisme et les difficultés d'intégration. Dèche financière, différences culturelles, fraternité bancale avec les Noirs américains, le rêve américain commence comme un cauchemar, mais Ifemelu ne se laisse pas abattre. Elle crée son blog et l'alimente d'articles et de réflexions explorant ces différents thèmes. le succès se profile, les possibilités de travail et l'amour aussi. Et l'intégration, pour autant qu'on puisse parler d'intégration dans un pays où les Noirs sont encore et toujours considérés comme des citoyens de seconde zone.
Pendant qu'Ifemelu se débrouille en Amérique, Obinze, quant à lui, tente sa chance à Londres. Là aussi, les voies de l'obtention d'un titre de séjour s'avèrent difficilement pénétrables...
De retour à Lagos, Ifemelu doit se réadapter à un pays qui a évolué sans elle, mais qui n'a pas renoncé à ses ambitions et à ses rêves.
Portrait d'une jeune femme issue d'une classe sociale favorisée au Nigeria et qui perd tous ses repères lors de son émigration aux USA,ce pavé se lit tout seul, grâce à l'indéniable talent de conteuse de l'auteure. Avec fluidité, humour et ironie, la narratrice, à travers son expérience mouvementée, nous livre ses réflexions sur l'identité (cocassement mais pertinemment symbolisée par les choix capillaires), le racisme, les relations interraciales, l'intégration, le déracinement, l'ambition, les désillusions. Pas besoin de couper les cheveux en quatre pour comprendre que mondialisation ne rime pas avec uniformisation. Roman d'apprentissage et roman d'amour, "Americanah" est un texte engagé, dense et sincère, passionnant.
Lien : https://voyagesaufildespages..
Assise chez le coiffeur, le cuir chevelu tiraillé par le tressage serré, elle se remémore ses années américaines et comment elle a pris conscience, en atterrissant aux USA, du fait qu'elle était Noire, avec pour corollaires le racisme et les difficultés d'intégration. Dèche financière, différences culturelles, fraternité bancale avec les Noirs américains, le rêve américain commence comme un cauchemar, mais Ifemelu ne se laisse pas abattre. Elle crée son blog et l'alimente d'articles et de réflexions explorant ces différents thèmes. le succès se profile, les possibilités de travail et l'amour aussi. Et l'intégration, pour autant qu'on puisse parler d'intégration dans un pays où les Noirs sont encore et toujours considérés comme des citoyens de seconde zone.
Pendant qu'Ifemelu se débrouille en Amérique, Obinze, quant à lui, tente sa chance à Londres. Là aussi, les voies de l'obtention d'un titre de séjour s'avèrent difficilement pénétrables...
De retour à Lagos, Ifemelu doit se réadapter à un pays qui a évolué sans elle, mais qui n'a pas renoncé à ses ambitions et à ses rêves.
Portrait d'une jeune femme issue d'une classe sociale favorisée au Nigeria et qui perd tous ses repères lors de son émigration aux USA,ce pavé se lit tout seul, grâce à l'indéniable talent de conteuse de l'auteure. Avec fluidité, humour et ironie, la narratrice, à travers son expérience mouvementée, nous livre ses réflexions sur l'identité (cocassement mais pertinemment symbolisée par les choix capillaires), le racisme, les relations interraciales, l'intégration, le déracinement, l'ambition, les désillusions. Pas besoin de couper les cheveux en quatre pour comprendre que mondialisation ne rime pas avec uniformisation. Roman d'apprentissage et roman d'amour, "Americanah" est un texte engagé, dense et sincère, passionnant.
Lien : https://voyagesaufildespages..
Un livre formidable ; on succombera normalement dès les premières lignes à un charme d'écriture particulièrement adhésif type velcro , et ainsi de suite pendant 500 pages ensorcelantes.
Mélange de petites anecdotes qui pourraient raser, contées d'une façon moins vivante, et de tracas existentiels universels, on suit avec passion l'itinéraire d' Ifemelu, jeune Nigériane aimantée par l'Amérique comme beaucoup de sa génération.
A son arrivée là-bas, elle apprend qu'elle est noire, ce qu'on lui fait remarquer par diverses vexations , ou dans le meilleur des cas par un excès de précautions oratoires et ronds de jambes destinés à éviter tout malaise et le créant précisément. L'Amérique comme électrochoc d'identité.
L'ami cher à son coeur, Obinze, atterrira en Angleterre, pour y récurer les latrines, lui, le fin lettré épris de belle littérature .
A ce sujet, j'ai été frappée de voir que les seules références qui tournaient parmi les étudiants privilégiés nigérians (années 1990-2000 semble-t-il) sont des classiques anglais du début XXe. Ils semblent d'ailleurs aspirer exclusivement à un modèle occidental. Et pas mal de condescendance pour les moins éduqués ou ceux qui restent au pays. Avatar post-colonisation, celle des désirs ?
L'idée taraude en fin de lecture : hormis la corruption comme coutume locale florissante, que sont devenus les millénaires passés ? Ce n'était pas le sujet de l'auteur, qui s'attache aux pensées et sentiments d' Ifemelu et de tous ceux qu'elle croise ou côtoie. Un auteur n'est certes pas tenu d'être le porte-étendard de son pays. Sa charge idéologique pourfend plutôt les préjugés raciaux ultra-tenaces. Par la voix de son héroïne, Chimamanda Ngozi Adichie ferraille de la pointe de l'épée leur impact persistant sur les mentalités en Amérique.
Mais le doute m' étreint : les 2 derniers siècles ont-ils réellement fait du petit bois de la richesse culturelle passée ? N'a -t il que le modèle occidental en ligne de mire ? On a tellement envie de leur dire , arrêtez tout les gars , on s'était planté en fait !
Quelques photos réchappées du tourbillon de l'histoire esquissent un monde igbo d'antan, et donnent l'énorme envie d'en savoir plus. Qui d'autre que des ethnologues était censé s'aventurer sur ces terres, remords anachronique et naïveté sans fond je sais.
L'auteur laisse de côté aussi les violences intestines qui ont laminé le pays.
Comme tout un chacun je pense, je m'attribue allégrement un doctorat de géopolitique , notamment le dimanche matin quand sirotant un triple expresso au lit , je refais le monde en délicieuse compagnie , Gandhi et mère Térésa rageant de concert contre l'aberration criminelle des frontières plaquées au petit bonheur la chance pour satisfaire le goût du pouvoir de pathétiques despotes, ignorant tout des cultures locales millénaires. Un pouvoir de nuisance phénoménal, aux effets sismiques terrifiants à très long terme. Sans oublier l'irremplaçable collaboration des missionnaires de tout poil dans le génocide des cultures.
Tout ça me donne envie de me replonger dans la collection « Terre humaine » de chez Plon, des ethnologues buvant les paroles et les gestes de cultures d'une complexité extravagante, de cosmogonies raffinées, quels trésors !
Mélange de petites anecdotes qui pourraient raser, contées d'une façon moins vivante, et de tracas existentiels universels, on suit avec passion l'itinéraire d' Ifemelu, jeune Nigériane aimantée par l'Amérique comme beaucoup de sa génération.
A son arrivée là-bas, elle apprend qu'elle est noire, ce qu'on lui fait remarquer par diverses vexations , ou dans le meilleur des cas par un excès de précautions oratoires et ronds de jambes destinés à éviter tout malaise et le créant précisément. L'Amérique comme électrochoc d'identité.
L'ami cher à son coeur, Obinze, atterrira en Angleterre, pour y récurer les latrines, lui, le fin lettré épris de belle littérature .
A ce sujet, j'ai été frappée de voir que les seules références qui tournaient parmi les étudiants privilégiés nigérians (années 1990-2000 semble-t-il) sont des classiques anglais du début XXe. Ils semblent d'ailleurs aspirer exclusivement à un modèle occidental. Et pas mal de condescendance pour les moins éduqués ou ceux qui restent au pays. Avatar post-colonisation, celle des désirs ?
L'idée taraude en fin de lecture : hormis la corruption comme coutume locale florissante, que sont devenus les millénaires passés ? Ce n'était pas le sujet de l'auteur, qui s'attache aux pensées et sentiments d' Ifemelu et de tous ceux qu'elle croise ou côtoie. Un auteur n'est certes pas tenu d'être le porte-étendard de son pays. Sa charge idéologique pourfend plutôt les préjugés raciaux ultra-tenaces. Par la voix de son héroïne, Chimamanda Ngozi Adichie ferraille de la pointe de l'épée leur impact persistant sur les mentalités en Amérique.
Mais le doute m' étreint : les 2 derniers siècles ont-ils réellement fait du petit bois de la richesse culturelle passée ? N'a -t il que le modèle occidental en ligne de mire ? On a tellement envie de leur dire , arrêtez tout les gars , on s'était planté en fait !
Quelques photos réchappées du tourbillon de l'histoire esquissent un monde igbo d'antan, et donnent l'énorme envie d'en savoir plus. Qui d'autre que des ethnologues était censé s'aventurer sur ces terres, remords anachronique et naïveté sans fond je sais.
L'auteur laisse de côté aussi les violences intestines qui ont laminé le pays.
Comme tout un chacun je pense, je m'attribue allégrement un doctorat de géopolitique , notamment le dimanche matin quand sirotant un triple expresso au lit , je refais le monde en délicieuse compagnie , Gandhi et mère Térésa rageant de concert contre l'aberration criminelle des frontières plaquées au petit bonheur la chance pour satisfaire le goût du pouvoir de pathétiques despotes, ignorant tout des cultures locales millénaires. Un pouvoir de nuisance phénoménal, aux effets sismiques terrifiants à très long terme. Sans oublier l'irremplaçable collaboration des missionnaires de tout poil dans le génocide des cultures.
Tout ça me donne envie de me replonger dans la collection « Terre humaine » de chez Plon, des ethnologues buvant les paroles et les gestes de cultures d'une complexité extravagante, de cosmogonies raffinées, quels trésors !
Tout simplement éblouissant.
Ce petit essai est un condensé de toute l'intelligence de Chimamanda Ngozi Adichie, cette belle nigériane qui fait partie de ces femmes qui affirment qu'une apparence féminine et un intellect de haut vol ne sont pas incompatibles.
L'auteur part non seulement de ses connaissances mais aussi de son expérience personnelle au Nigéria et aux Etats-Unis pour parler de ces petits "riens" qui font qu'il est parfois difficile d'être une femme dans nos société moderne. Le tout servi par une écriture très fluide ; et cela donne la sensation que l'auteur est en pleine conversation 'amicale' avec nous.
Inutile de faire un développement sur les arguments qu'elle avance - à chacun de le lire ! -, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'elle met en avant la responsabilité de chacun dans ce résultat. Notre société à beaucoup changée ces 100 dernières années, par contre l'éducation et les représentations que nous ne faisons de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme... beaucoup moins !
Alors oui, nous avons tous notre responsabilité. Et notre responsabilité de lecteur intelligent consiste à se précipiter sur ce livre !
Ce petit essai est un condensé de toute l'intelligence de Chimamanda Ngozi Adichie, cette belle nigériane qui fait partie de ces femmes qui affirment qu'une apparence féminine et un intellect de haut vol ne sont pas incompatibles.
L'auteur part non seulement de ses connaissances mais aussi de son expérience personnelle au Nigéria et aux Etats-Unis pour parler de ces petits "riens" qui font qu'il est parfois difficile d'être une femme dans nos société moderne. Le tout servi par une écriture très fluide ; et cela donne la sensation que l'auteur est en pleine conversation 'amicale' avec nous.
Inutile de faire un développement sur les arguments qu'elle avance - à chacun de le lire ! -, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'elle met en avant la responsabilité de chacun dans ce résultat. Notre société à beaucoup changée ces 100 dernières années, par contre l'éducation et les représentations que nous ne faisons de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme... beaucoup moins !
Alors oui, nous avons tous notre responsabilité. Et notre responsabilité de lecteur intelligent consiste à se précipiter sur ce livre !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Les romans les mieux notés
heros_pitch
195 livres

Le livre qui vous a bouleversé
Mijouet
136 livres
Auteurs proches de Chimamanda Ngozi Adichie
Lecteurs de Chimamanda Ngozi Adichie Voir plus
Quiz
Voir plus
Americanah
What is the name of the main protagonist in the novel "Americanah"?
Obinze
Curt
Ifemelu
Dike
10 questions
2 lecteurs ont répondu
Thème : Americanah de
Chimamanda Ngozi AdichieCréer un quiz sur cet auteur2 lecteurs ont répondu