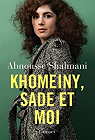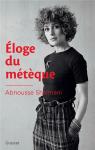Critiques de Abnousse Shalmani (107)
Corps à corps de deux destins qui s'embrassent.
Lors d'une lecture de ses poèmes, Forough Farrokhzad, la poète iranienne, est abordée par un jeune homme timide, Cyrus, qui va lui présenter des oeuvres, qu'il a lui même traduites en persan, de Pierre Louys un poète à l'érotisme debridé. Forough est fascinée, non seulement par les écrits de Ĺouys mais également par son amante Marie de Régnier.
L'artiste iranienne se sent étouffée par une société qui réprime ses envies de liberté. Elle se met à rêver de la Belle Époque et de cette femme sensuelle qui a fait le choix de la passion amoureuse. Des amants et amantes qui défilent entre deux poèmes et du bonheur d'aimer librement sans se soucier du regard conformiste de la morale...
Abnousse Shalmani croise les vies de deux femmes ecrivains pourtant séparées par un abîme culturel mais qui sont prêtes à tout sacrifier pour donner corps à leurs désirs dans une liberté absolue.
Une vie jalonnée de "je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie " puis de plus rien du tout, de déceptions, de trahisons. Face au bonheur quotidien, des idéaux incandescents souvent destructeurs, faits de lendemains qui ne se font jamais jours, à l'origine d'une création artistique parfois exceptionnelle.
"J'ai péché, péché dans le plaisir,
dans des bras chauds et enflammés,
J'ai péché, péché dans des bras de fer,
dans des bras brûlants et rancuniers,"
Dans l'intégralité de ce poème paru dans le recueil "Le mur" en 1955, Forough Farrokhzad met à nu ses infidélités et confirme à son ex mari qui n'a jamais su la comprendre qu'elle est une femme libre. Une femme en quête d'un Amour qui lui paraît insaisissable...
Lors d'une lecture de ses poèmes, Forough Farrokhzad, la poète iranienne, est abordée par un jeune homme timide, Cyrus, qui va lui présenter des oeuvres, qu'il a lui même traduites en persan, de Pierre Louys un poète à l'érotisme debridé. Forough est fascinée, non seulement par les écrits de Ĺouys mais également par son amante Marie de Régnier.
L'artiste iranienne se sent étouffée par une société qui réprime ses envies de liberté. Elle se met à rêver de la Belle Époque et de cette femme sensuelle qui a fait le choix de la passion amoureuse. Des amants et amantes qui défilent entre deux poèmes et du bonheur d'aimer librement sans se soucier du regard conformiste de la morale...
Abnousse Shalmani croise les vies de deux femmes ecrivains pourtant séparées par un abîme culturel mais qui sont prêtes à tout sacrifier pour donner corps à leurs désirs dans une liberté absolue.
Une vie jalonnée de "je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie " puis de plus rien du tout, de déceptions, de trahisons. Face au bonheur quotidien, des idéaux incandescents souvent destructeurs, faits de lendemains qui ne se font jamais jours, à l'origine d'une création artistique parfois exceptionnelle.
"J'ai péché, péché dans le plaisir,
dans des bras chauds et enflammés,
J'ai péché, péché dans des bras de fer,
dans des bras brûlants et rancuniers,"
Dans l'intégralité de ce poème paru dans le recueil "Le mur" en 1955, Forough Farrokhzad met à nu ses infidélités et confirme à son ex mari qui n'a jamais su la comprendre qu'elle est une femme libre. Une femme en quête d'un Amour qui lui paraît insaisissable...
Lorsque j'étais étudiant à Paris et étais logé à la Maison Belge de la cité universitaire, Boulevard Jourdan, j'allais fréquemment prendre mon café à la Maison d'Iran tout proche : le café y était meilleur et les étudiantes plus jolies.
C'était l'époque précédant la révolution des mollahs, des ayatollahs, des barbus et des corbeaux, où regarder une belle fille n'équivalait pas automatiquement à un péché capital ou à un poing direction Allah.
J'ai bien aimé comment la petite Abnousse Shalmani, à Téhéran à 6 ans, se mettait à poil, et 2 ans plus tard, couvrait les murs de sa chambre à Paris d'images de nues, pour tourner en dérision les prescriptions vestimentaires ridicules des mollahs. Ou comme la gamine le formule elle-même : "ça fait fuir les barbus". (page 98).
L'auteure explique de façon tout à fait convaincante la stupidité et l'hypocrisie de ces obsessions vestimentaires des gris et vieux mollahs. En couvrant le corps des femmes, pour qu'elles n'aient pas l'air de putes, ces messieurs obtenaient exactement le contraire. Les hommes détaillèrent le corps des femmes pour soi-disant être sûr que ni une mèche rebelle ni un bout d'orteil nu (horreur) ne soit visible. Et dire que du temps de Rouhollah Khomeiny (1902-1989) et de ses illustres successeurs, des dizaines de milliers de gardiens de la Révolution et des agents de la police des moeurs passaient leur temps à contrôler sans pitié l'application stricte des normes vestimentaires ! Ces braves gens auraient mieux fait de labourer la terre, plutôt que d'enquiquiner et parfois carrément d'abuser des femmes.
Bien que non-croyant, je sais naturellement que chaque religion dispose de préceptes, règles, traditions, ... qui ne soient pas simples à comprendre, la "awra" islamique ou toute partie du corps qui doit être obligatoirement couverte en est un parfait exemple, comparable à la sainte trinité et immaculée conception chez les catholiques par exemple. Peu importe la sémantique d'ailleurs, l'interprétation particulière de la "awra" par les ayatollahs chiites résulte pour les femmes dans une injustice et discrimination effarantes.
Abnousse Shalmani est née à Téhéran en 1977, un 1er avril, qui deviendra, par une amère ironie du sort, 2 ans plus tard, le jour de la proclamation officielle de la république théocratique islamique d'Iran. Pour l'auteure donc un double anniversaire.
Son ouvrage constitue pour une large part un récit de sa prime enfance et adolescence de 1977 à 1985 dans la capitale iranienne et à partir de 1985 à Paris, où sa famille a fui le régime de Khomeiny et consorts.
L'ouvrage est conçu en des brefs chapitres, qui au début alternent Téhéran avec Paris, à partir de la prise de pouvoir par Khomeiny et sa clique, jusqu'à la période 2012-2013 à Paris. L'ensemble fait 334 pages.
Il sort amplement de son récit que la petite Anousse était déjà comme gamine une forte tête aux idées originales. Son père étant un érudit et grand lecteur, elle passait également beaucoup de temps dans les livres. À peine arrivée en France, son père lui fit apprendre la langue du pays en lui passant "Les Misérables" de Victor Hugo. Si Fantine et Cosette devenaient ses héroïnes, ce fut Jean Valjean qui devint son guide.
"J'ai très vite perdu ma langue maternelle. La faute à Hugo, certainement. Mais surtout à Khomeiny. Le persan était trop lié à Téhéran et aux barbus..."
Avant de partir pour la douce France, la petite Abnousse a encore connu la frayeur des bombardements de sa ville natale, à la suite de la guerre entre moustachus et barbus. La guerre Iran-Irak qui a été déclenchée en septembre 1980 et a duré 8 longues années et dont le nombre de morts est estimé à 1,2 million de militaires et civils.
En France, après avoir obtenu un diplôme d'histoire, l'auteure s'est lancée dans la réalisation de courts-métrages documentaires et est finalement retournée à son amour de jeunesse : les livres. En 2014 l'essai présent et en 2019 un autre essai "Éloge du métèque". L'année précédente elle avait publié son premier roman, "Les exilés meurent aussi d'amour".
Moi, qui ne regarde que très rarement la télé, même en période de confinement comme maintenant, je suis un jour, d'ailleurs tout à fait par hasard, tombé sur un débat d'actualité politique auquel participait Abnousse Shalmani et j'ai été impressionné par ses vastes connaissances et sa façon convaincante de présenter ses arguments. J'ignorais encore qui était cette Iranienne au juste, mais je me souviens d'avoir fait la réflexion que dans un sérieux débat avec cette Abnousse, il valait mieux se trouver de son côté.
C'était l'époque précédant la révolution des mollahs, des ayatollahs, des barbus et des corbeaux, où regarder une belle fille n'équivalait pas automatiquement à un péché capital ou à un poing direction Allah.
J'ai bien aimé comment la petite Abnousse Shalmani, à Téhéran à 6 ans, se mettait à poil, et 2 ans plus tard, couvrait les murs de sa chambre à Paris d'images de nues, pour tourner en dérision les prescriptions vestimentaires ridicules des mollahs. Ou comme la gamine le formule elle-même : "ça fait fuir les barbus". (page 98).
L'auteure explique de façon tout à fait convaincante la stupidité et l'hypocrisie de ces obsessions vestimentaires des gris et vieux mollahs. En couvrant le corps des femmes, pour qu'elles n'aient pas l'air de putes, ces messieurs obtenaient exactement le contraire. Les hommes détaillèrent le corps des femmes pour soi-disant être sûr que ni une mèche rebelle ni un bout d'orteil nu (horreur) ne soit visible. Et dire que du temps de Rouhollah Khomeiny (1902-1989) et de ses illustres successeurs, des dizaines de milliers de gardiens de la Révolution et des agents de la police des moeurs passaient leur temps à contrôler sans pitié l'application stricte des normes vestimentaires ! Ces braves gens auraient mieux fait de labourer la terre, plutôt que d'enquiquiner et parfois carrément d'abuser des femmes.
Bien que non-croyant, je sais naturellement que chaque religion dispose de préceptes, règles, traditions, ... qui ne soient pas simples à comprendre, la "awra" islamique ou toute partie du corps qui doit être obligatoirement couverte en est un parfait exemple, comparable à la sainte trinité et immaculée conception chez les catholiques par exemple. Peu importe la sémantique d'ailleurs, l'interprétation particulière de la "awra" par les ayatollahs chiites résulte pour les femmes dans une injustice et discrimination effarantes.
Abnousse Shalmani est née à Téhéran en 1977, un 1er avril, qui deviendra, par une amère ironie du sort, 2 ans plus tard, le jour de la proclamation officielle de la république théocratique islamique d'Iran. Pour l'auteure donc un double anniversaire.
Son ouvrage constitue pour une large part un récit de sa prime enfance et adolescence de 1977 à 1985 dans la capitale iranienne et à partir de 1985 à Paris, où sa famille a fui le régime de Khomeiny et consorts.
L'ouvrage est conçu en des brefs chapitres, qui au début alternent Téhéran avec Paris, à partir de la prise de pouvoir par Khomeiny et sa clique, jusqu'à la période 2012-2013 à Paris. L'ensemble fait 334 pages.
Il sort amplement de son récit que la petite Anousse était déjà comme gamine une forte tête aux idées originales. Son père étant un érudit et grand lecteur, elle passait également beaucoup de temps dans les livres. À peine arrivée en France, son père lui fit apprendre la langue du pays en lui passant "Les Misérables" de Victor Hugo. Si Fantine et Cosette devenaient ses héroïnes, ce fut Jean Valjean qui devint son guide.
"J'ai très vite perdu ma langue maternelle. La faute à Hugo, certainement. Mais surtout à Khomeiny. Le persan était trop lié à Téhéran et aux barbus..."
Avant de partir pour la douce France, la petite Abnousse a encore connu la frayeur des bombardements de sa ville natale, à la suite de la guerre entre moustachus et barbus. La guerre Iran-Irak qui a été déclenchée en septembre 1980 et a duré 8 longues années et dont le nombre de morts est estimé à 1,2 million de militaires et civils.
En France, après avoir obtenu un diplôme d'histoire, l'auteure s'est lancée dans la réalisation de courts-métrages documentaires et est finalement retournée à son amour de jeunesse : les livres. En 2014 l'essai présent et en 2019 un autre essai "Éloge du métèque". L'année précédente elle avait publié son premier roman, "Les exilés meurent aussi d'amour".
Moi, qui ne regarde que très rarement la télé, même en période de confinement comme maintenant, je suis un jour, d'ailleurs tout à fait par hasard, tombé sur un débat d'actualité politique auquel participait Abnousse Shalmani et j'ai été impressionné par ses vastes connaissances et sa façon convaincante de présenter ses arguments. J'ignorais encore qui était cette Iranienne au juste, mais je me souviens d'avoir fait la réflexion que dans un sérieux débat avec cette Abnousse, il valait mieux se trouver de son côté.
L’auteure nous raconte, par la voix de Shirin, petite fille âgée de neuf ans, l’histoire d’une famille qui a fui l’Iran et les persécutions, à l’époque du Shah, car ils étaient intellectuels et surtout communistes. Les parents de Shirin sont arrivés les derniers à Paris et sont logés par les sœurs de sa mère.
La mère de Shirin, est prête à tout pour être aimée et reconnue par ses sœurs, dominatrices, surtout l’aînée, qui est odieuse, narcissique, maltraitante. Elle devient leur esclave, fait la cuisine, le ménage, sans que personne, jamais, ne daigne lui dire merci.
Son père est professeur ; il supporte sans broncher le climat de haine et de mépris distillé par ses belles-sœurs, qui se comportent en mères maquerelles, monopolisant l’argent qu’il gagne sous prétexte qu’elles l’hébergent. C’est un homme plutôt brillant et la situation le désole. « Les sœurs » le dénigrent sans cesse devant sa femme et sa fille car il ne partage pas leur vision de la société et leur communisme aveugle qui les conduisent à des actes violents.
Les relations entre ses parents sont bien abordées également et avec les yeux de petite fille qui voit bien que la relation au corps est étrange, de même que l’amour ou les gestes de tendresse que la mère ne peut pas effectuer du fait du poids des traditions, et tente de transmettre son amour maternel par le biais de la cuisine : »je te nourris, donc je t’aime, mais je ne te le dis pas, ce n’est pas possible, ni envisageable…
« Ma mère, incapable de dire son amour et son ressenti depuis l’enfance, cuisinait pour compenser et sa cuisine-amour était forcément trop abondante, enrichie de tout ce qu’elle avait sur le cœur et qui n’était jamais passé par ses lèvres. » P 63
On a aussi le patriarche, le grand-père de Shirin, vieux, usé mais l’œil toujours aussi pervers. On comprend très vite qu’il s’est passé quelque chose de grave entre lui et ses filles.
Pour échapper à la violence psychologique qui règne dans la maison, Shirin fait une fugue et elle est ramenée à la maison par Omid, le « compagnon » de sa tante. C’est un homme à l’esprit ouvert qui va l’aider à maîtriser le français, la guider dans ses lectures et bien-sûr, la petite fille en tombe amoureuse, au grand dam de la famille.
Shirin, coincée entre deux cultures, a du mal à trouver sa place :
« Et puis je n’avais pas la gueule de l’emploi : ni celle de ma famille, ni celle de la France. Trop occidentale pour l’Iran, pas assez typée pour la France. Et pourtant. Il y avait quelque chose de métèque en moi qui persistait et que je ne voulais pas effacer. Quelque chose me disait que la boue où j’avais grandi était la bonne matière à travailler pour trouver mon vrai visage. » P 265
Abnousse Shalmani étrille au passage cette famille communiste pure et dure qui reste aveuglée par le mythe, la pensée unique (« il vaut mieux avoir tort avec le parti que raison sans le parti » comme le prétendait un ténor communiste il n’y a pas si longtemps), refusant de voir les dérives, n’hésitant pas à commettre des attentats au nom de la cause.
Elle nous parle aussi très bien et de manière parfois drôle de la dureté de l’exil, d’être à cheval sur deux cultures dans un pays où le statut de la femme est totalement différent. Les tantes continuent les fêtes, les coutumes, et le poids des traditions est omniprésent. Je suis sortie de cette lecture avec des saveurs et des odeurs plein la tête. Elle écrit ceci :
« On était bien obligé de s’y faire et de choisir son clan. De s’ancrer pour ne pas être écrasé. (Ce fut une illusion aussi : j’ai longtemps cru qu’en me plongeant dans la France, je finirais par avoir son visage. Mais l’exilé n’a pas d’autre visage que celui de l’exil :il ne sera jamais son pays d’adoption, pas davantage que le pays natal. J’ai fini écrasée comme tous les exilés entre un souvenir et un espoir.) » P 97
J’ai beaucoup aimé ce roman, les personnages de cette saga familiale, avec son lot de secrets, de haine et jalousie. L’écriture est belle et invite au voyage. C’est mon préféré parmi les cinq romans que la FNAC m’a proposé.
Ce roman est un véritable coup de foudre et j’espère qu’il aura le succès qu’il mérite et ne sera pas trop noyé dans la masse des romans de la rentrée, parmi les auteurs reconnus et encensés qui produisent un roman à chaque rentrée et qu’on verra partout pontifier (pour certains du moins !)
Lien : https://leslivresdeve.wordpr..
La mère de Shirin, est prête à tout pour être aimée et reconnue par ses sœurs, dominatrices, surtout l’aînée, qui est odieuse, narcissique, maltraitante. Elle devient leur esclave, fait la cuisine, le ménage, sans que personne, jamais, ne daigne lui dire merci.
Son père est professeur ; il supporte sans broncher le climat de haine et de mépris distillé par ses belles-sœurs, qui se comportent en mères maquerelles, monopolisant l’argent qu’il gagne sous prétexte qu’elles l’hébergent. C’est un homme plutôt brillant et la situation le désole. « Les sœurs » le dénigrent sans cesse devant sa femme et sa fille car il ne partage pas leur vision de la société et leur communisme aveugle qui les conduisent à des actes violents.
Les relations entre ses parents sont bien abordées également et avec les yeux de petite fille qui voit bien que la relation au corps est étrange, de même que l’amour ou les gestes de tendresse que la mère ne peut pas effectuer du fait du poids des traditions, et tente de transmettre son amour maternel par le biais de la cuisine : »je te nourris, donc je t’aime, mais je ne te le dis pas, ce n’est pas possible, ni envisageable…
« Ma mère, incapable de dire son amour et son ressenti depuis l’enfance, cuisinait pour compenser et sa cuisine-amour était forcément trop abondante, enrichie de tout ce qu’elle avait sur le cœur et qui n’était jamais passé par ses lèvres. » P 63
On a aussi le patriarche, le grand-père de Shirin, vieux, usé mais l’œil toujours aussi pervers. On comprend très vite qu’il s’est passé quelque chose de grave entre lui et ses filles.
Pour échapper à la violence psychologique qui règne dans la maison, Shirin fait une fugue et elle est ramenée à la maison par Omid, le « compagnon » de sa tante. C’est un homme à l’esprit ouvert qui va l’aider à maîtriser le français, la guider dans ses lectures et bien-sûr, la petite fille en tombe amoureuse, au grand dam de la famille.
Shirin, coincée entre deux cultures, a du mal à trouver sa place :
« Et puis je n’avais pas la gueule de l’emploi : ni celle de ma famille, ni celle de la France. Trop occidentale pour l’Iran, pas assez typée pour la France. Et pourtant. Il y avait quelque chose de métèque en moi qui persistait et que je ne voulais pas effacer. Quelque chose me disait que la boue où j’avais grandi était la bonne matière à travailler pour trouver mon vrai visage. » P 265
Abnousse Shalmani étrille au passage cette famille communiste pure et dure qui reste aveuglée par le mythe, la pensée unique (« il vaut mieux avoir tort avec le parti que raison sans le parti » comme le prétendait un ténor communiste il n’y a pas si longtemps), refusant de voir les dérives, n’hésitant pas à commettre des attentats au nom de la cause.
Elle nous parle aussi très bien et de manière parfois drôle de la dureté de l’exil, d’être à cheval sur deux cultures dans un pays où le statut de la femme est totalement différent. Les tantes continuent les fêtes, les coutumes, et le poids des traditions est omniprésent. Je suis sortie de cette lecture avec des saveurs et des odeurs plein la tête. Elle écrit ceci :
« On était bien obligé de s’y faire et de choisir son clan. De s’ancrer pour ne pas être écrasé. (Ce fut une illusion aussi : j’ai longtemps cru qu’en me plongeant dans la France, je finirais par avoir son visage. Mais l’exilé n’a pas d’autre visage que celui de l’exil :il ne sera jamais son pays d’adoption, pas davantage que le pays natal. J’ai fini écrasée comme tous les exilés entre un souvenir et un espoir.) » P 97
J’ai beaucoup aimé ce roman, les personnages de cette saga familiale, avec son lot de secrets, de haine et jalousie. L’écriture est belle et invite au voyage. C’est mon préféré parmi les cinq romans que la FNAC m’a proposé.
Ce roman est un véritable coup de foudre et j’espère qu’il aura le succès qu’il mérite et ne sera pas trop noyé dans la masse des romans de la rentrée, parmi les auteurs reconnus et encensés qui produisent un roman à chaque rentrée et qu’on verra partout pontifier (pour certains du moins !)
Lien : https://leslivresdeve.wordpr..
Cyrus, dit la Tortue, a traduit en persan les poèmes de Pierre Louÿs ; il raconte sa vie et celle de son grand amour, Marie de Régnier, à la poète iranienne Forough Farrokhzad.
A travers celle de Marie, Forough entrevoit la vie dont elle aurait rêvé.
Abnousse Shalmani entrelace deux destins de femmes libres et créatives :
celui de Forough Farrokhzad, dans les années 1950, en Iran, dont la carrière littéraire a été fulgurante (elle meurt à 32 ans dans un accident de voiture) et celui de Marie de Régnier, à Paris, à la Belle Époque.
Elle entrechoque les époques, les pays, les cultures…
Le roman est inspiré de deux vies réelles ; l’auteur nous fait revisiter la très libre Belle Époque, nous contant la vie culturelle de Marie, gracieuse, intelligente, qui use de tant de libertés et sera un modèle, un idéal pour Forough, bridée par sa famille et qui ne se réalise pas dans la société iranienne.
Forough se fait conter la vie culturelle de Marie qu’elle admire et envie.
Elle se plaît à imaginer la vie de Marie et de son amant Pierre Louÿs à l'érotisme poétique.
Elle sera la première Iranienne à lire les vers de ce dernier, d’une élégante crudité, qui la révéleront : “Pierre Louÿs la déniaise, la déculpabilise, rajoute des aigus légers sur les graves tentations sexuelles.”
Abnousse Shalmani nous livre un roman subtil, une ode à la liberté sous toutes ses formes et à celles qui l’assument en Orient et en Occident.
A travers celle de Marie, Forough entrevoit la vie dont elle aurait rêvé.
Abnousse Shalmani entrelace deux destins de femmes libres et créatives :
celui de Forough Farrokhzad, dans les années 1950, en Iran, dont la carrière littéraire a été fulgurante (elle meurt à 32 ans dans un accident de voiture) et celui de Marie de Régnier, à Paris, à la Belle Époque.
Elle entrechoque les époques, les pays, les cultures…
Le roman est inspiré de deux vies réelles ; l’auteur nous fait revisiter la très libre Belle Époque, nous contant la vie culturelle de Marie, gracieuse, intelligente, qui use de tant de libertés et sera un modèle, un idéal pour Forough, bridée par sa famille et qui ne se réalise pas dans la société iranienne.
Forough se fait conter la vie culturelle de Marie qu’elle admire et envie.
Elle se plaît à imaginer la vie de Marie et de son amant Pierre Louÿs à l'érotisme poétique.
Elle sera la première Iranienne à lire les vers de ce dernier, d’une élégante crudité, qui la révéleront : “Pierre Louÿs la déniaise, la déculpabilise, rajoute des aigus légers sur les graves tentations sexuelles.”
Abnousse Shalmani nous livre un roman subtil, une ode à la liberté sous toutes ses formes et à celles qui l’assument en Orient et en Occident.
On la voit et on l'entend de plus en plus dans les médias, où elle défend avec charme et virtuosité des convictions libérales et libertaires bien senties. Avant l'installation de sa famille en France, Abnousse Shalmani avait passé une partie de son enfance en République Islamique d'Iran. Elle sait donc ce que sont l'obscurantisme, la dictature et l'oppression des femmes.
Chroniqueuse, réalisatrice, journaliste, elle est aussi écrivain. Après quelques ouvrages inspirés de son expérience personnelle, elle vient de publier un roman historique au contenu littéraire riche, à la forme originale et au titre inattendu : J'ai péché, péché dans le plaisir.
Le livre raconte les vies de deux femmes poètes aujourd'hui oubliées, deux femmes qui décidèrent de donner libre cours à leurs talents, à leurs désirs et à leurs amours.
Dans les beaux quartiers parisiens, à la toute fin du XIXe siècle, Marie, fille du poète José-Maria de Heredia, épouse le poète Henri de Régnier. Elle prend comme amant un autre poète, Pierre Louÿs, un dandy alors renommé pour ses nombreuses conquêtes féminines et pour sa plume élégamment érotique. Marie écrira elle-même des poèmes et des romans, dans lesquels elle ne s'interdira aucune transgression. Ils lui vaudront plusieurs prix de l'Académie française.
Soixante ans après Marie, à Téhéran, Forough Farrokhzad épouse à l'âge de seize ans l'homme qu'elle s'est choisi. Il la méprise parce qu'elle l'aime et parce qu'elle ressent du désir pour lui : impensable pour une femme ! Forough divorce rapidement et écrit ses premiers recueils de poèmes. Ses vers expriment ses fantasmes féminins et des aspirations féministes. Ils font scandale dans son entourage bourgeois, corseté par des inhibitions civiles et religieuses.
Pour relater les parcours de Marie et de Forough, Abnousse Shalmani s'est affranchie des stéréotypes de la narration historique. Elle a construit un roman autour d'un personnage fictif contemporain de Forough, un jeune Iranien francophone, poète et historien de la poésie. Prénommé Cyrus (un hommage en passant au fondateur de l'Empire perse), le jeune homme avait traduit en persan les oeuvres de Marie de Régnier et de Pierre Louÿs. Quand il rencontre Forough, il tombe raide dingue, lui dévoile ce qu'il sait de Marie et de Pierre. La poète iranienne est troublée et séduite. Pendant des années, entre deux étreintes — secrètes et non exclusives —, Forough écoutera Cyrus lui lire les vers et lui raconter la vie libertine de la poète française.
Un conte des mille et une nuits à l'envers. Un homme qui récite, une femme orientale qui découvre la tolérance de la société parisienne à la Belle Epoque. Quel décalage avec l'Iran du Shah, dévot, puritain, conformiste, misogyne, où l'impénitente pécheresse autoproclamée Forough ne trouve ni sa place ni la paix ! Il y eut pourtant une poésie persane classique, laquelle ne se privait pas, il y a des siècles, d'exalter sans fausse pudeur, sans crainte du péché, la beauté des corps et le lyrisme de l'amour. Celle qui en hérite naturellement, c'est la Française. Marie, le péché, connaît pas !
La lecture de J'ai péché, j'ai péché dans le plaisir m'a captivé. Agrémentée d'anecdotes solidement documentées, la biographie de chacune de ces deux femmes procure un éclairage historique et littéraire large et passionnant.
Les deux cents pages du livre sont denses, leur contenu est érudit, mais la lecture est fluide, par moment jubilatoire. La prose est simple, vive, primesautière. L'auteure conjugue habilement les temps et les modes, ce qui imprime du rythme à la narration. Elle n'hésite pas à placer ici ou là un terme cru qui ne choque pas, parce qu'il vient avec pertinence.
Le texte est émaillé de jolies strophes écrites par Forough, par Marie, par Pierre, un brelan de poètes disparus des mémoires, dont je n'avais jamais rien lu. Leurs vers chantent le luxe, le calme et la volupté. Baudelaire n'est jamais loin des grands écrivains.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Chroniqueuse, réalisatrice, journaliste, elle est aussi écrivain. Après quelques ouvrages inspirés de son expérience personnelle, elle vient de publier un roman historique au contenu littéraire riche, à la forme originale et au titre inattendu : J'ai péché, péché dans le plaisir.
Le livre raconte les vies de deux femmes poètes aujourd'hui oubliées, deux femmes qui décidèrent de donner libre cours à leurs talents, à leurs désirs et à leurs amours.
Dans les beaux quartiers parisiens, à la toute fin du XIXe siècle, Marie, fille du poète José-Maria de Heredia, épouse le poète Henri de Régnier. Elle prend comme amant un autre poète, Pierre Louÿs, un dandy alors renommé pour ses nombreuses conquêtes féminines et pour sa plume élégamment érotique. Marie écrira elle-même des poèmes et des romans, dans lesquels elle ne s'interdira aucune transgression. Ils lui vaudront plusieurs prix de l'Académie française.
Soixante ans après Marie, à Téhéran, Forough Farrokhzad épouse à l'âge de seize ans l'homme qu'elle s'est choisi. Il la méprise parce qu'elle l'aime et parce qu'elle ressent du désir pour lui : impensable pour une femme ! Forough divorce rapidement et écrit ses premiers recueils de poèmes. Ses vers expriment ses fantasmes féminins et des aspirations féministes. Ils font scandale dans son entourage bourgeois, corseté par des inhibitions civiles et religieuses.
Pour relater les parcours de Marie et de Forough, Abnousse Shalmani s'est affranchie des stéréotypes de la narration historique. Elle a construit un roman autour d'un personnage fictif contemporain de Forough, un jeune Iranien francophone, poète et historien de la poésie. Prénommé Cyrus (un hommage en passant au fondateur de l'Empire perse), le jeune homme avait traduit en persan les oeuvres de Marie de Régnier et de Pierre Louÿs. Quand il rencontre Forough, il tombe raide dingue, lui dévoile ce qu'il sait de Marie et de Pierre. La poète iranienne est troublée et séduite. Pendant des années, entre deux étreintes — secrètes et non exclusives —, Forough écoutera Cyrus lui lire les vers et lui raconter la vie libertine de la poète française.
Un conte des mille et une nuits à l'envers. Un homme qui récite, une femme orientale qui découvre la tolérance de la société parisienne à la Belle Epoque. Quel décalage avec l'Iran du Shah, dévot, puritain, conformiste, misogyne, où l'impénitente pécheresse autoproclamée Forough ne trouve ni sa place ni la paix ! Il y eut pourtant une poésie persane classique, laquelle ne se privait pas, il y a des siècles, d'exalter sans fausse pudeur, sans crainte du péché, la beauté des corps et le lyrisme de l'amour. Celle qui en hérite naturellement, c'est la Française. Marie, le péché, connaît pas !
La lecture de J'ai péché, j'ai péché dans le plaisir m'a captivé. Agrémentée d'anecdotes solidement documentées, la biographie de chacune de ces deux femmes procure un éclairage historique et littéraire large et passionnant.
Les deux cents pages du livre sont denses, leur contenu est érudit, mais la lecture est fluide, par moment jubilatoire. La prose est simple, vive, primesautière. L'auteure conjugue habilement les temps et les modes, ce qui imprime du rythme à la narration. Elle n'hésite pas à placer ici ou là un terme cru qui ne choque pas, parce qu'il vient avec pertinence.
Le texte est émaillé de jolies strophes écrites par Forough, par Marie, par Pierre, un brelan de poètes disparus des mémoires, dont je n'avais jamais rien lu. Leurs vers chantent le luxe, le calme et la volupté. Baudelaire n'est jamais loin des grands écrivains.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
J'ai eu un grand coup de cœur pour ce livre dans lequel une iranienne nous raconte sa vie, sa liberté, son exil.
D'abord petite fille délurée dans l'Iran de Khomeiny, éduquée par un père intellectuel aux idées larges, elle se moque des "barbus et des corbeaux" en se dénudant dans la cour de récréation et en courant à toute vitesse pour qu'ils (ou plutôt elles, "les corbeaux") ne l'attrapent pas.
Arrivée en France, nous retrouvons une adolescente désappointée quand elle en aperçoit aussi dans les rues de Paris.
Là encore elle se retrouve isolée par son intransigeance mais la lecture la sauvera, ses amis sont les libertin- e-s des siècles passés et modernes.
Elle devient une jeune femme libre et déterminée, qui nous livre de profondes réflexions sur la liberté féminine, la laïcité, l'importance de l'éducation égalitaire,...
On ne sort pas indemne d'une telle lecture.
D'abord petite fille délurée dans l'Iran de Khomeiny, éduquée par un père intellectuel aux idées larges, elle se moque des "barbus et des corbeaux" en se dénudant dans la cour de récréation et en courant à toute vitesse pour qu'ils (ou plutôt elles, "les corbeaux") ne l'attrapent pas.
Arrivée en France, nous retrouvons une adolescente désappointée quand elle en aperçoit aussi dans les rues de Paris.
Là encore elle se retrouve isolée par son intransigeance mais la lecture la sauvera, ses amis sont les libertin- e-s des siècles passés et modernes.
Elle devient une jeune femme libre et déterminée, qui nous livre de profondes réflexions sur la liberté féminine, la laïcité, l'importance de l'éducation égalitaire,...
On ne sort pas indemne d'une telle lecture.
C'est un magnifique hommage à tous ces visages connus et moins connus comme Romain Gary, Martin Eden, le chevalier Saint-Georges, Hérode le Grand, Modigliani, Soutine et Chagall, Rushdie, Esméralda de Hugo... que nous livre Abnousse Shalmani dans cet éloge du métèque qui vient de paraître aux éditions Grasset.
Qu'on-t-elles de commun toutes ces personnes ? Elles sont nées quelque par et vivent ailleurs, ne sont pas enracinées, elles sont métèques.
Abnousse Shalmani se dit elle même-métèque. Elle est arrivée à Paris avec ses parents, en provenance d'Iran. Elle avait 8 ans. Elle n'y est jamais retournée.
Métèque, une identité ? Non ce n'est pas cela pour Abnousse Shalmani, le métèque est davantage une figure à son sens.
Et faire l’éloge du métèque, pour elle, je la cite "c’est dire mon amour des sans-frontières, des sans-pays, des sans-terre. Mais c’est aussi raconter la souffrance et la solitude, les destins brisés et les cris perdus, c’est dire la xénophobie, c’est faire la nique aux préjugés, c’est accepter de ne jamais s’attacher à une terre.
Métèque, ce mot qui me définit et qui raconte une très longue histoire de passions, de départs sans retour, de splendeur, de suspicions, d’impossible et de liberté."
A travers cette réflexion, elle souligne aussi comment le métèque s'est transformé au fil des années, en immigré (Noir, Arabe) après la seconde guerre mondiale, puis aujourd'hui il est le migrant : " Le migrant n'est qu'un métèque déguisé, il reprend son rôle de bouc émissaire, c'est lui le coupable."
Ce mot quelque peu démodé actuellement, l'auteure le réhabilite avec justesse dans cet essai, lui redonne vie et sens.
Les métèques ont tous en commun le rapport à l'amour, le rapport à la mort, le sens de l'esthétisme, c'est un tempérament, une ambition, une sensualité et une transgression : " Le métèque est inévitablement transgressif. Et c'est la principale raison pour laquelle il est si mal aimé. "
Un texte fort, lumineux pour tous les sans-pays !
Il faut le lire !!
"Avec mes mains de maraudeur,
De musicien et de rôdeur,
Qui ont pillé tant de jardins,
Avec ma bouche qui a bu,
Qui a embrassé et mordu
Sans jamais assouvir sa faim
Avec ma gueule de métèque,
De juif errant, de pâtre grec,
De voleur et de vagabond "
GEORGES MOUSTAKI, Le Métèque
Qu'on-t-elles de commun toutes ces personnes ? Elles sont nées quelque par et vivent ailleurs, ne sont pas enracinées, elles sont métèques.
Abnousse Shalmani se dit elle même-métèque. Elle est arrivée à Paris avec ses parents, en provenance d'Iran. Elle avait 8 ans. Elle n'y est jamais retournée.
Métèque, une identité ? Non ce n'est pas cela pour Abnousse Shalmani, le métèque est davantage une figure à son sens.
Et faire l’éloge du métèque, pour elle, je la cite "c’est dire mon amour des sans-frontières, des sans-pays, des sans-terre. Mais c’est aussi raconter la souffrance et la solitude, les destins brisés et les cris perdus, c’est dire la xénophobie, c’est faire la nique aux préjugés, c’est accepter de ne jamais s’attacher à une terre.
Métèque, ce mot qui me définit et qui raconte une très longue histoire de passions, de départs sans retour, de splendeur, de suspicions, d’impossible et de liberté."
A travers cette réflexion, elle souligne aussi comment le métèque s'est transformé au fil des années, en immigré (Noir, Arabe) après la seconde guerre mondiale, puis aujourd'hui il est le migrant : " Le migrant n'est qu'un métèque déguisé, il reprend son rôle de bouc émissaire, c'est lui le coupable."
Ce mot quelque peu démodé actuellement, l'auteure le réhabilite avec justesse dans cet essai, lui redonne vie et sens.
Les métèques ont tous en commun le rapport à l'amour, le rapport à la mort, le sens de l'esthétisme, c'est un tempérament, une ambition, une sensualité et une transgression : " Le métèque est inévitablement transgressif. Et c'est la principale raison pour laquelle il est si mal aimé. "
Un texte fort, lumineux pour tous les sans-pays !
Il faut le lire !!
"Avec mes mains de maraudeur,
De musicien et de rôdeur,
Qui ont pillé tant de jardins,
Avec ma bouche qui a bu,
Qui a embrassé et mordu
Sans jamais assouvir sa faim
Avec ma gueule de métèque,
De juif errant, de pâtre grec,
De voleur et de vagabond "
GEORGES MOUSTAKI, Le Métèque
L'Éloge du métèque d'Abnousse Shalmani est un essai intéressant et parfois très personnel. Après une définition du métèque – pour simplifier, c'est quelqu'un qui ne vit pas là où il est né – et un bref historique du terme, l'autrice va décliner différents aspects du métèque et de ce qu'elle appelle la métèquerie. Au fil des chapitres, elle nous présentera le métèque comme un tempérament, une ambition, une esthétique, une transgression, une sensualité, un malentendu et, pour finir sans clore, une fiction. Abnousse Shalmani se considère elle-même comme une métèque. Déracinée très tôt de son Iran natal, elle est venue s'installer en France avec sa famille. Elle met fréquemment en avant ce tiraillement entre deux pays, deux cultures, déchirement propre aux émigrés et encore plus prégnant, me semble-t-il, quand l'exil a été contraint plutôt que volontaire. Son étude du métèque en général se double donc d'une réflexion très personnelle sur sa propre identité et ses appartenances. Pour illustrer son propos, elle convoque aussi bien des personnages de fiction que des personnages réels. Parmi les premiers, je me bornerai à citer Martin Eden, métèque dans son propre pays à cause des différences de classe sociales, ou Hercule Poirot et son adversaire Shaïtana. Dans les personnages réels, on trouve beaucoup d'écrivains et d'artistes divers. L'autrice nous fait partager son admiration pour Romain Gary et pour Salman Rushdie, mais nous verrons défiler des métèques aussi différents qu'Hérode, Modigliani, Soutine, Chagall, Jeanne Duval, etc. Si elle disqualifie le chevalier d'Éon du titre de métèque, elle l'accorde bien volontiers à un personnage assez extraordinaire, Joseph Boulogne de Saint-Georges (p. 57 à 67) qui se battit d'ailleurs en duel contre d'Éon. Signalons que ce personnage s'est mérité une liste sur Babelio. J'ai apprécié cet essai, mais j'avoue avoir été dérangée par quantité de partis pris présentés comme des vérités. Par exemple, la diatribe sur la gauche (p. 22-23) qui, selon l'autrice, considère réfugiés et immigrés comme des mascottes s'ils fuient les dictatures de droite, mais les rejette s'ils ne peuvent pas lui servir politiquement. J'avoue aussi avoir été surprise par un regard qui me semble bien naïf sur l'intégration des métèques aux États-Unis (p. 142-145). Il n'en reste pas moins que ce livre m'a plu dans l'ensemble et que, en plus, il m'a donné une furieuse envie de me replonger dans ce passionnant ouvrage qu'est le Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France de Pascal Ory et Marie-Claude Blanc-Chaléard !
Déjà 6 avis au moment où j'écris. Ce livre fait partie des 5 pré -sélectionnés pour le Prix RTL/Lire, sinon je ne l'aurais sans doute pas remarqué malgré son bandeau aguicheur ou provocateur. J'ai lu un peu de Sade sans enthousiasme, je n'ai pas aimé les livres que j'ai lu de Pierre Louÿs .
En fait, je n'aime pas trop les livres érotiques ou libertins.
Du coup, je n'ai pas éprouvé d'empathie pour les deux héroïnes: deux poétesses de renom dont l'une 50 ans plus tard enviera la vie libre de Marie.
Forough vit en Iran avec toutes les contraintes que subissent les femmes; elle est déjà poète quand celui qu'elle appelle la Tortue lui traduit les écrits de Louÿs; il lui raconte ensuite l'amour de Marie pour lui. Ils mènent une vie sexuelle libérée et cela fait rêver l'iranienne qui va vivre dans les traces de Marie jusqu'à Paris mais reviendra à Téhéran.
Ma grand-mère aurait dit de Marie qu'elle avait le feu au c.
Mon avis est assez mitigé.
En fait, je n'aime pas trop les livres érotiques ou libertins.
Du coup, je n'ai pas éprouvé d'empathie pour les deux héroïnes: deux poétesses de renom dont l'une 50 ans plus tard enviera la vie libre de Marie.
Forough vit en Iran avec toutes les contraintes que subissent les femmes; elle est déjà poète quand celui qu'elle appelle la Tortue lui traduit les écrits de Louÿs; il lui raconte ensuite l'amour de Marie pour lui. Ils mènent une vie sexuelle libérée et cela fait rêver l'iranienne qui va vivre dans les traces de Marie jusqu'à Paris mais reviendra à Téhéran.
Ma grand-mère aurait dit de Marie qu'elle avait le feu au c.
Mon avis est assez mitigé.
La narratrice, Shirin, partage les différentes étapes de son exil en France, à Paris, rue de la Roquette, au sein d’une famille complètement, comment dire, foutraque. En entrant dans ce récit, j’ai aimé le ton décalé, teinté d’humour sur une situation qui pourtant n’a rien d’amusant mais quand les mots sont écrits par une enfant de 9 ans cela prend une toute autre teinte. Elle interprète à sa manière, tente de comprendre.
Et c’était exactement à çà que servaient les mots, tous les mots : à colorer autrement les humains en leur donnant une forme nouvelle. La langue française se métamorphosait en baquette magique pour combattre le réel et sauver ce qui restait de l’enchantement de l’enfance. (p36)
Elle reproduit ce qu’elle entend, dans son poste d’observation favori, sous le canapé et elle note tout, essaie d’assimiler cette nouvelle langue qu’elle n’apprivoise pas, comprendre le monde des adultes et leurs réactions, entend parfois ce qu’elle ne devrait pas entendre.
La première partie, l’An I de l’Exil, c’est cela, à l’image des expressions comme « police-des-mœurs-mes fesses » qui sont représentatives de l’ambiance qui règne dans cet appartement, des relations révolutionnaires, même loin du pays natal, dangereuses car engagées. Dans cet immeuble où vit toute la famille, la vie de tous les jours se tissent avec vie politique.
La politique, c’était du fantasme, des idées qui volent alors que l’intime était ancré dans la réalité, fait de désir, de frustration, de silence et ils ne le supportaient pas, alors ils disaient n’importe quoi pour ne pas sentir la morsure de la vie. (p92)
Le pouvoir des femmes iraniennes est immense et en particulier celui de sa tante maternelle Mitra, qui régente toute la famille, mais aussi Zizi opiomane, Tala, la belle, celle qui sera le modèle absolu de la petite fille, sa mère Niloo, arrivée enceinte à Paris et qui donnera naissance au petit frère, Siyavash, silencieux et empoisonneur. Une mère dans toute sa définition, se préoccupant toujours du bien-être de chacun et chacune, qui ne fait jamais de vagues…… quoique….. Et puis Hannah, la voisine, si accueillante mais rebelle car n’acceptant pas, plus les abus et brutalités humaines.
Et il y a un père silencieux, libraire, résigné, cacherait-il un mystère, un secret…..
Et puis des hommes feront leur entrée : Amid, terroriste, Mahmoud, le grand–père pervers et brutal et surtout Omid, celui dont s’éprendra immédiatement Shirin, qui va l’initier à la culture, à la richesse des musées et dont elle sait qu’un jour il sera son Destin.
On a du mal à croire, qu’au sein d’une même famille, toutes ces figures soient réunies, c’est un peu trop.
Le roman comporte trois parties : l’an I – L’IX et l’an XXX de l’Exil (épilogue) trois étapes de l’exil : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte, l’arrivée et la découverte d’un nouveau pays, l’intégration et l’épanouissement pour une histoire qui est, je pense, en grande partie autobiographique car beaucoup de références à son précédent livre, autobiographique déjà, sont intégrées.
Abrousse Shaïmani mêle des petits contes, réels ou imaginés, qui nous transportent dans les légendes de son pays d’origine, ses croyances, ses parfums et révèlent parfois les choix faits concernant les prénoms, les passés de ses personnages.
On ressent la difficulté d’intégration sans renier ses racines, en vivant presque en vase clos, mais pour la deuxième génération l’importance du juste équilibre entre les deux pays, sa richesse.
L’auteure a une écriture très belle mais j’ai eu à plusieurs moments de la lassitude à suivre le récit, il y a tellement de choses, de petits faits qu’au bout d’un moment je me suis perdue, j’ai eu la tentation d’arrêter mais bien m’a pris de ne pas le faire car la dernière partie est particulièrement émouvante et forte.
Donc au final un récit un peu à la manière d’un bazar, on y trouve un peu de tout : le regard d’une enfant sur l’exil, sur ses racines, qui cherche à comprendre qui ils sont, même loin de leur pays, un monde d’adultes aux idées et attitudes extrêmes, des contes, une intrigue policière sur une disparition, des empoisonnements mystérieux et l’amour qui tente de prendre sa place au milieu de tout cela…
Je ne sais pas si le final est imaginé ou réel pour l’auteure mais j’ai trouvé cela un peu trop…..
J’aurai préféré un peu moins d’événements rocambolesques qui retirent de la crédibilité au récit.
Lien : http://mumudanslebocage.word..
Et c’était exactement à çà que servaient les mots, tous les mots : à colorer autrement les humains en leur donnant une forme nouvelle. La langue française se métamorphosait en baquette magique pour combattre le réel et sauver ce qui restait de l’enchantement de l’enfance. (p36)
Elle reproduit ce qu’elle entend, dans son poste d’observation favori, sous le canapé et elle note tout, essaie d’assimiler cette nouvelle langue qu’elle n’apprivoise pas, comprendre le monde des adultes et leurs réactions, entend parfois ce qu’elle ne devrait pas entendre.
La première partie, l’An I de l’Exil, c’est cela, à l’image des expressions comme « police-des-mœurs-mes fesses » qui sont représentatives de l’ambiance qui règne dans cet appartement, des relations révolutionnaires, même loin du pays natal, dangereuses car engagées. Dans cet immeuble où vit toute la famille, la vie de tous les jours se tissent avec vie politique.
La politique, c’était du fantasme, des idées qui volent alors que l’intime était ancré dans la réalité, fait de désir, de frustration, de silence et ils ne le supportaient pas, alors ils disaient n’importe quoi pour ne pas sentir la morsure de la vie. (p92)
Le pouvoir des femmes iraniennes est immense et en particulier celui de sa tante maternelle Mitra, qui régente toute la famille, mais aussi Zizi opiomane, Tala, la belle, celle qui sera le modèle absolu de la petite fille, sa mère Niloo, arrivée enceinte à Paris et qui donnera naissance au petit frère, Siyavash, silencieux et empoisonneur. Une mère dans toute sa définition, se préoccupant toujours du bien-être de chacun et chacune, qui ne fait jamais de vagues…… quoique….. Et puis Hannah, la voisine, si accueillante mais rebelle car n’acceptant pas, plus les abus et brutalités humaines.
Et il y a un père silencieux, libraire, résigné, cacherait-il un mystère, un secret…..
Et puis des hommes feront leur entrée : Amid, terroriste, Mahmoud, le grand–père pervers et brutal et surtout Omid, celui dont s’éprendra immédiatement Shirin, qui va l’initier à la culture, à la richesse des musées et dont elle sait qu’un jour il sera son Destin.
On a du mal à croire, qu’au sein d’une même famille, toutes ces figures soient réunies, c’est un peu trop.
Le roman comporte trois parties : l’an I – L’IX et l’an XXX de l’Exil (épilogue) trois étapes de l’exil : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte, l’arrivée et la découverte d’un nouveau pays, l’intégration et l’épanouissement pour une histoire qui est, je pense, en grande partie autobiographique car beaucoup de références à son précédent livre, autobiographique déjà, sont intégrées.
Abrousse Shaïmani mêle des petits contes, réels ou imaginés, qui nous transportent dans les légendes de son pays d’origine, ses croyances, ses parfums et révèlent parfois les choix faits concernant les prénoms, les passés de ses personnages.
On ressent la difficulté d’intégration sans renier ses racines, en vivant presque en vase clos, mais pour la deuxième génération l’importance du juste équilibre entre les deux pays, sa richesse.
L’auteure a une écriture très belle mais j’ai eu à plusieurs moments de la lassitude à suivre le récit, il y a tellement de choses, de petits faits qu’au bout d’un moment je me suis perdue, j’ai eu la tentation d’arrêter mais bien m’a pris de ne pas le faire car la dernière partie est particulièrement émouvante et forte.
Donc au final un récit un peu à la manière d’un bazar, on y trouve un peu de tout : le regard d’une enfant sur l’exil, sur ses racines, qui cherche à comprendre qui ils sont, même loin de leur pays, un monde d’adultes aux idées et attitudes extrêmes, des contes, une intrigue policière sur une disparition, des empoisonnements mystérieux et l’amour qui tente de prendre sa place au milieu de tout cela…
Je ne sais pas si le final est imaginé ou réel pour l’auteure mais j’ai trouvé cela un peu trop…..
J’aurai préféré un peu moins d’événements rocambolesques qui retirent de la crédibilité au récit.
Lien : http://mumudanslebocage.word..
Fantasque ce premier roman, entre deux terres, l'Iran et la France. C'est un roman de l'exil, avec une approche bien singulière !
" Les exilés meurent aussi d'amour" de Abnousse SHALMANI est paru aux éditions Grasset en cette rentrée littéraire 2018.
p. 10 : "C'est quelque chose, l'exil : une claque qui vous déstabilise à jamais."
Shirin quitte Téhéran avec sa famille au lendemain de la Révolution islamique en Iran.
p. 6 : " Ils quittent leur pays de naissance, le pays où ils ont vécu jusqu'alors, ils partent en abandonnant presque tout, et en n'espérant presque rien. Ils sont des exilés comme les autres, tourmentés par les mêmes questions, étouffés par les mêmes doutes, assommés par l'Histoire."
Leur destination : Paris.
p. 215 : " S'il fallait définir Paris, je dirais : cette atmosphère sensuelle, cette séduction permanente, cette oppression charnelle. "
Elle a alors 9 ans. Ils rejoignent donc la famille maternelle de Shirin, et les redoutables sœurs communistes et dominatrices de sa mère.
p. 173 : " [...] pouvais-je échapper au destin familial ? "
Son père, professeur, est plutôt discret. En revanche, elle entretient une relation complexe avec sa mère. Recherchant sans cesse à être aimée, sans personnalité, elle ploie sous la tyrannie de ses sœurs.
p. 221 : " [...] ma mère n'était que le produit d'une culture qui brise les femmes, davantage que les hommes, en les enchaînant à tant d'interdits, tant de malédictions, tant de réputations, tant de regards qui empêchent, aliènent, qu'elles se prennent à croire au malheur de leur sexe alors qu'elles ne craignent que l'isolement, l'opprobre, et qu'elles ne s'autorisent qu'une seule route, celle du sacrifice. "
Pour échapper à la violence psychologique de la famille Hedayat, Shirin fait une fugue. C'est l'amant de sa tante Tala qui va la raccompagner chez elle. Omid , un homme érudit, va transmettre à Shirin sa passion pour la culture. Shirin découvre soudain l'amour.
p. 34 : " Le jour où Omid est entré dans ma vie, je n'ai pas compris ce qui m'attirait chez lui et éloignait mes tantes, mon oncle et grand-père Mahmoud. Cela ne tenait pas au seul fait qu'il fût juif mais parce qu'il disait ses sentiments, les montrant au grand jour, les étalait sans crainte, les assumait à haute voix. Or, personne,jamais, ne s'était ainsi comporté autour de moi. "
C'est l'histoire de l'émancipation d'une jeune fille, au sens large du terme. Simultanément, elle progresse dans son apprentissage de la langue française, et partage son désir de devenir écrivain.
p. 36 : " La langue française se métamorphosait en baguette magique pour combattre le réel et sauver ce qui restait de l'enchantement de l'enfance. "
Abnousse Shalmani aborde dans ce roman tragico-comique, l'exil. Loin de tomber dans le pathos, l'auteure a fait le choix de sortir du drame des migrants pour aller vers une tragédie-comédie des exilés, emplie d'humour et de magie. Elle nous prouve par ce premier roman que la littérature peut offrir des armes de résistance contre toutes les oppressions.
Lien : https://missbook85.wordpress..
" Les exilés meurent aussi d'amour" de Abnousse SHALMANI est paru aux éditions Grasset en cette rentrée littéraire 2018.
p. 10 : "C'est quelque chose, l'exil : une claque qui vous déstabilise à jamais."
Shirin quitte Téhéran avec sa famille au lendemain de la Révolution islamique en Iran.
p. 6 : " Ils quittent leur pays de naissance, le pays où ils ont vécu jusqu'alors, ils partent en abandonnant presque tout, et en n'espérant presque rien. Ils sont des exilés comme les autres, tourmentés par les mêmes questions, étouffés par les mêmes doutes, assommés par l'Histoire."
Leur destination : Paris.
p. 215 : " S'il fallait définir Paris, je dirais : cette atmosphère sensuelle, cette séduction permanente, cette oppression charnelle. "
Elle a alors 9 ans. Ils rejoignent donc la famille maternelle de Shirin, et les redoutables sœurs communistes et dominatrices de sa mère.
p. 173 : " [...] pouvais-je échapper au destin familial ? "
Son père, professeur, est plutôt discret. En revanche, elle entretient une relation complexe avec sa mère. Recherchant sans cesse à être aimée, sans personnalité, elle ploie sous la tyrannie de ses sœurs.
p. 221 : " [...] ma mère n'était que le produit d'une culture qui brise les femmes, davantage que les hommes, en les enchaînant à tant d'interdits, tant de malédictions, tant de réputations, tant de regards qui empêchent, aliènent, qu'elles se prennent à croire au malheur de leur sexe alors qu'elles ne craignent que l'isolement, l'opprobre, et qu'elles ne s'autorisent qu'une seule route, celle du sacrifice. "
Pour échapper à la violence psychologique de la famille Hedayat, Shirin fait une fugue. C'est l'amant de sa tante Tala qui va la raccompagner chez elle. Omid , un homme érudit, va transmettre à Shirin sa passion pour la culture. Shirin découvre soudain l'amour.
p. 34 : " Le jour où Omid est entré dans ma vie, je n'ai pas compris ce qui m'attirait chez lui et éloignait mes tantes, mon oncle et grand-père Mahmoud. Cela ne tenait pas au seul fait qu'il fût juif mais parce qu'il disait ses sentiments, les montrant au grand jour, les étalait sans crainte, les assumait à haute voix. Or, personne,jamais, ne s'était ainsi comporté autour de moi. "
C'est l'histoire de l'émancipation d'une jeune fille, au sens large du terme. Simultanément, elle progresse dans son apprentissage de la langue française, et partage son désir de devenir écrivain.
p. 36 : " La langue française se métamorphosait en baguette magique pour combattre le réel et sauver ce qui restait de l'enchantement de l'enfance. "
Abnousse Shalmani aborde dans ce roman tragico-comique, l'exil. Loin de tomber dans le pathos, l'auteure a fait le choix de sortir du drame des migrants pour aller vers une tragédie-comédie des exilés, emplie d'humour et de magie. Elle nous prouve par ce premier roman que la littérature peut offrir des armes de résistance contre toutes les oppressions.
Lien : https://missbook85.wordpress..
Abnousse Shalmani entrecroise deux portraits de femme poétesse et autrice, celui de Marie de Régnier (1875-1963) et celui de Forough Farrokhzad (1934-1967). Forough est iranienne et n’aura de cesse, tout au long de sa vie, de vouloir vivre telle une femme libre, émancipée, sans attache autre que celle de suivre ses sentiments, ses désirs. Mariée très jeune, à seize ans, et devenue mère d’un enfant, elle divorcera pour « mauvaise conduite », telles étaient les accusations portées par son mari et sa propre famille. Seul son frère, lui-même convaincu par la justesse des idées défendues par sa sœur, ne lui tournera pas le dos. Un frère qui sera assassiné au début des années 1990 par l’Iran des Mollahs alors qu’il est en exil. La république islamique n’est pas encore advenu lorsque Forough déploie ses ailes pour écrire de la poésie, mais déjà le poids des traditions visant à mettre sous cloche les désirs des femmes, à ne jamais parler de plaisir, de désir, de sexe, de jouissance, est bien présent. Forough va être célébré dans le milieu littéraire iranien comme une poétesse au talent immense. Une femme à contre courant de la société patriarcale et oppressive pour les femmes iraniennes. Elle se rêve vivant librement telle Marie de Heredia qui, à la belle époque en France, fréquente le gratin des auteur(e)s et vit selon l’unique précepte de jouir, un leitmotiv, une doctrine, une profession de foi, son seul et unique dieu, le seul qui l’anime et la guide. Marie et Forough, deux destins, deux envies, deux époques, deux mêmes célébrations de l’amour, de la jouissance, du sexe libéré de tout préjugé patriarcal. Deux femmes qui refuseront de se laisser enfermer dans le seul rôle de mère, elles voudront voler de leurs propres ailes, s’échapper de la prison, du modèle de femme que l’on souhaitera pour elles et qui ne leur convenaient pas. Alors oui, « J’ai péché, péché dans le plaisir » est un roman fascinant dans le tableau qu’il nous dresse de ces deux femmes exceptionnelles, poétesses, voulant jouir de leurs corps autant que de leurs mots. Des vies qui seront le terreau fertile d’une œuvre poétique. On comprend parfaitement l’allégorie qui est faite pour le combat qui se poursuit, plus que jamais aujourd’hui, contre l’obscurantisme islamiste en Iran et ailleurs. Le titre du roman le symbolise clairement, « péché » un terme religieux teinté de négativité mis en perspective avec l’idée de plaisir, de jouissance, qui effraie tant d’hommes souhaitant ne pas voir les femmes libre de leurs corps. Abnousse Shalmani signe un roman puissamment évocateur, un message fort pour les femmes et leurs droits, leurs libertés contestées dans le monde. Marie et Forough sont deux symboles forts de femmes ayant assumée leurs désirs. C’est un roman à découvrir.
Lien : https://thedude524.com/2024/..
Lien : https://thedude524.com/2024/..
Essai extraordinairement intelligent sur la condition d'exilée et les raisons de l'exil.
Il permet de confronter les visions occidentales et orientales sur l'oppression des femmes, notamment de démystifier la signification du voile imposé en Iran et toléré en l'Occident par le biais d'un discours de revendication d'une pseudo-liberté des femmes de se vêtir comme elles le veulent.
Cette capitulation d'une partie de la gauche assure ainsi aux "barbus" la visibilité de la progression en nombre d'une population susceptible de subir sans protester la confiscation des libertés individuelles.
A travers la littérature libertine du 18 ème siècle français et l'histoire de l'Iran, Abnousse Shalmani met en évidence la corrélation systématique des confiscations des libertés avec la détérioration des conditions féminine et masculine, inextricablement liées.
Il se dégage de ce livre foisonnant, riche et servi par la rigueur de son argumentation, un enthousiasme et une joie de vivre extraordinaires.
Il permet de confronter les visions occidentales et orientales sur l'oppression des femmes, notamment de démystifier la signification du voile imposé en Iran et toléré en l'Occident par le biais d'un discours de revendication d'une pseudo-liberté des femmes de se vêtir comme elles le veulent.
Cette capitulation d'une partie de la gauche assure ainsi aux "barbus" la visibilité de la progression en nombre d'une population susceptible de subir sans protester la confiscation des libertés individuelles.
A travers la littérature libertine du 18 ème siècle français et l'histoire de l'Iran, Abnousse Shalmani met en évidence la corrélation systématique des confiscations des libertés avec la détérioration des conditions féminine et masculine, inextricablement liées.
Il se dégage de ce livre foisonnant, riche et servi par la rigueur de son argumentation, un enthousiasme et une joie de vivre extraordinaires.
Les exilés meurent aussi d'amour de Abnousse Shalmani m'a été envoyé par les éditions Grasset et net galley, que je remercie :)
Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris avec ses parents, au lendemain de la révolution islamique en Iran, pour y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu de réfugiés communistes, le quotidien n’a plus grand-chose à voir avec les fastes de Téhéran.
Shirin découvre que les idéaux mentent et tuent ; elle tombe amoureuse d’un homme cynique ; s’inquiète de l’arrivée d’un petit frère œdipien et empoisonneur ; admire sa mère magicienne autant qu’elle la méprise de se laisser humilier par ses redoutables sœurs ; tente de comprendre l’effacement de son père… et se lie d’amitié avec une survivante de la Shoah pour qui seul le rire sauve de la folie des hommes.
J'ai beaucoup aimé ce roman de la rentrée littéraire 2018.
Le fait que la narratrice soit au départ une petite fille m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très touchant. Il y a trois parties, nous la suivons à l'enfance, l'adolescence puis adulte. Shirin est un personnage attachant, que j'ai pris plaisir à suivre. J'ai apprécié ceux qui s'entourent, je trouve qu'on a dans ce roman des personnages forts, touchants, à lesquels on s'attache sans peine.
Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et ce roman fût une très bonne surprise.
Ma note : cinq étoiles.
Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris avec ses parents, au lendemain de la révolution islamique en Iran, pour y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu de réfugiés communistes, le quotidien n’a plus grand-chose à voir avec les fastes de Téhéran.
Shirin découvre que les idéaux mentent et tuent ; elle tombe amoureuse d’un homme cynique ; s’inquiète de l’arrivée d’un petit frère œdipien et empoisonneur ; admire sa mère magicienne autant qu’elle la méprise de se laisser humilier par ses redoutables sœurs ; tente de comprendre l’effacement de son père… et se lie d’amitié avec une survivante de la Shoah pour qui seul le rire sauve de la folie des hommes.
J'ai beaucoup aimé ce roman de la rentrée littéraire 2018.
Le fait que la narratrice soit au départ une petite fille m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très touchant. Il y a trois parties, nous la suivons à l'enfance, l'adolescence puis adulte. Shirin est un personnage attachant, que j'ai pris plaisir à suivre. J'ai apprécié ceux qui s'entourent, je trouve qu'on a dans ce roman des personnages forts, touchants, à lesquels on s'attache sans peine.
Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et ce roman fût une très bonne surprise.
Ma note : cinq étoiles.
Lors d’une de nos premières rencontres, Delphine m’avait longuement parlé d’Abnousse Shalmani, et de son premier livre au titre hautement improbable, associant à la fois un dictateur intégriste et le grand maître du libertinage français, à l’origine de la notion de « sadisme ». Ce titre m’est resté en tête, et c’est avec beaucoup d’attentes que j’ai fini par ouvrir ce livre, plusieurs années après, en pleine tourmente personnelle et professionnelle – et ça a été une magnifique claque, bien loin de tout ce que j’avais pu m’imaginer.
Mêlant anecdotes personnelles, analyses diablement intelligentes, faits d’actualité, références littéraires diverses et humour décalé, Abnousse Shalmani nous parle des femmes, de leur droit à appartenir à l’espace public, et de la nécessaire séparation de la religion du politique pour éviter des dérives sociales inadmissibles comme celles qui ont été mises en place en Iran depuis l’avènement de l’ayatollah, ou encore en Afghanistan sous les talibans. J’ai été absolument soufflée par sa réflexion très poussée sur la place de la femme dans les sociétés occidentales et orientales, nourrie par une étude approfondie des femmes présentes dans l’Islam, depuis la première femme musulmane, Hagar, mère d’Ismaël, déconsidérée par la tradition islamiste malgré son rôle-clé. J’ai appris énormément sur cette religion, son histoire et ses traditions, sur les raccourcis que font ceux qui n’y connaissent rien, sur les dérives généralisées et les amalgames qui ont vu le jour après le 11 septembre et les révolutions arabes. J’ai découvert le soufisme à travers la figure admirable du grand-père de l’auteure, exemple de tolérance et d’acceptation, vivant sa religion dans la plus grande humilité sans en faire peser le poids sur les autres.
L’érudition d’Abnousse Shalmani m’a bluffée, son regard critique m’a questionnée jusqu’au plus profond de mon âme, et son amour pour la France m’a fait prendre énormément de recul sur mon propre désamour pour ce pays qui est le mien. J’ai trouvé fascinant comment la littérature libertine lui a permis de réintégrer le corps dans les choses de l’esprit, de le dédramatiser et de dépasser les interdits et constructions sociales auquel il est soumis, encore aujourd’hui dans nos sociétés actuelles. Khomeiny, Sade et moi bouille de réflexions politiques, sociales et culturelles immensément riches, que l’expérience personnelle de l’auteure aide à comprendre et à illustrer, le tout dans une prose à la fois accessible et exigeante. Un des meilleurs livres que j’ai lu récemment !
Lien : https://theunamedbookshelf.c..
Mêlant anecdotes personnelles, analyses diablement intelligentes, faits d’actualité, références littéraires diverses et humour décalé, Abnousse Shalmani nous parle des femmes, de leur droit à appartenir à l’espace public, et de la nécessaire séparation de la religion du politique pour éviter des dérives sociales inadmissibles comme celles qui ont été mises en place en Iran depuis l’avènement de l’ayatollah, ou encore en Afghanistan sous les talibans. J’ai été absolument soufflée par sa réflexion très poussée sur la place de la femme dans les sociétés occidentales et orientales, nourrie par une étude approfondie des femmes présentes dans l’Islam, depuis la première femme musulmane, Hagar, mère d’Ismaël, déconsidérée par la tradition islamiste malgré son rôle-clé. J’ai appris énormément sur cette religion, son histoire et ses traditions, sur les raccourcis que font ceux qui n’y connaissent rien, sur les dérives généralisées et les amalgames qui ont vu le jour après le 11 septembre et les révolutions arabes. J’ai découvert le soufisme à travers la figure admirable du grand-père de l’auteure, exemple de tolérance et d’acceptation, vivant sa religion dans la plus grande humilité sans en faire peser le poids sur les autres.
L’érudition d’Abnousse Shalmani m’a bluffée, son regard critique m’a questionnée jusqu’au plus profond de mon âme, et son amour pour la France m’a fait prendre énormément de recul sur mon propre désamour pour ce pays qui est le mien. J’ai trouvé fascinant comment la littérature libertine lui a permis de réintégrer le corps dans les choses de l’esprit, de le dédramatiser et de dépasser les interdits et constructions sociales auquel il est soumis, encore aujourd’hui dans nos sociétés actuelles. Khomeiny, Sade et moi bouille de réflexions politiques, sociales et culturelles immensément riches, que l’expérience personnelle de l’auteure aide à comprendre et à illustrer, le tout dans une prose à la fois accessible et exigeante. Un des meilleurs livres que j’ai lu récemment !
Lien : https://theunamedbookshelf.c..
Abnousse Shalmani, c’est une voix singulière et forte, une personnalité entière, viscéralement éprise de liberté, qui n’hésite jamais à dire ce qu’elle pense. C’est surtout une femme écrivain de grand talent.
Dans Khomeiny, Sade et moi, son éblouissant premier livre, elle témoignait de son arrivée en France, à l’âge de huit ans avec ses parents, de la manière dont elle s’était emparée de la langue française, dont elle avait embrassé cette nouvelle culture et, surtout, dont les écrivains, Sade en tête, lui avaient permis de s’affirmer et de se construire. C’était puissant, c’était mordant, c’était l’histoire d’une femme qui était résolument partie à la conquête d’une liberté que les mollahs avaient voulu lui dénier.
Aujourd’hui, c’est sous la forme du roman qu’elle a choisi d’aborder la question de l’exil. Si certains traits de son héroïne sont sans doute empruntés à la petite fille qu'elle a été - elles ont le même âge lorsque leur famille fuit l’Iran après la révolution islamique - le texte appartient à un registre clairement fictionnel.
A leur arrivée à Paris, Shirin et ses parents retrouvent une partie de la famille maternelle qui s'y est déjà installée. Ils emménagent chez Mitra, sœur aînée de la mère de Shirin, et rejoignent ainsi les rangs d’une communauté de réfugiés, dont certains n’ont pas renoncé à leur activisme politique.
Abnousse Shalmani dépeint des personnages hauts en couleur, dont chacun est comme la touche d’une composition plus vaste donnant à voir toutes les nuances d’un peuple, de la plus lumineuse à la plus sombre. Fidèle à la personnalité qu’on lui connaît, Abnousse Shalmani ne cède en effet ni à la complaisance, ni à un excès de sentimentalisme pour évoquer cette communauté et restituer la manière dont peut grandir une petite fille entre un environnement familial tourné vers un pays et un passé plus ou moins idéalisés, et un environnement social lui offrant une autre langue et une autre culture.
Mais la fillette ne se pose jamais en victime, et c’est là toute la force de ce texte. Si l’auteure insiste sur la manière dont la personnalité d’un exilé est façonnée par des fragments auquel il essaye de donner une cohérence, elle en fait une richesse plutôt qu’une fragilité. C’est avec désir et appétit que Shirin s’extirpe d’un cercle familial très refermé sur lui-même pour partir à la découverte et à la conquête du monde extérieur, si différent du sien.
Elle ne rompt pourtant jamais avec ses origines et navigue d’un univers à l’autre pour tenter de s’approprier le meilleur de chacun des deux mondes auxquels elle appartient désormais.
Comme dans Khomeiny, Sade et moi, Abnousse Shalmani fait preuve d’une énergie débordante et conserve sa réjouissante liberté de ton. Mais en choisissant de quitter le terrain autobiographique pour investir celui du roman, elle donne à ce dernier un charme particulier. Habitée par deux cultures, elle est parvenue à donner à son récit une forme métissée, synthèse de notre cartésianisme bien français et de la magie des contes orientaux.
Lien : https://delphine-olympe.blog..
Shirin, neuf ans, débarque à Paris avec ses parents après avoir fui la révolution islamique d'Iran. Arrivée dans la capitale, elle s'installe avec sa famille dans l'appartement d'une tante qui héberge déjà beaucoup de monde dont son grand-père ainsi que deux autres tantes. Ils dormiront dans le salon sur des matelas, à même le sol. Shirin passe ses journées à observer, écouter et retranscrire ce qu'elle entend et ce qu'elle voit dans des petits carnets qu'elle garde précieusement.
L'autrice nous raconte la nouvelle vie de cette enfant au sein d'une famille communiste sur plus d'une décennie.
Dans son récit, Abnousse Shalmani évoque le quotidien d'une famille exilée, installée en France, dont le cœur est resté au pays. On découvre les portraits de divers personnages dont Mitra, la tante tyrannique et égoïste, Zizi et Tala, les artistes inséparables, puis le grand-père qui ne parle plus depuis son exil. Il y a aussi Omid, l'intellectuel. Au sein de son monde, Shirin grandit et poursuit son chemin.
Entourée de révolutionnaires et de trafiquants d'armes, Shirin voue une admiration sans faille pour sa mère. Nous allons suivre cette petite fille sur une dizaine d'années. Elle va grandir, s'instruire et devenir une jeune femme libre et indépendante qui va s'affranchir du poids familial tout en restant attachée à ses origines.
Un roman abordant la famille et le déracinement avec une grande justesse, beaucoup d'ironie et de mordant. J'ai particulièrement aimé découvrir la culture iranienne et les chapitres évoquant les légendes perses qui se mêlent au récit.
Lien : http://labibliothequedemarjo..
L'autrice nous raconte la nouvelle vie de cette enfant au sein d'une famille communiste sur plus d'une décennie.
Dans son récit, Abnousse Shalmani évoque le quotidien d'une famille exilée, installée en France, dont le cœur est resté au pays. On découvre les portraits de divers personnages dont Mitra, la tante tyrannique et égoïste, Zizi et Tala, les artistes inséparables, puis le grand-père qui ne parle plus depuis son exil. Il y a aussi Omid, l'intellectuel. Au sein de son monde, Shirin grandit et poursuit son chemin.
Entourée de révolutionnaires et de trafiquants d'armes, Shirin voue une admiration sans faille pour sa mère. Nous allons suivre cette petite fille sur une dizaine d'années. Elle va grandir, s'instruire et devenir une jeune femme libre et indépendante qui va s'affranchir du poids familial tout en restant attachée à ses origines.
Un roman abordant la famille et le déracinement avec une grande justesse, beaucoup d'ironie et de mordant. J'ai particulièrement aimé découvrir la culture iranienne et les chapitres évoquant les légendes perses qui se mêlent au récit.
Lien : http://labibliothequedemarjo..
La famille de Shirin, des bourgeois intellectuels de gauche, quitte Téhéran dans les années 80, son père tout d’abord, puis elle-même et sa mère. À Paris, ils retrouvent les trois sœurs de sa mère, et son grand-père, personnages autour desquels tout le roman est construit. Il faut dire qu’entre Mitra la tyrannique, Zizi, l’artiste, et la jeune révolutionnaire Tala, les trois sœurs sont des femmes envahissantes, écrasantes, surtout pour la mère de Shirin, qu’elles traitent quasiment comme une domestique. La précarité économique les contraint de plus à cohabiter dans un petit appartement.
J’ai commencé à vraiment apprécier ce roman au bout d’une cinquantaine de pages, avec le portrait de la mère, l’apprentissage acharné par la petite fille de la langue française et l’apparition d’Omid. Shirin tombe sous le charme de cet ami juif de sa tante Tala, et lui aussi se prend d’affection pour la petite fille, lui ouvrant les portes des musées pour parfaire sa culture.
L’immense atout de ce roman d’apprentissage et d’exil, un sujet somme toute assez présent dans la littérature, c’est la langue très chatoyante, très personnelle, de l’auteure, parfois un peu péremptoire dans les affirmations qui viennent clore certains paragraphes, mais cela fait partie de son charme aussi...
Le thème de la politique en exil, la vision qu’en a Shirin du haut de ses neuf ou dix ans, puis de ses vingt ans, est particulièrement intéressant, mais ce n’est pas le seul. Les thèmes sont nombreux, s’entrelacent, se répondent, se trouvent mis en parallèle avec des légendes persanes ou des histoires constitutives de la légende familiale. Le tout de manière subtile et avec toujours ce style qui sublime tout. C’est souvent assez drôle, par les mots choisis, et par le surgissement de scènes tragi-comiques. L’apparition du personnage du « tout petit frère », né après treize mois de grossesse, apporte une once de réalisme magique à l’iranienne qui s’intègre fort bien à l’ensemble.
Après un démarrage un peu hésitant, je me suis laissé emporter par le foisonnement de ce roman, son écriture pleine d’esprit, et sa galerie de personnages fascinants.
Lien : https://lettresexpres.wordpr..
J’ai commencé à vraiment apprécier ce roman au bout d’une cinquantaine de pages, avec le portrait de la mère, l’apprentissage acharné par la petite fille de la langue française et l’apparition d’Omid. Shirin tombe sous le charme de cet ami juif de sa tante Tala, et lui aussi se prend d’affection pour la petite fille, lui ouvrant les portes des musées pour parfaire sa culture.
L’immense atout de ce roman d’apprentissage et d’exil, un sujet somme toute assez présent dans la littérature, c’est la langue très chatoyante, très personnelle, de l’auteure, parfois un peu péremptoire dans les affirmations qui viennent clore certains paragraphes, mais cela fait partie de son charme aussi...
Le thème de la politique en exil, la vision qu’en a Shirin du haut de ses neuf ou dix ans, puis de ses vingt ans, est particulièrement intéressant, mais ce n’est pas le seul. Les thèmes sont nombreux, s’entrelacent, se répondent, se trouvent mis en parallèle avec des légendes persanes ou des histoires constitutives de la légende familiale. Le tout de manière subtile et avec toujours ce style qui sublime tout. C’est souvent assez drôle, par les mots choisis, et par le surgissement de scènes tragi-comiques. L’apparition du personnage du « tout petit frère », né après treize mois de grossesse, apporte une once de réalisme magique à l’iranienne qui s’intègre fort bien à l’ensemble.
Après un démarrage un peu hésitant, je me suis laissé emporter par le foisonnement de ce roman, son écriture pleine d’esprit, et sa galerie de personnages fascinants.
Lien : https://lettresexpres.wordpr..
Le poids de l’histoire de ces exilés, de leur difficulté à s’enraciner ailleurs, était une bonne idée qui est bien rendue dans ce roman. Mais le choix d’une famille aussi loufoque et improbable a gâché ma lecture. J’ai aussi été frustré d’un contexte politique évoqué de façon aussi elliptique. Bref, malgré une belle écriture, je suis content d’en avoir terminé avec ce livre.
Pas facile d'être une petite fille iranienne exilée en France. Encore moins facile lorsqu'on appartient à une famille composée de personnalités plus ou moins bien intentionnées : trois tantes égocentriques (Mitra, l'aînée autoritaire ; Zizi, l'artiste opiomane ; Tala, l'électron libre), une mère qui lit l'avenir dans le marc de café et qui s'écrase devant le nombrilisme de ses sœurs, un grand-père pas très net et un père qui a déposé les armes face à un entourage communiste endurci.
Au lendemain de la révolution islamique d'Iran, dans le Paris des années 80, l'histoire de la famille Hedayat nous est contée à travers le regard de Shirin qui, à l'âge de neuf ans, voit s'ébrécher ses illusions et sa naïveté d'enfant. Sur un ton malicieux et incisif, elle s'interroge sur ce monde d'adultes déracinés. De Téhéran à Paris, on voyage avec elle entre un avant et un après, entre un ici et un ailleurs, dans une nouvelle vie dans laquelle elle doit tout (ré)apprendre sans nécessairement pouvoir compter sur le soutien de ses proches : son rapport au corps, aux autres, à l'Histoire, à l'art et à la littérature.
Au rythme de fêtes iraniennes (Shabe Yalda, le solstice d'hiver ; Norouz, le nouvel an), une petite fille devient femme sous nos yeux et nous embarque dans ses réflexions sur les conséquences de l'exil, sur les relations familiales, sur un passé qui peut engluer les générations à venir. Au passage, la figure du révolutionnaire, souvent idéalisée, fantasmée, et romancée prend un sacré coup dans la figure.
J'ai eu un vrai coup de cœur pour ... [la suite sur le blog !]
Lien : https://www.chezlaurette.org..
Au lendemain de la révolution islamique d'Iran, dans le Paris des années 80, l'histoire de la famille Hedayat nous est contée à travers le regard de Shirin qui, à l'âge de neuf ans, voit s'ébrécher ses illusions et sa naïveté d'enfant. Sur un ton malicieux et incisif, elle s'interroge sur ce monde d'adultes déracinés. De Téhéran à Paris, on voyage avec elle entre un avant et un après, entre un ici et un ailleurs, dans une nouvelle vie dans laquelle elle doit tout (ré)apprendre sans nécessairement pouvoir compter sur le soutien de ses proches : son rapport au corps, aux autres, à l'Histoire, à l'art et à la littérature.
Au rythme de fêtes iraniennes (Shabe Yalda, le solstice d'hiver ; Norouz, le nouvel an), une petite fille devient femme sous nos yeux et nous embarque dans ses réflexions sur les conséquences de l'exil, sur les relations familiales, sur un passé qui peut engluer les générations à venir. Au passage, la figure du révolutionnaire, souvent idéalisée, fantasmée, et romancée prend un sacré coup dans la figure.
J'ai eu un vrai coup de cœur pour ... [la suite sur le blog !]
Lien : https://www.chezlaurette.org..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Abnousse Shalmani
Lecteurs de Abnousse Shalmani (374)Voir plus
Quiz
Voir plus
Hunger Games
Quelle est le plus grand atout de Katniss dans le jeu?
Sa force physique
son don pour le tir à l'arc
sa connaissance des plantes médicinales
Son sens de l'humour
6 questions
5398 lecteurs ont répondu
Thème : Hunger Games, tome 1 de
Suzanne CollinsCréer un quiz sur cet auteur5398 lecteurs ont répondu