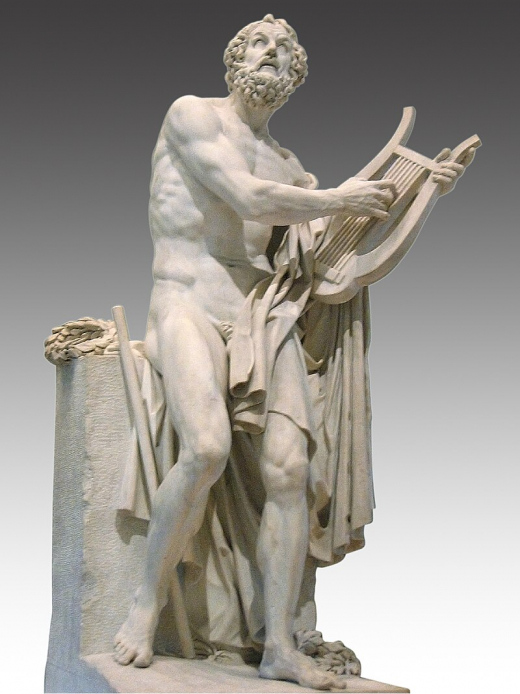Critiques de Homère (460)
L'Odyssée, c'est un peu comme les fables De La Fontaine ou Les Aventures de Pinocchio : tout le monde connaît… ou croit connaître, sans même avoir besoin de lire les originaux. Et pourtant, oui, pourtant, combien pourraient être surpris(es) celles ou ceux qui ne l'ont pas encore lue !
C'est donc à vous que je m'adresse, vous qui ne l'avez pas lue mais pensez déjà tout connaître. À vue de nez, comme ça, quel volume représente, sur les 24 chants que compte la narration, les fameuses péripéties d'Ulysse, depuis Troie jusqu'à l'île de Calypso, celle où il reste scotché huit longues années avant de pouvoir rentrer au bercail ?
Allez, allez, dites, pour voir… Eh oui, seulement 4 malheureux chapitres sur 24, dont un exclusivement réservé au voyage souterrain dans le royaume d'Hadès, donc disons 3 seulement. (Mais de quoi parle-t-il, alors, dans tout le reste ? That is the question, et j'y reviens plus bas.)
Ainsi, l'épisode des Lotophages ? catapulté en à peine plus d'une demi-page ! Celui des Lestrygons ? expédié en 2 pages. Celui des Sirènes ? torché en à peine une page et demie. Charybde et Scylla ? Moins encore. Eh oui ! ça ne traîne pas la narration à ce moment-là, une poignée de vers ici ou là et le tour est joué (plus tard c'est un peu différent, certains passages, non liés au périple sont même un brin longuets). À propos, aviez-vous retenu que la première mésaventure d'Ulysse était l'épisode chez les Cicones (pas si connes que ça, d'ailleurs), dans l'actuelle partie orientale de la Grèce ?
À titre de comparaison, vous qui n'avez peut-être jamais entendu parler du porcher Eumée. Quel volume occupe-t-il, lui, d'après vous, dans ce poème épique ? Réponse : depuis la fin du chant XIII jusqu'à la fin du chant XVII, soit environ 70 pages. Étonnant, non ?
Et Alcinoos ? Vous connaissez Alcinoos, je suppose ? Car lui non plus n'a pas un rôle anecdotique. Deux chants et demi (soit environ 35 pages) lui sont presqu'entièrement consacrés dans L'Odyssée. D'ailleurs, savez-vous exactement ce que signifie le mot « odyssée » ? J'en croise beaucoup qui s'imaginent que ce mot voudrait dire « périple », « voyage », « aventure », que sais-je ?
Eh bien non : de même que L'Iliade évoque simplement ce qui s'est passé en Ilion, l'autre nom de Troie, L'Odyssée fait uniquement référence à Odysseus, le nom grec de son personnage principal, latinisé plus tard en Ulysse. « Odyssée », en somme, ça veut juste dire « ce qui est arrivé à Odysseus ».
Je ne sais pas si je vous ai convaincus de vous aventurer à lire L'Odyssée, si ça n'est déjà fait, mais permettez-moi encore de vous mentionner certains apports étonnants à notre culture occidentale. Peut-être vous arrive-t-il de dire « à tes souhaits » lorsque l'un de vos proches éternue ? Eh bien c'est à l'Odyssée que vous le devez, très certainement.
En effet, cela fait référence au moment précis où Pénélope, dans le chant XVII, fait le voeux qu'Ulysse revienne afin de punir les prétendants à sa succession de leurs divers abus et où Télémaque éternue bruyamment, ce qui était considéré, à l'époque, comme un bon présage à propos de ce qui venait d'être souhaité.
Autre chose. La tradition de la « baguette magique », ça vient d'où ? Oui, c'est vrai, pourquoi donc une baguette serait-elle le véhicule de la magie de quelqu'un ? Harry Potter ou la fée de Cendrillon se soucient-ils de savoir d'où vient ce prodige ? Eh bien je vais vous le dire, moi, car c'est bien la question centrale du XXIème siècle, c'est Athéna, alias Pallas — jamais lasse d'ailleurs —, qui, lorsqu'elle se pique de vouloir métamorphoser quelqu'un, le touche de sa baguette, et bing ! voilà notre beau, notre fort Ulysse transformé ipso facto en vieillard loqueteux. Et va que je te le retouche avec ma baguette, et re-bing !, le v'là à nouveau tout pimpant, tout fringant, à bomber le torse dans son slip Athéna. (Hermès aussi possède une baguette dans le chant XXIV, mais comme c'est du prêt-à-porter haut de gamme, elle est en or celle-là, vous comprenez !)
Qu'en est-il de la tradition du fantôme, du spectre ? Là encore, je crois que cette représentation doit à peu près tout à L'Odyssée. En effet, c'est lors du séjour souterrain au royaume d'Hadès et de Perséphone qu'on perd ses formes, en tout cas, que l'image demeure mais plus le contact physique. C'est ce que constata Ulysse en essayant d'étreindre le fantôme de sa défunte mère Anticlée.
À ce propos, les tenant(e)s de la cause féministe, celles ou ceux qui professent que de tout temps les femmes ont toujours été négligées, négligeables, s'interrogent-ils sur la signification de toutes ces hordes de femmes puissantes qu'Ulysse rencontre en pays d'Hadès, ou même, plus largement, plus généralement, sur l'étonnant pouvoir qu'elles possèdent dans la totalité de ce récit mythique : d'Athéna à Circé, de Calypso à Idothée, d'Arété à Pénélope en passant par Nausicaa, sans oublier les sabots d'Hélène ni le trousseau d'Euryclée ?
Car c'est troublant, n'est-ce pas, dans cette société ô combien machiste de la Méditerranée antique de voir combien tout tourne autour des femmes et surtout de leur pouvoir. (Je l'avais déjà constaté à propos des tragédies d'Euripide, majoritairement centrées sur des personnages féminins, ou d'une comédie comme Lysistrata d'Aristophane.) Je ne vais prendre qu'un seul exemple parmi les divinités ; chez Hadès, on ne nous parle jamais du maître des lieux, ni d'un éventuel sentiment positif ou négatif qu'il inspirerait, par contre, tous ont le trouillomètre à zéro sitôt qu'ils évoquent Perséphone. Parmi les mortels, au sein des multiples griefs faits aux irrévérencieux prétendants entassés en son palais pendant son absence, Ulysse reproche surtout (aux chants XX et XXII) aux princes d'avoir violé ses servantes. Étonnant, non ? Et je pourrais de la sorte multiplier les exemples, sur l'intégralité du mythe.
Il y a encore des tas d'autres questions soulevées par la lecture de L'Odyssée. Pourquoi nous précise-t-on tout le temps que le bateau d'Ulysse a la proue bleue ? Pourquoi Ulysse distingue-t-il tant les peuples « mangeurs de pain » des autres ? Pourquoi les mensonges d'Ulysse et d'Athéna sont-ils si nombreux, si fréquents, et présentés si positivement, quand Télémaque, lui, n'a jamais besoin de recourir au mensonge (sauf par omission) alors que tout l'y pousserait ? Pourquoi Idothée aiderait-elle Ménélas à entourlouper son propre père Prothée ? Et en quoi ce vieux transformeur subaquatique, digne de faire pâlir Merlin l'enchanteur et Madame Mim réunis, serait-il mieux au courant qu'un autre de ce qui empêche le frangin d'Agamemnon de rentrer au bercail ?
Aussi, plutôt que de vous donner de quelconques interprétations sur ces questions-là, j'aime autant titiller votre curiosité afin de vous inciter, si tel n'était pas le cas, à venir vous frotter à ce monument de la culture occidentale, en vous précisant encore que l'un des grands rêves de nos bien-aimés dirigeants de Google, Amazon ou Tesla, savoir, le véhicule autonome sans pilote, était déjà formulé dès les origines, ici, dans L'Odyssée, car c'est précisément la spécialité des Phéaciens, qui s'avèrent capables d'affréter des bateaux rapides, fiables et… sans personne pour les diriger !
Non, moi, ce qui m'intéresse, quand je lis L'Odyssée, c'est d'essayer de comprendre la fonction du mythe, à qui il s'adresse et ce qu'on espère de lui. Car vous conviendrez que si l'on s'encombre de perpétuer un récit mythique, c'est que l'on en attend quelque chose, un quelconque effet sur l'auditoire auquel il s'adressait, n'est-ce pas ?
Tout mythe fondateur, ancien comme moderne (nos deux derniers mythes fondateurs modernes sont la Révolution française et la Seconde guerre mondiale) s'appuie sur des faits réels, plus ou moins manipulés, entortillés, bidouillés, le tout dans le but de donner une ligne de conduite claire à ceux qui s'en réclament ultérieurement.
Ainsi, je comprends mieux pourquoi celui qu'on baptise, pour faire simple, « Homère » (car il est certain que plusieurs auteurs, sans doute sur plusieurs siècles ont remanié ce mythe, qui avait déjà probablement eu une longue carrière exclusivement orale auparavant) a choisi de ne pas s'appesantir sur le volet « surnaturel » du mythe mais de faire la part belle, au contraire, aux actions auxquelles tout un chacun pourrait s'identifier.
De la sorte, ce qui ressort, selon moi, c'est la ligne de conduite que professe l'épopée : si vous êtes une femme, soit vous êtes de haut rang et vous vous identifiez à Pénélope, ce qui veut dire que vous êtes fidèle, pas comme cette traînée de Clytemnestre qui a trompé Agamemnon et l'a fait zigouiller en douce. Si vous êtes une domestique, votre modèle absolu, c'est Euryclée, la servante dévouée et incorruptible jusqu'à la mort, pas comme ces souillons qui ont couché à droite à gauche avec tous les prétendants pendant que le boss était de sortie. En somme, c'est tout à fait du même ordre que l'ancestral proverbe : « Quand le chat n'est pas là les souris dansent. »
Si vous êtes un homme, même chose, voici les exemples à suivre et les contre exemples : pour les humbles, l'exemple, c'est le porcher Eumée, le gars travailleur, honnête et fidèle à son patron. Si vous êtes un puissant, vous vous devez d'être magnanime, accueillant et généreux, tel que l'est Alcinoos. Ça vous dit quelque chose ? Comprenez-vous mieux pourquoi ceux-là tiennent tant de place dans la narration et non les épisodes dont tout le monde parle, du Cyclope, de Circé, de Calypso, d'Éole et tutti quanti ?
De sorte que, même si, comme Ulysse, vous avez accompli des prodiges, vous devez toujours rester humble, tel que lui l'est à son retour, transformé en gueux par les bons soins d'Athéna. Vous devez être méfiants et ne rien vous croire acquis d'avance car tout le monde cherchera à vous escroquer, vous spolier votre richesse chèrement gagnée, vous devrez prêcher le faux pour savoir le vrai afin de tester la loyauté de vos proches. Bref, un vrai programme digne d'un syndicat patronal de PME ! En somme, le Ulysse moderne, ce serait une sorte de Jean-Baptiste André Godin, le capitaine d'industrie sympa, qui créa les poêles du même non et les cités ouvrières à dimension humaine. D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce dernier fût un lecteur assidu de L'Odyssée, mais je n'en ai pas la preuve formelle.
Le contre exemple, ce sont bien évidemment les infidèles, les envieux, les irrévérencieux prétendants, ces parasites qui dilapident le bien d'autrui et qui, s'ils périrent par les armes, ne jouiront jamais du culte ni des sépultures merveilleuses telles que celles qui furent édifiées pour l'exemple absolu de la mort « digne », savoir, celle d'Achille, d'où ce rappel au dernier chant de l'épopée.
Pour conclure, outre, comme je l'avais mentionné dans ma réflexion à propos de L'Iliade, l'apologie de l'installation de comptoirs grecs un peu partout en Méditerranée afin de civiliser moindrement tous ces odieux peuples qui ne mangent même pas de pain (et qui ne révèrent donc pas les dieux de l'Olympe, ce qui est bien pire encore, convenons-en, et ce qui justifie certainement une bonne vieille colonisation en règle), cette Odyssée me semble revêtir un aspect social important dont le message pourrait se résumer ainsi : ayez confiance en vos dieux, en vos rois (ce qui revient au même, car les mauvais rois seront châtiés par les dieux, tels que le furent les prétendants), ils sont tous bons et ils en ont vu plus que vous. Surtout ne déviez pas du droit chemin qu'ils vous dictent, bref, ne soyez pas séditieux, quoi !
Je dois reconnaître que ce n'est pas nécessairement le genre de message dont je raffole, moi qui n'affectionne ni dieu ni maître, mais la lecture de L'Odyssée va, bien évidemment, au-delà, ô combien, de son message immédiat. La culture en a retenu les anecdotes, la traduction en altère forcément une bonne part. Personnellement, j'ai lu celle de Philippe Jaccottet, que je pense assez sensationnelle et qui nous invite à considérer ô combien on perd par rapport à la mélodie, la prosodie, la psalmodie initiales.
D'un point de vue narratif, même si ça n'est de loin pas le souci primordial des auteurs, la construction de la première moitié est fort intéressante, puisqu'on débute le poème au moment où Ulysse est encore au plus loin de chez lui chez la nymphe Calypso, où Télémaque n'en peut plus de voir ces goinfres de pourceaux de prétendants se vautrer de façon menaçante dans ce qui lui revient de droit et surtout, de ne pas savoir si, oui ou non, son père est bel et bien mort. On comprend donc que la tension narrative est tout de suite présente et que les péripéties d'Ulysse apparaîtront ultérieurement sous forme de flash-back. La seconde moitié de la narration m'est apparue beaucoup, beaucoup plus poussive, et, partant, moins plaisante.
J'en termine, Ô mer, en te jetant cette bouteille à vis, où l'avis s'enroule dans tes rouleaux, mais, n'étant que mien, tel l'esquif misérable après la houle de Zeus, le fracas de Poséidon et la baguette tragique d'Athéna, atomisé façon puzzle, il ne signifie certainement pas grand-chose.
C'est donc à vous que je m'adresse, vous qui ne l'avez pas lue mais pensez déjà tout connaître. À vue de nez, comme ça, quel volume représente, sur les 24 chants que compte la narration, les fameuses péripéties d'Ulysse, depuis Troie jusqu'à l'île de Calypso, celle où il reste scotché huit longues années avant de pouvoir rentrer au bercail ?
Allez, allez, dites, pour voir… Eh oui, seulement 4 malheureux chapitres sur 24, dont un exclusivement réservé au voyage souterrain dans le royaume d'Hadès, donc disons 3 seulement. (Mais de quoi parle-t-il, alors, dans tout le reste ? That is the question, et j'y reviens plus bas.)
Ainsi, l'épisode des Lotophages ? catapulté en à peine plus d'une demi-page ! Celui des Lestrygons ? expédié en 2 pages. Celui des Sirènes ? torché en à peine une page et demie. Charybde et Scylla ? Moins encore. Eh oui ! ça ne traîne pas la narration à ce moment-là, une poignée de vers ici ou là et le tour est joué (plus tard c'est un peu différent, certains passages, non liés au périple sont même un brin longuets). À propos, aviez-vous retenu que la première mésaventure d'Ulysse était l'épisode chez les Cicones (pas si connes que ça, d'ailleurs), dans l'actuelle partie orientale de la Grèce ?
À titre de comparaison, vous qui n'avez peut-être jamais entendu parler du porcher Eumée. Quel volume occupe-t-il, lui, d'après vous, dans ce poème épique ? Réponse : depuis la fin du chant XIII jusqu'à la fin du chant XVII, soit environ 70 pages. Étonnant, non ?
Et Alcinoos ? Vous connaissez Alcinoos, je suppose ? Car lui non plus n'a pas un rôle anecdotique. Deux chants et demi (soit environ 35 pages) lui sont presqu'entièrement consacrés dans L'Odyssée. D'ailleurs, savez-vous exactement ce que signifie le mot « odyssée » ? J'en croise beaucoup qui s'imaginent que ce mot voudrait dire « périple », « voyage », « aventure », que sais-je ?
Eh bien non : de même que L'Iliade évoque simplement ce qui s'est passé en Ilion, l'autre nom de Troie, L'Odyssée fait uniquement référence à Odysseus, le nom grec de son personnage principal, latinisé plus tard en Ulysse. « Odyssée », en somme, ça veut juste dire « ce qui est arrivé à Odysseus ».
Je ne sais pas si je vous ai convaincus de vous aventurer à lire L'Odyssée, si ça n'est déjà fait, mais permettez-moi encore de vous mentionner certains apports étonnants à notre culture occidentale. Peut-être vous arrive-t-il de dire « à tes souhaits » lorsque l'un de vos proches éternue ? Eh bien c'est à l'Odyssée que vous le devez, très certainement.
En effet, cela fait référence au moment précis où Pénélope, dans le chant XVII, fait le voeux qu'Ulysse revienne afin de punir les prétendants à sa succession de leurs divers abus et où Télémaque éternue bruyamment, ce qui était considéré, à l'époque, comme un bon présage à propos de ce qui venait d'être souhaité.
Autre chose. La tradition de la « baguette magique », ça vient d'où ? Oui, c'est vrai, pourquoi donc une baguette serait-elle le véhicule de la magie de quelqu'un ? Harry Potter ou la fée de Cendrillon se soucient-ils de savoir d'où vient ce prodige ? Eh bien je vais vous le dire, moi, car c'est bien la question centrale du XXIème siècle, c'est Athéna, alias Pallas — jamais lasse d'ailleurs —, qui, lorsqu'elle se pique de vouloir métamorphoser quelqu'un, le touche de sa baguette, et bing ! voilà notre beau, notre fort Ulysse transformé ipso facto en vieillard loqueteux. Et va que je te le retouche avec ma baguette, et re-bing !, le v'là à nouveau tout pimpant, tout fringant, à bomber le torse dans son slip Athéna. (Hermès aussi possède une baguette dans le chant XXIV, mais comme c'est du prêt-à-porter haut de gamme, elle est en or celle-là, vous comprenez !)
Qu'en est-il de la tradition du fantôme, du spectre ? Là encore, je crois que cette représentation doit à peu près tout à L'Odyssée. En effet, c'est lors du séjour souterrain au royaume d'Hadès et de Perséphone qu'on perd ses formes, en tout cas, que l'image demeure mais plus le contact physique. C'est ce que constata Ulysse en essayant d'étreindre le fantôme de sa défunte mère Anticlée.
À ce propos, les tenant(e)s de la cause féministe, celles ou ceux qui professent que de tout temps les femmes ont toujours été négligées, négligeables, s'interrogent-ils sur la signification de toutes ces hordes de femmes puissantes qu'Ulysse rencontre en pays d'Hadès, ou même, plus largement, plus généralement, sur l'étonnant pouvoir qu'elles possèdent dans la totalité de ce récit mythique : d'Athéna à Circé, de Calypso à Idothée, d'Arété à Pénélope en passant par Nausicaa, sans oublier les sabots d'Hélène ni le trousseau d'Euryclée ?
Car c'est troublant, n'est-ce pas, dans cette société ô combien machiste de la Méditerranée antique de voir combien tout tourne autour des femmes et surtout de leur pouvoir. (Je l'avais déjà constaté à propos des tragédies d'Euripide, majoritairement centrées sur des personnages féminins, ou d'une comédie comme Lysistrata d'Aristophane.) Je ne vais prendre qu'un seul exemple parmi les divinités ; chez Hadès, on ne nous parle jamais du maître des lieux, ni d'un éventuel sentiment positif ou négatif qu'il inspirerait, par contre, tous ont le trouillomètre à zéro sitôt qu'ils évoquent Perséphone. Parmi les mortels, au sein des multiples griefs faits aux irrévérencieux prétendants entassés en son palais pendant son absence, Ulysse reproche surtout (aux chants XX et XXII) aux princes d'avoir violé ses servantes. Étonnant, non ? Et je pourrais de la sorte multiplier les exemples, sur l'intégralité du mythe.
Il y a encore des tas d'autres questions soulevées par la lecture de L'Odyssée. Pourquoi nous précise-t-on tout le temps que le bateau d'Ulysse a la proue bleue ? Pourquoi Ulysse distingue-t-il tant les peuples « mangeurs de pain » des autres ? Pourquoi les mensonges d'Ulysse et d'Athéna sont-ils si nombreux, si fréquents, et présentés si positivement, quand Télémaque, lui, n'a jamais besoin de recourir au mensonge (sauf par omission) alors que tout l'y pousserait ? Pourquoi Idothée aiderait-elle Ménélas à entourlouper son propre père Prothée ? Et en quoi ce vieux transformeur subaquatique, digne de faire pâlir Merlin l'enchanteur et Madame Mim réunis, serait-il mieux au courant qu'un autre de ce qui empêche le frangin d'Agamemnon de rentrer au bercail ?
Aussi, plutôt que de vous donner de quelconques interprétations sur ces questions-là, j'aime autant titiller votre curiosité afin de vous inciter, si tel n'était pas le cas, à venir vous frotter à ce monument de la culture occidentale, en vous précisant encore que l'un des grands rêves de nos bien-aimés dirigeants de Google, Amazon ou Tesla, savoir, le véhicule autonome sans pilote, était déjà formulé dès les origines, ici, dans L'Odyssée, car c'est précisément la spécialité des Phéaciens, qui s'avèrent capables d'affréter des bateaux rapides, fiables et… sans personne pour les diriger !
Non, moi, ce qui m'intéresse, quand je lis L'Odyssée, c'est d'essayer de comprendre la fonction du mythe, à qui il s'adresse et ce qu'on espère de lui. Car vous conviendrez que si l'on s'encombre de perpétuer un récit mythique, c'est que l'on en attend quelque chose, un quelconque effet sur l'auditoire auquel il s'adressait, n'est-ce pas ?
Tout mythe fondateur, ancien comme moderne (nos deux derniers mythes fondateurs modernes sont la Révolution française et la Seconde guerre mondiale) s'appuie sur des faits réels, plus ou moins manipulés, entortillés, bidouillés, le tout dans le but de donner une ligne de conduite claire à ceux qui s'en réclament ultérieurement.
Ainsi, je comprends mieux pourquoi celui qu'on baptise, pour faire simple, « Homère » (car il est certain que plusieurs auteurs, sans doute sur plusieurs siècles ont remanié ce mythe, qui avait déjà probablement eu une longue carrière exclusivement orale auparavant) a choisi de ne pas s'appesantir sur le volet « surnaturel » du mythe mais de faire la part belle, au contraire, aux actions auxquelles tout un chacun pourrait s'identifier.
De la sorte, ce qui ressort, selon moi, c'est la ligne de conduite que professe l'épopée : si vous êtes une femme, soit vous êtes de haut rang et vous vous identifiez à Pénélope, ce qui veut dire que vous êtes fidèle, pas comme cette traînée de Clytemnestre qui a trompé Agamemnon et l'a fait zigouiller en douce. Si vous êtes une domestique, votre modèle absolu, c'est Euryclée, la servante dévouée et incorruptible jusqu'à la mort, pas comme ces souillons qui ont couché à droite à gauche avec tous les prétendants pendant que le boss était de sortie. En somme, c'est tout à fait du même ordre que l'ancestral proverbe : « Quand le chat n'est pas là les souris dansent. »
Si vous êtes un homme, même chose, voici les exemples à suivre et les contre exemples : pour les humbles, l'exemple, c'est le porcher Eumée, le gars travailleur, honnête et fidèle à son patron. Si vous êtes un puissant, vous vous devez d'être magnanime, accueillant et généreux, tel que l'est Alcinoos. Ça vous dit quelque chose ? Comprenez-vous mieux pourquoi ceux-là tiennent tant de place dans la narration et non les épisodes dont tout le monde parle, du Cyclope, de Circé, de Calypso, d'Éole et tutti quanti ?
De sorte que, même si, comme Ulysse, vous avez accompli des prodiges, vous devez toujours rester humble, tel que lui l'est à son retour, transformé en gueux par les bons soins d'Athéna. Vous devez être méfiants et ne rien vous croire acquis d'avance car tout le monde cherchera à vous escroquer, vous spolier votre richesse chèrement gagnée, vous devrez prêcher le faux pour savoir le vrai afin de tester la loyauté de vos proches. Bref, un vrai programme digne d'un syndicat patronal de PME ! En somme, le Ulysse moderne, ce serait une sorte de Jean-Baptiste André Godin, le capitaine d'industrie sympa, qui créa les poêles du même non et les cités ouvrières à dimension humaine. D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce dernier fût un lecteur assidu de L'Odyssée, mais je n'en ai pas la preuve formelle.
Le contre exemple, ce sont bien évidemment les infidèles, les envieux, les irrévérencieux prétendants, ces parasites qui dilapident le bien d'autrui et qui, s'ils périrent par les armes, ne jouiront jamais du culte ni des sépultures merveilleuses telles que celles qui furent édifiées pour l'exemple absolu de la mort « digne », savoir, celle d'Achille, d'où ce rappel au dernier chant de l'épopée.
Pour conclure, outre, comme je l'avais mentionné dans ma réflexion à propos de L'Iliade, l'apologie de l'installation de comptoirs grecs un peu partout en Méditerranée afin de civiliser moindrement tous ces odieux peuples qui ne mangent même pas de pain (et qui ne révèrent donc pas les dieux de l'Olympe, ce qui est bien pire encore, convenons-en, et ce qui justifie certainement une bonne vieille colonisation en règle), cette Odyssée me semble revêtir un aspect social important dont le message pourrait se résumer ainsi : ayez confiance en vos dieux, en vos rois (ce qui revient au même, car les mauvais rois seront châtiés par les dieux, tels que le furent les prétendants), ils sont tous bons et ils en ont vu plus que vous. Surtout ne déviez pas du droit chemin qu'ils vous dictent, bref, ne soyez pas séditieux, quoi !
Je dois reconnaître que ce n'est pas nécessairement le genre de message dont je raffole, moi qui n'affectionne ni dieu ni maître, mais la lecture de L'Odyssée va, bien évidemment, au-delà, ô combien, de son message immédiat. La culture en a retenu les anecdotes, la traduction en altère forcément une bonne part. Personnellement, j'ai lu celle de Philippe Jaccottet, que je pense assez sensationnelle et qui nous invite à considérer ô combien on perd par rapport à la mélodie, la prosodie, la psalmodie initiales.
D'un point de vue narratif, même si ça n'est de loin pas le souci primordial des auteurs, la construction de la première moitié est fort intéressante, puisqu'on débute le poème au moment où Ulysse est encore au plus loin de chez lui chez la nymphe Calypso, où Télémaque n'en peut plus de voir ces goinfres de pourceaux de prétendants se vautrer de façon menaçante dans ce qui lui revient de droit et surtout, de ne pas savoir si, oui ou non, son père est bel et bien mort. On comprend donc que la tension narrative est tout de suite présente et que les péripéties d'Ulysse apparaîtront ultérieurement sous forme de flash-back. La seconde moitié de la narration m'est apparue beaucoup, beaucoup plus poussive, et, partant, moins plaisante.
J'en termine, Ô mer, en te jetant cette bouteille à vis, où l'avis s'enroule dans tes rouleaux, mais, n'étant que mien, tel l'esquif misérable après la houle de Zeus, le fracas de Poséidon et la baguette tragique d'Athéna, atomisé façon puzzle, il ne signifie certainement pas grand-chose.
Nous y voilà. Cela fait un petit moment que je médite une petite critique sur ce monument culturel. Car effectivement, on se sent petite face à un tel monument, face à tout ce qu'il représente et surtout, face à la tâche très complexe de le bien comprendre et de l'interpréter.
Il me faut, de suite, concéder que j'ai renoncé à l'espoir de parvenir à le bien comprendre un jour. Je ne puis que me risquer à hasarder des interprétations. Mais avant de vous infliger une quelconque interprétation, permettez-moi d'abord de débroussailler quelque peu ce qu'est ce livre et son contexte.
Pour beaucoup de gens, lorsque j'interroge autour de moi (Car, là encore je le confesse, il m'arrive de questionner candidement certaines personnes en leur laissant entendre que j'ignore tout du sujet ou de prêcher le faux afin de savoir, peut-être pas le vrai, mais du moins, avoir accès à certains points de vue.), lorsque j'interroge, donc, on me répond souvent, pour faire simple, que l'Iliade, c'est le récit de la Guerre de Troie et que l'Odyssée, c'est le récit du retour mouvementé d'Ulysse après moult péripéties auprès de sa chère et tendre Pénélope.
Certes, il doit y avoir un peu de ça, mais je tiens tout de suite à vous retirer cette croyance du crâne car en fait, l'Iliade et l'Odyssée sont deux tronçons, et deux tronçons seulement, d'un récit mythique BEAUCOUP plus vaste qu'on désigne communément sous le nom de cycle Troyen.
J'en veux pour preuve que deux des éléments les plus croustillants de la fameuse Guerre de Troie ne sont pas abordés dans l'Iliade, à savoir, la mort d'Achille (et son fameux talon) et l'épisode encore plus fameux du Cheval de Troie. N'espérez donc pas les lire ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée.
La mort d'Achille était racontée dans un livre intitulé L'Éthiopide et qui est, pour l'essentiel, perdu. L'épisode du Cheval de Troie et la ruse légendaire d'Ulysse pour s'introduire auprès d'Hélène étaient eux racontés dans un autre livre communément intitulé, La Petite Iliade, lui aussi, pour l'essentiel, perdu. D'autres détails à propos du Cheval de Troie, du rapt de Cassandre par Ajax (le petit) et du sort réservé à la famille d'Hector étaient eux présentés dans le Sac de Troie, récit désormais perdu.
Ce n'est qu'alors qu'est abordé l'épineux problème du retour des héros grecs de cette guerre. Leur sort varie grandement et est conté dans Les Retours, lui aussi perdu. Par exemple, Néoptolème, Diomède ou Nestor rentrent sans encombre. Mais il n'en va pas de même pour Agamemnon, Ménélas ou Ulysse.
Et ce n'est qu'alors que le destin d'Ulysse est longuement raconté dans l'Odyssée. (Au passage, je rappelle que le nom grec d'Ulysse est Odousseus et le titre ne spécifie pas, en soi, qu'il s'agit d'un quelconque voyage, mais qu'il y est simplement question du sort d'Ulysse.) de même, il y avait une suite à l'Odyssée, qui s'intitulait La Télégonie.
En outre, je ne vous ai parlé que de ce qui suit l'Iliade, mais vous vous doutez qu'il y avait également bon nombre d'événements préalables puisque le texte qui nous occupe aujourd'hui ne débute qu'à l'issue de neuf années de guerre entre Grecs et Troyens, au moment précis où Achille envoie paître Agamemnon pour lui avoir soutiré le butin qui lui revenait de droit, après une énième conquête héroïque.
Sans vouloir excessivement rentrer dans les détails, peut-être connaissez-vous ce tableau célèbre de Rubens qui s'intitule le Jugement de Pâris. Il s'agit, en fait de l'élément déclencheur de tout ce pataquès, lui aussi, un livre perdu, intitulé les Chants Cypriens. Trois déesses de l'Olympe se crêpaient le chignon afin de savoir laquelle d'elles trois était définitivement la plus belle : Héra (femme et soeur de Zeus), Athéna (fille de Zeus) et Aphrodite (née de la mer). Afin de trancher cette douloureuse question, papa Zeus envoie les trois commères sur le mont Ida afin que le Troyen Pâris (qui doit avoir un avis autorisé sur la question) tranche le débat.
(Sachez seulement que la prise de bec entre les trois déesses était le fait d'Éris, déesse de la discorde, qui, très amère de n'avoir point été conviée aux noces de Pélée , le père d'Achille, envoya lors du banquet une pomme — dite plus tard, pomme de discorde — où il était inscrit " pour la plus belle ". Ceci pouvant expliquer cela.)
Pâris, qui aimerait bien qu'on lui aménage le coup avec Hélène, femme du Grec Ménélas, s'arrange avec Aphrodite en échange de l'amour d'Hélène. Sans sourciller, il désigne donc Aphrodite Miss Olympe, ce qui a le don de mettre en pétard Héra et Athéna, qui n'auront alors de cesse que de s'en prendre à Troie et qui tout pendant l'Iliade (Ilion est l'autre nom de la ville de Troie) vont soutenir les guerriers grecs et les exhorter à raser cette ville infâme capable de produire un individu susceptible de prétendre qu'elles n'étaient pas les plus belles.
Si bien que l'Iliade d'Homère ne conte finalement qu'un mince passage de toute cette rixe, situé entre le moment où les Grecs perdent leur meilleur champion, Achille, qui se retire du jeu pour cause de bouderie et le moment des funérailles d'Hector, frère de Pâris.
Pendant tout ce temps-là, Hector, un brave parmi les braves, soutenu par Apollon et Zeus en personne, va s'amuser à tailler du Grec en veux-tu en voilà, jusqu'au moment où Patrocle, le meilleur copain d'Achille va aller se mesurer à lui, perdre son combat et, du même coup, redonner à Achille l'envie de se battre à nouveau et d'inverser la vapeur.
Il faut encore sans doute dire un mot ou deux d'Homère même. On ne connaît à peu près rien de solide sur lui et il y a fort à parier que sous cette appellation se cachent en réalité plusieurs auteurs ayant remanié et amélioré le texte sur plusieurs décennies, voire, plusieurs siècles.
Voilà, tout ceci étant dit, ayant fait un très grossier résumé du contexte et des événements dont il était question, il reste le plus gros du travail, à savoir, tâcher d'interpréter ce texte. On sait d'une part qu'il s'agit de la mise par écrit de formes orales (probablement plusieurs formes orales concurrentes) préexistantes depuis sans doute des siècles. En ce sens, l'Iliade (d'ailleurs le cycle troyen dans son entier) est un récit mythique.
Qu'est-ce qu'un récit mythique ? C'est déjà une question difficile en soi et je vous renvoie à l'excellente description qu'en fait Jean-Claude Carrière, notamment sur le lien suivant :
http://www.dailymotion.com/video/xwzdh0_mythes-et-transmissions-1-3_webcam
Ainsi, dans un récit mythique, on nous dit d'où l'on vient, qui sont nos ancêtres, ce qu'ils ont fait pour accéder à l'indépendance et/ou au pouvoir en tant que peuple par rapport aux autres peuples ou bien comment ils se sont établis à tel ou tel endroit.
On y apprend aussi énormément de normes comportementales, c'est-à-dire du comment se comportaient ces devanciers héroïques et donc comment vous devez vous-mêmes vous comporter pour obtenir les mêmes succès et pérenniser votre peuple.
J'ai déjà dit ailleurs qu'à cet égard, l'Iliade est particulièrement intéressante car on y lit expressément que les dieux ne sont pas d'accord entre eux, de même que les héros (Achille et Agamemnon par exemple), ce qui est la marque d'un système social plutôt tolérant et égalitaire (toutes proportions gardées, bien évidemment, et ce en comparaison d'un système hiérarchique très fort et non contestable).
On y lit aussi que les dieux sont très partiaux, et qu'ils n'hésitent pas à tricher pour favoriser leur poulain au détriment d'un adversaire pourtant digne et aux qualités avérées. On y lit également qu'il s'agit d'une société très compétitive, au sens où l'on fait des compétitions pour tout et n'importe quoi, même sur le cadavre des défunts. C'est par exemple le cas au Chant XXIII lorsqu'Achille organise une sorte de proto-jeux olympiques pour savoir à qui il va distribuer du butin en remerciement de la participation aux funérailles de Patrocle. (Étonnante célébration du deuil, vous ne trouvez pas ?)
Il y aurait encore bon nombre de conjectures que l'on pourrait faire à propos de ce texte qui revêt à mes yeux un intérêt bien plus ethnologique que littéraire ou religieux, mais j'ai peur de m'étaler trop en longueur, au vu de la taille déjà indigeste de cette contribution.
Je vais donc privilégier seulement deux points dans mes interprétations : 1) pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ? 2) quid d'Ajax ?
1) Pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ?
Eh oui, a priori, pourquoi ces deux fragments sont-ils demeurés et ont toujours été célébrés avec beaucoup d'égards, notamment par la société grecque ultérieure et pas les autres morceaux de l'épopée ? On peut évidemment invoquer le rôle du hasard dans la perte de certains textes, et ce n'est pas à exclure. On peut également invoquer la qualité littéraire et poétique de ces deux textes par rapport aux autres morceaux du cycle troyen, même s'il est difficile d'en juger à présent que les autres textes sont perdus.
Mais on peut aussi invoquer d'autres facteurs, comme la validité de ces deux morceaux en qualité de récit mythique. L'Iliade raconte, en gros, l'histoire de l'union, de la réunion des cités-états du sud de ce que l'on nomme aujourd'hui la Grèce et qu'étant unies, ces cités-états, et le même peuple qu'elles constitue, régulièrement désigné par Homère comme étant les Achéens, c'est-à-dire un peuple issu et venu du continent européen, les Achéens, donc, qui ont mis la pâtée aux Troyens, c'est-à-dire une coalition majoritairement anatolienne (à l'exception de la Thrace).
À l'époque d'Homère et de ses devanciers, l'essentiel de ce qui se faisait de mieux en matière de civilisation provenait du Croissant Fertile, donc de l'est. L'ouest résonnait comme le territoire des bêtes sauvages à peine humaines. Dire qu'un peuple issu d'Europe puisse venir mettre en déroute sur leurs terres des asiatiques pouvait être un élément fédérateur puissant. (C'est d'ailleurs comme cela que Virgile le comprend car il désigne Agamemnon comme " le vainqueur de l'Asie " au livre XI de son Énéide.) Au demeurant, on sait que l'Iliade est plus ou moins contemporaine où suit de peu l'implantation définitive des Grecs sur les côtes de l'actuelle Turquie.
Et, plus particulièrement, si l'on se place dans le contexte des Guerres Médiques du début du Vème siècle avant J.-C. (entre autres, batailles de Marathon, Thermopyles et Salamine) qui opposaient la grande Asie de Darius et Xerxès aux cités grecques unifiées autour d'Athènes, on comprend de suite mieux que les auteurs du siècle de Périclès aient fait grand cas du récit mythique de l'Illiade, se soldant par une victoire des Grecs après dix années de combat. Tiens, tiens… ça me rappelle quelque chose…
De même, l'Odyssée est sans doute beaucoup plus porteuse de sens si l'on la met en parallèle avec le fait que les Grecs installent des comptoirs un peu partout en Méditerranée à cette époque. le héros grec malicieux qu'est Ulysse et qui vient à bout de toutes les bizarreries et étrangetés de ces mondes inconnus incarne alors à merveille le succès d'implantation des Grecs " à l'outre-mer ".
2) Il y a un personnage troublant dans l'Iliade qui est Ajax. Qui est Ajax et que symbolise-t-il ? Ajax ou les Ajax ? Homère s'ingénie à nous présenter les Ajax (l'un grand, l'autre petit, l'un fils de Télamon, l'autre fils d'Oïlée, ces deux géniteurs faisant partie des Argonautes). Deux personnages avec un même nom, très fréquemment agissant de concert. Qu'en penser ?
En ce qui me concerne, j'ai l'intime conviction que les Ajax sont un dédoublement (pour les besoins d'édification) d'un seul et même personnage. Un personnage doué d'une force surhumaine, qui ne connaît pas la peur, un combattant hors pair comme seul Achille peut souffrir la comparaison. Et pourtant, un personnage étonnamment peu célébré. Jamais il ne reçoit le secours des dieux alors que c'est pourtant lui qui tient la baraque quand Achille boude dans son coin. C'est lui qui ne fait pas grise mine d'être tiré au sort pour avoir le redoutable privilège de rencontrer Hector en combat singulier et c'est même lui qui a l'avantage dans ce combat avant son interruption.
En fait, Homère prend bien soin de retirer tout honneur (comme une victoire sur Hector) ou toute récompense prestigieuse (lors des mini-jeux olympiques d'Achille) aux deux Ajax. On sait que l'un (le fils de Télamon) fera tout un foin lorsqu'il apprendra qu'on ne lui remet pas les armes d'Achille lorsque celui-ci sera tué, deviendra à moitié fou de rage et finira par se suicider. On sait que l'autre (le fils d'Oïlée) commettra un viol sur Cassandre (bon ça, la société antique était prête à le lui pardonner) mais, ce qui est plus grave, c'est qu'il l'a fait dans le temple consacré à Athéna, montrant ainsi son mépris pour les dieux et ça c'est grave.
Dit autrement, Ajax (ou les Ajax, comme vous voulez), représente l'archétype du mercenaire, du gars qui ne combat pas pour un idéal mais uniquement pour le bénéfice qu'il peut retirer du combat. Ses qualités physiques et de combattant sont indéniables, mais ce sont ses motivations qui semblent être clairement fustigées dans ce récit mythique, comme l'atteste la chute finale, la tête en plein dans une bouse de vache, sous l'impulsion d'Athéna, alors même qu'à la régulière il avait devancé Ulysse à la course.
Il est grand temps pour moi de clore ce chapitre des interprétations et de vous inviter à y réfléchir par vous même si le coeur vous en dit, car ceci n'est qu'un misérable avis, c'est-à-dire, vraiment pas grand-chose.
Il me faut, de suite, concéder que j'ai renoncé à l'espoir de parvenir à le bien comprendre un jour. Je ne puis que me risquer à hasarder des interprétations. Mais avant de vous infliger une quelconque interprétation, permettez-moi d'abord de débroussailler quelque peu ce qu'est ce livre et son contexte.
Pour beaucoup de gens, lorsque j'interroge autour de moi (Car, là encore je le confesse, il m'arrive de questionner candidement certaines personnes en leur laissant entendre que j'ignore tout du sujet ou de prêcher le faux afin de savoir, peut-être pas le vrai, mais du moins, avoir accès à certains points de vue.), lorsque j'interroge, donc, on me répond souvent, pour faire simple, que l'Iliade, c'est le récit de la Guerre de Troie et que l'Odyssée, c'est le récit du retour mouvementé d'Ulysse après moult péripéties auprès de sa chère et tendre Pénélope.
Certes, il doit y avoir un peu de ça, mais je tiens tout de suite à vous retirer cette croyance du crâne car en fait, l'Iliade et l'Odyssée sont deux tronçons, et deux tronçons seulement, d'un récit mythique BEAUCOUP plus vaste qu'on désigne communément sous le nom de cycle Troyen.
J'en veux pour preuve que deux des éléments les plus croustillants de la fameuse Guerre de Troie ne sont pas abordés dans l'Iliade, à savoir, la mort d'Achille (et son fameux talon) et l'épisode encore plus fameux du Cheval de Troie. N'espérez donc pas les lire ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée.
La mort d'Achille était racontée dans un livre intitulé L'Éthiopide et qui est, pour l'essentiel, perdu. L'épisode du Cheval de Troie et la ruse légendaire d'Ulysse pour s'introduire auprès d'Hélène étaient eux racontés dans un autre livre communément intitulé, La Petite Iliade, lui aussi, pour l'essentiel, perdu. D'autres détails à propos du Cheval de Troie, du rapt de Cassandre par Ajax (le petit) et du sort réservé à la famille d'Hector étaient eux présentés dans le Sac de Troie, récit désormais perdu.
Ce n'est qu'alors qu'est abordé l'épineux problème du retour des héros grecs de cette guerre. Leur sort varie grandement et est conté dans Les Retours, lui aussi perdu. Par exemple, Néoptolème, Diomède ou Nestor rentrent sans encombre. Mais il n'en va pas de même pour Agamemnon, Ménélas ou Ulysse.
Et ce n'est qu'alors que le destin d'Ulysse est longuement raconté dans l'Odyssée. (Au passage, je rappelle que le nom grec d'Ulysse est Odousseus et le titre ne spécifie pas, en soi, qu'il s'agit d'un quelconque voyage, mais qu'il y est simplement question du sort d'Ulysse.) de même, il y avait une suite à l'Odyssée, qui s'intitulait La Télégonie.
En outre, je ne vous ai parlé que de ce qui suit l'Iliade, mais vous vous doutez qu'il y avait également bon nombre d'événements préalables puisque le texte qui nous occupe aujourd'hui ne débute qu'à l'issue de neuf années de guerre entre Grecs et Troyens, au moment précis où Achille envoie paître Agamemnon pour lui avoir soutiré le butin qui lui revenait de droit, après une énième conquête héroïque.
Sans vouloir excessivement rentrer dans les détails, peut-être connaissez-vous ce tableau célèbre de Rubens qui s'intitule le Jugement de Pâris. Il s'agit, en fait de l'élément déclencheur de tout ce pataquès, lui aussi, un livre perdu, intitulé les Chants Cypriens. Trois déesses de l'Olympe se crêpaient le chignon afin de savoir laquelle d'elles trois était définitivement la plus belle : Héra (femme et soeur de Zeus), Athéna (fille de Zeus) et Aphrodite (née de la mer). Afin de trancher cette douloureuse question, papa Zeus envoie les trois commères sur le mont Ida afin que le Troyen Pâris (qui doit avoir un avis autorisé sur la question) tranche le débat.
(Sachez seulement que la prise de bec entre les trois déesses était le fait d'Éris, déesse de la discorde, qui, très amère de n'avoir point été conviée aux noces de Pélée , le père d'Achille, envoya lors du banquet une pomme — dite plus tard, pomme de discorde — où il était inscrit " pour la plus belle ". Ceci pouvant expliquer cela.)
Pâris, qui aimerait bien qu'on lui aménage le coup avec Hélène, femme du Grec Ménélas, s'arrange avec Aphrodite en échange de l'amour d'Hélène. Sans sourciller, il désigne donc Aphrodite Miss Olympe, ce qui a le don de mettre en pétard Héra et Athéna, qui n'auront alors de cesse que de s'en prendre à Troie et qui tout pendant l'Iliade (Ilion est l'autre nom de la ville de Troie) vont soutenir les guerriers grecs et les exhorter à raser cette ville infâme capable de produire un individu susceptible de prétendre qu'elles n'étaient pas les plus belles.
Si bien que l'Iliade d'Homère ne conte finalement qu'un mince passage de toute cette rixe, situé entre le moment où les Grecs perdent leur meilleur champion, Achille, qui se retire du jeu pour cause de bouderie et le moment des funérailles d'Hector, frère de Pâris.
Pendant tout ce temps-là, Hector, un brave parmi les braves, soutenu par Apollon et Zeus en personne, va s'amuser à tailler du Grec en veux-tu en voilà, jusqu'au moment où Patrocle, le meilleur copain d'Achille va aller se mesurer à lui, perdre son combat et, du même coup, redonner à Achille l'envie de se battre à nouveau et d'inverser la vapeur.
Il faut encore sans doute dire un mot ou deux d'Homère même. On ne connaît à peu près rien de solide sur lui et il y a fort à parier que sous cette appellation se cachent en réalité plusieurs auteurs ayant remanié et amélioré le texte sur plusieurs décennies, voire, plusieurs siècles.
Voilà, tout ceci étant dit, ayant fait un très grossier résumé du contexte et des événements dont il était question, il reste le plus gros du travail, à savoir, tâcher d'interpréter ce texte. On sait d'une part qu'il s'agit de la mise par écrit de formes orales (probablement plusieurs formes orales concurrentes) préexistantes depuis sans doute des siècles. En ce sens, l'Iliade (d'ailleurs le cycle troyen dans son entier) est un récit mythique.
Qu'est-ce qu'un récit mythique ? C'est déjà une question difficile en soi et je vous renvoie à l'excellente description qu'en fait Jean-Claude Carrière, notamment sur le lien suivant :
http://www.dailymotion.com/video/xwzdh0_mythes-et-transmissions-1-3_webcam
Ainsi, dans un récit mythique, on nous dit d'où l'on vient, qui sont nos ancêtres, ce qu'ils ont fait pour accéder à l'indépendance et/ou au pouvoir en tant que peuple par rapport aux autres peuples ou bien comment ils se sont établis à tel ou tel endroit.
On y apprend aussi énormément de normes comportementales, c'est-à-dire du comment se comportaient ces devanciers héroïques et donc comment vous devez vous-mêmes vous comporter pour obtenir les mêmes succès et pérenniser votre peuple.
J'ai déjà dit ailleurs qu'à cet égard, l'Iliade est particulièrement intéressante car on y lit expressément que les dieux ne sont pas d'accord entre eux, de même que les héros (Achille et Agamemnon par exemple), ce qui est la marque d'un système social plutôt tolérant et égalitaire (toutes proportions gardées, bien évidemment, et ce en comparaison d'un système hiérarchique très fort et non contestable).
On y lit aussi que les dieux sont très partiaux, et qu'ils n'hésitent pas à tricher pour favoriser leur poulain au détriment d'un adversaire pourtant digne et aux qualités avérées. On y lit également qu'il s'agit d'une société très compétitive, au sens où l'on fait des compétitions pour tout et n'importe quoi, même sur le cadavre des défunts. C'est par exemple le cas au Chant XXIII lorsqu'Achille organise une sorte de proto-jeux olympiques pour savoir à qui il va distribuer du butin en remerciement de la participation aux funérailles de Patrocle. (Étonnante célébration du deuil, vous ne trouvez pas ?)
Il y aurait encore bon nombre de conjectures que l'on pourrait faire à propos de ce texte qui revêt à mes yeux un intérêt bien plus ethnologique que littéraire ou religieux, mais j'ai peur de m'étaler trop en longueur, au vu de la taille déjà indigeste de cette contribution.
Je vais donc privilégier seulement deux points dans mes interprétations : 1) pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ? 2) quid d'Ajax ?
1) Pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ?
Eh oui, a priori, pourquoi ces deux fragments sont-ils demeurés et ont toujours été célébrés avec beaucoup d'égards, notamment par la société grecque ultérieure et pas les autres morceaux de l'épopée ? On peut évidemment invoquer le rôle du hasard dans la perte de certains textes, et ce n'est pas à exclure. On peut également invoquer la qualité littéraire et poétique de ces deux textes par rapport aux autres morceaux du cycle troyen, même s'il est difficile d'en juger à présent que les autres textes sont perdus.
Mais on peut aussi invoquer d'autres facteurs, comme la validité de ces deux morceaux en qualité de récit mythique. L'Iliade raconte, en gros, l'histoire de l'union, de la réunion des cités-états du sud de ce que l'on nomme aujourd'hui la Grèce et qu'étant unies, ces cités-états, et le même peuple qu'elles constitue, régulièrement désigné par Homère comme étant les Achéens, c'est-à-dire un peuple issu et venu du continent européen, les Achéens, donc, qui ont mis la pâtée aux Troyens, c'est-à-dire une coalition majoritairement anatolienne (à l'exception de la Thrace).
À l'époque d'Homère et de ses devanciers, l'essentiel de ce qui se faisait de mieux en matière de civilisation provenait du Croissant Fertile, donc de l'est. L'ouest résonnait comme le territoire des bêtes sauvages à peine humaines. Dire qu'un peuple issu d'Europe puisse venir mettre en déroute sur leurs terres des asiatiques pouvait être un élément fédérateur puissant. (C'est d'ailleurs comme cela que Virgile le comprend car il désigne Agamemnon comme " le vainqueur de l'Asie " au livre XI de son Énéide.) Au demeurant, on sait que l'Iliade est plus ou moins contemporaine où suit de peu l'implantation définitive des Grecs sur les côtes de l'actuelle Turquie.
Et, plus particulièrement, si l'on se place dans le contexte des Guerres Médiques du début du Vème siècle avant J.-C. (entre autres, batailles de Marathon, Thermopyles et Salamine) qui opposaient la grande Asie de Darius et Xerxès aux cités grecques unifiées autour d'Athènes, on comprend de suite mieux que les auteurs du siècle de Périclès aient fait grand cas du récit mythique de l'Illiade, se soldant par une victoire des Grecs après dix années de combat. Tiens, tiens… ça me rappelle quelque chose…
De même, l'Odyssée est sans doute beaucoup plus porteuse de sens si l'on la met en parallèle avec le fait que les Grecs installent des comptoirs un peu partout en Méditerranée à cette époque. le héros grec malicieux qu'est Ulysse et qui vient à bout de toutes les bizarreries et étrangetés de ces mondes inconnus incarne alors à merveille le succès d'implantation des Grecs " à l'outre-mer ".
2) Il y a un personnage troublant dans l'Iliade qui est Ajax. Qui est Ajax et que symbolise-t-il ? Ajax ou les Ajax ? Homère s'ingénie à nous présenter les Ajax (l'un grand, l'autre petit, l'un fils de Télamon, l'autre fils d'Oïlée, ces deux géniteurs faisant partie des Argonautes). Deux personnages avec un même nom, très fréquemment agissant de concert. Qu'en penser ?
En ce qui me concerne, j'ai l'intime conviction que les Ajax sont un dédoublement (pour les besoins d'édification) d'un seul et même personnage. Un personnage doué d'une force surhumaine, qui ne connaît pas la peur, un combattant hors pair comme seul Achille peut souffrir la comparaison. Et pourtant, un personnage étonnamment peu célébré. Jamais il ne reçoit le secours des dieux alors que c'est pourtant lui qui tient la baraque quand Achille boude dans son coin. C'est lui qui ne fait pas grise mine d'être tiré au sort pour avoir le redoutable privilège de rencontrer Hector en combat singulier et c'est même lui qui a l'avantage dans ce combat avant son interruption.
En fait, Homère prend bien soin de retirer tout honneur (comme une victoire sur Hector) ou toute récompense prestigieuse (lors des mini-jeux olympiques d'Achille) aux deux Ajax. On sait que l'un (le fils de Télamon) fera tout un foin lorsqu'il apprendra qu'on ne lui remet pas les armes d'Achille lorsque celui-ci sera tué, deviendra à moitié fou de rage et finira par se suicider. On sait que l'autre (le fils d'Oïlée) commettra un viol sur Cassandre (bon ça, la société antique était prête à le lui pardonner) mais, ce qui est plus grave, c'est qu'il l'a fait dans le temple consacré à Athéna, montrant ainsi son mépris pour les dieux et ça c'est grave.
Dit autrement, Ajax (ou les Ajax, comme vous voulez), représente l'archétype du mercenaire, du gars qui ne combat pas pour un idéal mais uniquement pour le bénéfice qu'il peut retirer du combat. Ses qualités physiques et de combattant sont indéniables, mais ce sont ses motivations qui semblent être clairement fustigées dans ce récit mythique, comme l'atteste la chute finale, la tête en plein dans une bouse de vache, sous l'impulsion d'Athéna, alors même qu'à la régulière il avait devancé Ulysse à la course.
Il est grand temps pour moi de clore ce chapitre des interprétations et de vous inviter à y réfléchir par vous même si le coeur vous en dit, car ceci n'est qu'un misérable avis, c'est-à-dire, vraiment pas grand-chose.
Le vrai problème que j'ai avec la mythologie grecque, c'est que depuis toujours je ne parviens pas à retenir les noms ; je les mélange tous.
De ce handicap naît rapidement un ennui latent qui plombe ma lecture. La longue "Odyssée" d'Ulysse pour rentrer dans sa patrie et rejoindre (enfin) sa chère épouse Pénélope (qui pelotonne depuis vingt ans en essayant de ne pas se faire peloter par ses prétendants) n'échappe pas à cette règle, hélas.
Hormis le plaisir de découvrir les détails de certains épisodes que je connaissais jusque là trop superficiellement (le chant des sirènes, la nymphe Calypso, l'ensorcellement de Circé, la duperie du Cyclope, etc.), je n'ai pas particulièrement adhéré à cette épopée.
Pour ma part, je l'ai lu parce qu'on le tient légitimement pour un classique fondateur de notre civilisation et pour enrichir ma culture générale ; c'est d'ailleurs très utile, notamment pour visiter les expositions d'art avec un œil éclairé (en tout cas plus éclairé que celui de Cyclope une fois qu'Ulysse lui a fait son affaire).
Le seul hic, c'est que j'en ai déjà oublié les 3/4.
De ce handicap naît rapidement un ennui latent qui plombe ma lecture. La longue "Odyssée" d'Ulysse pour rentrer dans sa patrie et rejoindre (enfin) sa chère épouse Pénélope (qui pelotonne depuis vingt ans en essayant de ne pas se faire peloter par ses prétendants) n'échappe pas à cette règle, hélas.
Hormis le plaisir de découvrir les détails de certains épisodes que je connaissais jusque là trop superficiellement (le chant des sirènes, la nymphe Calypso, l'ensorcellement de Circé, la duperie du Cyclope, etc.), je n'ai pas particulièrement adhéré à cette épopée.
Pour ma part, je l'ai lu parce qu'on le tient légitimement pour un classique fondateur de notre civilisation et pour enrichir ma culture générale ; c'est d'ailleurs très utile, notamment pour visiter les expositions d'art avec un œil éclairé (en tout cas plus éclairé que celui de Cyclope une fois qu'Ulysse lui a fait son affaire).
Le seul hic, c'est que j'en ai déjà oublié les 3/4.
L'odyssée, en grec signifie littéralement "propre à Ulysse" et homére est l'auteur peut-être légendaire de ce texte. Ulysse est le roi d'Ithaque qui mit fin à la guerre de Troie grâce à sa ruse du cheval de Troie, dont le récit appartient aux12000 vers de l'odyssée.
Homére est un aède (poète et chantre dans la tradition orale) et L'odyssée est un ensemble de poèmes euphoniques qui bien que ordonnés ,constituent un cycle où la mémoire et l'improvisation durent jouer un grand rôle initialement.
L'auteur fût peut-être une convention et homérique renverrait donc à une confrérie d'aédes.
La langue pose cependant quelques certitudes. On est dans le nord de l'Ionie,environ au VIII ème siècle avant l'ère commune. A une époque où les cités étaient déjà des états mais gouvernés par des royautés (Basileus-rois) et des dynasties. Les navires, les palais, le bronze et des armes posent ce monde qui n'est pas le monde grec classique.
L'odyssée n'est pas un roman mais pourtant elle réclame de se soumettre à l'ordre du texte. Car sous sa forme actuelle il est un tout bien ordonné.
Je pense que cette lecture est gratifiante et accessible. Il y a de belles descriptions, de l'élégance, de belles couleurs et beaucoup d'affects variés.
Les dieux et surtout les déesses sont partout et elles composent la destinée d'Ulysse dont la ruse est le point fort.
Le propos du texte est de poser les facettes de la nature humaine et les ressorts du destin qui dépend des actes de chacun, des dieux qui ne sont jamais lointains et du hasard.
Le texte anime de nombreuses institutions et valeurs : l'honneur, le roi, le palais,les mentalités divines, les serments, les rituels variés, la guerre, l'hospitalité, la mere, l'épouse, la fille, la filiation, le mariage, la pudeur, le charme,le commerce, les sacrifices, les oracles,la divination et la mer qui est finalement aussi abordable et praticable que la terre.
Ce texte est un texte central pour le monde grec et on y apprend en Grèce pendant toute l'antiquité à lire et à vivre et il est largement acteur dans la vie courante des cités et des citoyens.
L'odyssée est aussi un récit politique , le roi tente et réussit à retrouver son royaume et à le reconquérir. Son fils Télémaque mène lui sa quête d'informations et il s'efforce de trouver des appuis et de solidifier sa légitimité dynastique, au foyer et hors de sa patrie.
Pénélope,source de légitimité également temporise pour donner une chance à la survie de la dynastie de son époux.
Les dieux sont très actifs et incarnés dans ce texte où les femmes et les déesses sont loin d'être confinées au gynécée.
C'est une constante du monde grec la femme de Socrate avait un fort caractère et l'assemblée des femmes de Aristophane dépeint des dames aussi épanouies que entreprenantes,sans parler des menades de Dyonisos qui sont redoutables presque autant que les Parques.
L'histoire des grecs a des racines partiellement minoennes et crétoises. La crête fut probablement une civilsation qui sans être une matriarchie était une société où la déesse ordonnait le monde .Elle trônait en majestée et elle se passait très bien des hommes car on ne lui connait pas de parédre.
Il semble que la vie et la mort ne se comprenaient où ne se "vivaient" que par elle.
Elle était la seule divinité connue en Crête et elle fut honorée dans un culte aux allures chtoniennes.
Sur la femme grecque des origines demandez à Arianne et à Thèsée, aux gymnastes feminins des tauromachies crétoises ,et à toutes les statuettes de cette déesse aux nombreux jupons ,les seins à l'air,les mains pleines de serpents dont les statuettes sont abondantes en Crête antérieurement au patriarcat myceniénien et à celui de leur successeurs archaïques et classiques et même byzantins . Cette déesse survécut en la personne de Perséphonne maîtresse des saisons et des récoltes et occupante à tour de rôle des mondes souterains et de la surface lors du cycle des saisons que le dieu de l'enfer a créé pour elle, pour lui donnerla responsabilité de créer la vie et de sortir des enfers sous-terrains une partie de l'année.
Enfin pour conclure il faut savoir que ces poèmes étaient destinés à être presque chantés ou à être récités, accompagnés par la harpe.
Le poème est coincé entre ciel et mers. Entre bleu et bleu donc mais le bleu n'existe pas en grec le même mot designe le bleu, le noir et le très sombre.
Homére est un aède (poète et chantre dans la tradition orale) et L'odyssée est un ensemble de poèmes euphoniques qui bien que ordonnés ,constituent un cycle où la mémoire et l'improvisation durent jouer un grand rôle initialement.
L'auteur fût peut-être une convention et homérique renverrait donc à une confrérie d'aédes.
La langue pose cependant quelques certitudes. On est dans le nord de l'Ionie,environ au VIII ème siècle avant l'ère commune. A une époque où les cités étaient déjà des états mais gouvernés par des royautés (Basileus-rois) et des dynasties. Les navires, les palais, le bronze et des armes posent ce monde qui n'est pas le monde grec classique.
L'odyssée n'est pas un roman mais pourtant elle réclame de se soumettre à l'ordre du texte. Car sous sa forme actuelle il est un tout bien ordonné.
Je pense que cette lecture est gratifiante et accessible. Il y a de belles descriptions, de l'élégance, de belles couleurs et beaucoup d'affects variés.
Les dieux et surtout les déesses sont partout et elles composent la destinée d'Ulysse dont la ruse est le point fort.
Le propos du texte est de poser les facettes de la nature humaine et les ressorts du destin qui dépend des actes de chacun, des dieux qui ne sont jamais lointains et du hasard.
Le texte anime de nombreuses institutions et valeurs : l'honneur, le roi, le palais,les mentalités divines, les serments, les rituels variés, la guerre, l'hospitalité, la mere, l'épouse, la fille, la filiation, le mariage, la pudeur, le charme,le commerce, les sacrifices, les oracles,la divination et la mer qui est finalement aussi abordable et praticable que la terre.
Ce texte est un texte central pour le monde grec et on y apprend en Grèce pendant toute l'antiquité à lire et à vivre et il est largement acteur dans la vie courante des cités et des citoyens.
L'odyssée est aussi un récit politique , le roi tente et réussit à retrouver son royaume et à le reconquérir. Son fils Télémaque mène lui sa quête d'informations et il s'efforce de trouver des appuis et de solidifier sa légitimité dynastique, au foyer et hors de sa patrie.
Pénélope,source de légitimité également temporise pour donner une chance à la survie de la dynastie de son époux.
Les dieux sont très actifs et incarnés dans ce texte où les femmes et les déesses sont loin d'être confinées au gynécée.
C'est une constante du monde grec la femme de Socrate avait un fort caractère et l'assemblée des femmes de Aristophane dépeint des dames aussi épanouies que entreprenantes,sans parler des menades de Dyonisos qui sont redoutables presque autant que les Parques.
L'histoire des grecs a des racines partiellement minoennes et crétoises. La crête fut probablement une civilsation qui sans être une matriarchie était une société où la déesse ordonnait le monde .Elle trônait en majestée et elle se passait très bien des hommes car on ne lui connait pas de parédre.
Il semble que la vie et la mort ne se comprenaient où ne se "vivaient" que par elle.
Elle était la seule divinité connue en Crête et elle fut honorée dans un culte aux allures chtoniennes.
Sur la femme grecque des origines demandez à Arianne et à Thèsée, aux gymnastes feminins des tauromachies crétoises ,et à toutes les statuettes de cette déesse aux nombreux jupons ,les seins à l'air,les mains pleines de serpents dont les statuettes sont abondantes en Crête antérieurement au patriarcat myceniénien et à celui de leur successeurs archaïques et classiques et même byzantins . Cette déesse survécut en la personne de Perséphonne maîtresse des saisons et des récoltes et occupante à tour de rôle des mondes souterains et de la surface lors du cycle des saisons que le dieu de l'enfer a créé pour elle, pour lui donnerla responsabilité de créer la vie et de sortir des enfers sous-terrains une partie de l'année.
Enfin pour conclure il faut savoir que ces poèmes étaient destinés à être presque chantés ou à être récités, accompagnés par la harpe.
Le poème est coincé entre ciel et mers. Entre bleu et bleu donc mais le bleu n'existe pas en grec le même mot designe le bleu, le noir et le très sombre.
Vous êtes arrivés au troisième quart de l'Iliade (certains parlent même du tome Troie), plus rien ne peut vous arrêter dans votre cheminement dans l'œuvre d'Homère, ni dieux ni armées ni les rayons ardents de l'astre d'Apollon… Rien ! Vous irez au bout ; quitte à revêtir le bouclier d'Achille pour vous protéger des méchants qui pourraient vouloir vous en empêcher…
Vous en êtes même précisément arrivés au point où Poseidon, mécontent de la tournure que son frangin Zeus imprime aux choses, décide de s'engager clairement auprès des Grecs, qui, du coup, reprennent espoir et infligent de lourdes pertes aux Troyens. (Bon évidemment, ce sont les Grecs qui racontent l'histoire, donc les pertes troyennes sont toujours lourdes, par essence.)
Cependant, même avec le soutien de Poseidon, les Grecs s'aperçoivent que les Troyens ne sont plus très loin de leurs bateaux et beaucoup d'entre eux sont blessés ou n'ont plus la force de combattre. C'est alors qu'Héra, la femme et sœur de Zeus (oui, je sais, c'est toujours un peu bizarre mais les dieux aimaient faire ça en famille), décide de détourner l'attention de son divin mari et frère en lui proposant un petit after puis en l'endormant.
Dès lors, Poseidon ne se sent plus de joie, ouvre un large bec et laisse tomber… euh…, j'ai dû croiser quelques informations, je crois… reprenons : Poseidon se dépêche d'aller porter de l'aide aux Argiens (c'est-à-dire les Grecs mais Homère se plait à leur donner 36 noms différents). Hector, le chef troyen est blessé par Ajax, le fils de Telamon (parce que sur le champ de bataille comme à la SNCF, un Ajax peut en cacher un autre). Et donc, après quelques vibrantes inquiétudes, l'espoir est repassé chez les Grecs.
Le problème de tout cela, c'est que Zeus finit par se réveiller et, comme tout souverain de l'Olympe qui se respecte, il n'est pas toujours bon à prendre avec des pincettes au saut du lit. Il est comme qui dirait furieux et ordonne à son frère Poseidon d'arrêter de soutenir les Argiens. Lui-même intime l'ordre à son fils Apollon d'aller relever Hector.
Si bien que les Troyens, poussés par Apollon, parviennent à enfoncer le mur et les défenses grecques et arrivent droit aux nefs avec la ferme intension d'y mettre le feu. La déroute semble proche pour les Grecs. Voyant cela, Patrocle, le plus proche ami d'Achille, demande à ce dernier qui est toujours en train de bouder s'il peut prendre ses armes pour repousser les Troyens.
Achille accepte et le laisse mener ses hommes au combat mais il précise à Patrocle que celui-ci ne doit pas poursuivre les Troyens une fois repoussés. Écoutez bien, soyez attentifs, c'est un moment important de l'histoire et comme j'ai senti que vous commenciez à décrocher, j'aime autant vous laisser finir vous-même la lecture de ce troisième tome de l'Iliade.
En outre, le mieux sera toujours que vous vous fassiez vous-même vos avis, car, comme Troie déchue, celui-ci n'est qu'une Colline de Cendres (en anglais on dit Ash Hill, ceci pouvant expliquer cela), c'est-à-dire, pas grand-chose.
Vous en êtes même précisément arrivés au point où Poseidon, mécontent de la tournure que son frangin Zeus imprime aux choses, décide de s'engager clairement auprès des Grecs, qui, du coup, reprennent espoir et infligent de lourdes pertes aux Troyens. (Bon évidemment, ce sont les Grecs qui racontent l'histoire, donc les pertes troyennes sont toujours lourdes, par essence.)
Cependant, même avec le soutien de Poseidon, les Grecs s'aperçoivent que les Troyens ne sont plus très loin de leurs bateaux et beaucoup d'entre eux sont blessés ou n'ont plus la force de combattre. C'est alors qu'Héra, la femme et sœur de Zeus (oui, je sais, c'est toujours un peu bizarre mais les dieux aimaient faire ça en famille), décide de détourner l'attention de son divin mari et frère en lui proposant un petit after puis en l'endormant.
Dès lors, Poseidon ne se sent plus de joie, ouvre un large bec et laisse tomber… euh…, j'ai dû croiser quelques informations, je crois… reprenons : Poseidon se dépêche d'aller porter de l'aide aux Argiens (c'est-à-dire les Grecs mais Homère se plait à leur donner 36 noms différents). Hector, le chef troyen est blessé par Ajax, le fils de Telamon (parce que sur le champ de bataille comme à la SNCF, un Ajax peut en cacher un autre). Et donc, après quelques vibrantes inquiétudes, l'espoir est repassé chez les Grecs.
Le problème de tout cela, c'est que Zeus finit par se réveiller et, comme tout souverain de l'Olympe qui se respecte, il n'est pas toujours bon à prendre avec des pincettes au saut du lit. Il est comme qui dirait furieux et ordonne à son frère Poseidon d'arrêter de soutenir les Argiens. Lui-même intime l'ordre à son fils Apollon d'aller relever Hector.
Si bien que les Troyens, poussés par Apollon, parviennent à enfoncer le mur et les défenses grecques et arrivent droit aux nefs avec la ferme intension d'y mettre le feu. La déroute semble proche pour les Grecs. Voyant cela, Patrocle, le plus proche ami d'Achille, demande à ce dernier qui est toujours en train de bouder s'il peut prendre ses armes pour repousser les Troyens.
Achille accepte et le laisse mener ses hommes au combat mais il précise à Patrocle que celui-ci ne doit pas poursuivre les Troyens une fois repoussés. Écoutez bien, soyez attentifs, c'est un moment important de l'histoire et comme j'ai senti que vous commenciez à décrocher, j'aime autant vous laisser finir vous-même la lecture de ce troisième tome de l'Iliade.
En outre, le mieux sera toujours que vous vous fassiez vous-même vos avis, car, comme Troie déchue, celui-ci n'est qu'une Colline de Cendres (en anglais on dit Ash Hill, ceci pouvant expliquer cela), c'est-à-dire, pas grand-chose.
Vous êtes arrivés au dernier quart de l'Iliade ; il est grand temps pour vous de recevoir un petit coup de main d'Achille. Car depuis le début de l'épopée, vous en entendez parler mais vous ne le voyez pas à l'œuvre car il est fâché contre Agamemnon, le chef suprême des rois grecs fédérés contre Troie.
Ce chant XIX s'ouvre donc sur une réconciliation d'Achille et d'Agamemnon après la mort que l'on sait (dans les tomes précédents, ne comptez pas sur moi pour vous en dire davantage). Achille va enfin reprendre part aux combats et cette nouvelle galvanise le cœur des Grecs qui en avaient bien besoin, maltraités qu'il avaient étés par les coups féroces d'Hector, le chef de guerre des Troyens, fils du vieux roi Priam. Ce dernier observe les combats depuis les murs d'enceinte de sa ville.
Et c'est un Achille furieux qui s'engage dans la bataille : Attila, à côté, ce n'était pas grand-chose, tellement ça ferraille sec, tellement sa pique va loin et tellement les têtes troyennes tombent sous ses assauts. Zeus a décidé, maintenant que son petit protégé d'Achille est dans le coup, de ne plus prendre ouvertement parti pour les Troyens comme il le faisait auparavant. Il laisse même le choix à chaque divinité concernée de miser sur son poulain afin de lui assurer la vie sauve.
Bref, gros carnage signé Achille, tous les Troyens en déroute et qui courent se réfugier derrière les murs de protection d'Ilion (c'est un autre nom pour Troie et c'est, au demeurant, ce qui donne son titre à l'épopée). Mais c'est Hector qu'il veut accrocher à son tableau de chasse.
On a beau s'appeler Hector et avoir trucidé du Grec comme pas un, lorsqu'Achille se présente devant vous, ça vous fait un petit quelque chose tout de même et il n'en mène plus bien large le malheureux Hector. Je ne veux surtout pas vous retirer le plaisir de lire l'issue du combat qui s'annonce…
En outre, si le (ou les) rédacteur(s) de l'Iliade au fil des âges (baptisé(s) Homère pour faire simple) ont magnifié la figure d'Achille en cette fin d'ouvrage, ils se sont attachés à ternir volontairement celle de deux autres grands combattants héroïques grecs : les deux Ajax.
À ce titre, je vous recommande tout particulièrement le chant XXIII où l'on assiste à une sorte de banquet funéraire où tous les grands chefs grecs sont conviés par Achille pour recevoir le butin de qui vous savez (voir les tomes précédents) sous une forme quelque peu insolite de nos jours : des genres d'épreuves de jeux olympiques.
Et c'est au cours de ces épreuves que les deux Ajax sont mis minables par Homère. Ceci ne colle pas du tout avec ce qu'on a vu durant toute l'épopée. Alors il doit bien y avoir une raison. J'en suis venue à penser qu'en fait, le personnage même d'Ajax a très probablement été lui-même dédoublé, un peu comme une sorte de docteur Jekyll et Mister Hyde : Ajax le grand, fils de Telamon serait plutôt le docteur Jekyll et Ajax le petit, fils d'Oïlée serait une manière de Mister Hyde.
On sait que ces récits mythiques de l'Antiquité avaient aussi une valeur d'édification pour le peuple. Ils présentaient en termes clairs et abordables d'où l'on venait et comment les ancêtres s'étaient comportés et donc, comment il était bon de se comporter soi-même pour être un digne représentant de ce peuple.
Ajax, ou, pour reprendre le portrait bicéphale d'Homère, LES Ajax, représentent quelque chose qu'on pourrait de nos jours dénommer comme étant des mercenaires ou des condottieres dans l'Italie de la fin du Moyen Âge. Des rois bouffis d'orgueil et tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils en oubliaient la déférence aux dieux.
Une grande partie du cycle troyen dans lequel s'inscrivait l'Iliade d'abord, puis l'Odyssée, ensuite est désormais perdu (en gros, l'Iliade et l'Odyssée représentent deux pièces intercalées d'un puzzle qui devait en contenir au moins sept). C'est donc aux travers des tragédies grecques postérieures qu'on sait à peu près à quoi s'en tenir avec les Ajax.
Tout d'abord dans la pièce éponyme de Sophocle où l'on voit que le grand Ajax (le fils de Telamon), tellement orgueilleux et tellement égocentrique devient fou quand il apprend que ce n'est pas lui mais Ulysse qui hérite des armes divines d'Achille et il est alors prêt à se retourner contre des Grecs afin de les tuer tous.
C'est ensuite dans les tragédies d'Euripide qu'on apprend que l'autre Ajax, le fils d'Oïlée, n'a pas hésité à violer Cassandre, la fille de Priam, dans un temple dédié à Athéna. (Bon, petite précision, ce qui apparaissait comme scandaleux aux yeux des Grecs d'alors, ce n'était pas le viol en lui-même, somme toute assez banal, mais le fait qu'il se soit produit dans une enceinte sacrée : ça c'était très grave !)
Orgueil démesuré et impiété, comme si ces épisodes représentaient certains des " péchés capitaux " du monde et de la culture hellénistiques. Mais de ceci, ce sera à vous d'en juger par vous-même car cet avis, à lui tout seul, ne représente pas grand-chose.
Ce chant XIX s'ouvre donc sur une réconciliation d'Achille et d'Agamemnon après la mort que l'on sait (dans les tomes précédents, ne comptez pas sur moi pour vous en dire davantage). Achille va enfin reprendre part aux combats et cette nouvelle galvanise le cœur des Grecs qui en avaient bien besoin, maltraités qu'il avaient étés par les coups féroces d'Hector, le chef de guerre des Troyens, fils du vieux roi Priam. Ce dernier observe les combats depuis les murs d'enceinte de sa ville.
Et c'est un Achille furieux qui s'engage dans la bataille : Attila, à côté, ce n'était pas grand-chose, tellement ça ferraille sec, tellement sa pique va loin et tellement les têtes troyennes tombent sous ses assauts. Zeus a décidé, maintenant que son petit protégé d'Achille est dans le coup, de ne plus prendre ouvertement parti pour les Troyens comme il le faisait auparavant. Il laisse même le choix à chaque divinité concernée de miser sur son poulain afin de lui assurer la vie sauve.
Bref, gros carnage signé Achille, tous les Troyens en déroute et qui courent se réfugier derrière les murs de protection d'Ilion (c'est un autre nom pour Troie et c'est, au demeurant, ce qui donne son titre à l'épopée). Mais c'est Hector qu'il veut accrocher à son tableau de chasse.
On a beau s'appeler Hector et avoir trucidé du Grec comme pas un, lorsqu'Achille se présente devant vous, ça vous fait un petit quelque chose tout de même et il n'en mène plus bien large le malheureux Hector. Je ne veux surtout pas vous retirer le plaisir de lire l'issue du combat qui s'annonce…
En outre, si le (ou les) rédacteur(s) de l'Iliade au fil des âges (baptisé(s) Homère pour faire simple) ont magnifié la figure d'Achille en cette fin d'ouvrage, ils se sont attachés à ternir volontairement celle de deux autres grands combattants héroïques grecs : les deux Ajax.
À ce titre, je vous recommande tout particulièrement le chant XXIII où l'on assiste à une sorte de banquet funéraire où tous les grands chefs grecs sont conviés par Achille pour recevoir le butin de qui vous savez (voir les tomes précédents) sous une forme quelque peu insolite de nos jours : des genres d'épreuves de jeux olympiques.
Et c'est au cours de ces épreuves que les deux Ajax sont mis minables par Homère. Ceci ne colle pas du tout avec ce qu'on a vu durant toute l'épopée. Alors il doit bien y avoir une raison. J'en suis venue à penser qu'en fait, le personnage même d'Ajax a très probablement été lui-même dédoublé, un peu comme une sorte de docteur Jekyll et Mister Hyde : Ajax le grand, fils de Telamon serait plutôt le docteur Jekyll et Ajax le petit, fils d'Oïlée serait une manière de Mister Hyde.
On sait que ces récits mythiques de l'Antiquité avaient aussi une valeur d'édification pour le peuple. Ils présentaient en termes clairs et abordables d'où l'on venait et comment les ancêtres s'étaient comportés et donc, comment il était bon de se comporter soi-même pour être un digne représentant de ce peuple.
Ajax, ou, pour reprendre le portrait bicéphale d'Homère, LES Ajax, représentent quelque chose qu'on pourrait de nos jours dénommer comme étant des mercenaires ou des condottieres dans l'Italie de la fin du Moyen Âge. Des rois bouffis d'orgueil et tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils en oubliaient la déférence aux dieux.
Une grande partie du cycle troyen dans lequel s'inscrivait l'Iliade d'abord, puis l'Odyssée, ensuite est désormais perdu (en gros, l'Iliade et l'Odyssée représentent deux pièces intercalées d'un puzzle qui devait en contenir au moins sept). C'est donc aux travers des tragédies grecques postérieures qu'on sait à peu près à quoi s'en tenir avec les Ajax.
Tout d'abord dans la pièce éponyme de Sophocle où l'on voit que le grand Ajax (le fils de Telamon), tellement orgueilleux et tellement égocentrique devient fou quand il apprend que ce n'est pas lui mais Ulysse qui hérite des armes divines d'Achille et il est alors prêt à se retourner contre des Grecs afin de les tuer tous.
C'est ensuite dans les tragédies d'Euripide qu'on apprend que l'autre Ajax, le fils d'Oïlée, n'a pas hésité à violer Cassandre, la fille de Priam, dans un temple dédié à Athéna. (Bon, petite précision, ce qui apparaissait comme scandaleux aux yeux des Grecs d'alors, ce n'était pas le viol en lui-même, somme toute assez banal, mais le fait qu'il se soit produit dans une enceinte sacrée : ça c'était très grave !)
Orgueil démesuré et impiété, comme si ces épisodes représentaient certains des " péchés capitaux " du monde et de la culture hellénistiques. Mais de ceci, ce sera à vous d'en juger par vous-même car cet avis, à lui tout seul, ne représente pas grand-chose.
Un poème guerrier et une source de vie .
Le texte est fixé par écrit au VIe siècle avant l'ère commune à Athènes . Il se réfère à des périodes plus anciennes encore mais très confusément cependant , du point de vue de sa compréhension historique . Il fut composé à partir du IXe siècle .
C'est un texte connus de tous les grecs , dont beaucoup pouvaient en réciter de très larges sections . On apprenait à lire avec , on apprenait à le réciter et à y chercher du sens édifiant , on se divertissait avec et on y apprenait aussi la métrique et plus généralement la poétique .
Si un jour vous êtes en Grèce , offrez-vous le plaisir d'écouter une lecture « iliadique « , de préférence dans un cadre enchanteur tel que le théâtre d'Eleusis ou encore Sur le cap Sounion , en Attique , sur fond du temple de Poséidon , localisé sur le site de ce cap rocailleux et battu par les vents .
Je dis cela parce que c'est beau , la langue est musicale , très riche en voyelles . Il y a une réelle utilisation poétique de l'accent tonique ( antépénultième syllabe ) , pour apporter du sens , et ce n'est donc pas une simple question de rythme ou de rime ou encore d'euphonie qui préside à la composition .
Le sens du texte est construit et appuyé par et avec les sons . A la récitation on perçoit facilement l'importance fondamentale des fins de phrases , avec toujours une attention spéciale qui est à accorder aux adjectifs qualificatifs et aux épithètes , dont les portées ( musicalité et signification ) s'additionnent , alors qu'elles se déposent en strates cumulatives et que l'effet en devient entêtant .
Je dis cela pour insister sur l'oralité fondamentale de ce texte qui est fondamentalement composé pour être entendu plus que pour être lu , l'Iliade se repartie donc en chants et non pas en chapitres .
Le poème est très cohérent , sa langue est ionienne , éolienne aussi , une langue plutôt archaïsante qui est le reflet donc des dialectes parmi ceux des plus anciens habitants grecs du pays . L'Iliade sous la forme que nous connaissons est le reflet des structures sociales et morales des âges sombres helléniques et ce ne sont pas forcément ceux de la période classique qui est la plus emblématique de la Grèce dans la conscience collective contemporaine .
Vous y trouverez , des armes en bronze , des chars , des pentécontères , des duels héroïques , des rois ... et j'en passe ...
On aurait tort de penser que l'Iliade est un simple poème ou une élégante distraction . L'Iliade est quasiment un texte sacré , pas au sens où ce texte serait saint . Mais il est conçu comme un enseignement édifiant totalisant , où l'on est susceptible de découvrir et de comprendre le sens de la vie . C'est un texte sur lequel on débattait , où on s'interrogeait , finalement on s'en nourrissait .
Les dieux y agissent constamment de diverses façons , les héros ne se comportent pas toujours comme tel , et les rois et les dieux non plus .
On y est dans un lointain passé dans lequel l'identité hellénique est déjà formée et ou finalement le grec des époques ultérieures , se reconnaît dans ses ancêtres héroïques , alors qu'ils sont les jeux du destin , du hasard arbitraire et des dieux , tout comme lui .
L'auditeur de l'Iliade y verra tour à tour des symboles , de l'histoire hellénique , différentes variétés dialectales et au travers du langage , il y trouvera de l'identité et une définition personnelle . Il y trouvera la somme de toutes les choses qui font qu'il est lui-même .
Il savourera la poétique des sons et du sens , il analysera les agissements et les attributs des divinités et de leurs symboliques existentielles . Bref il y trouvera des arguments pour comprendre son quotidien , pour le sublimer . Ce travail sur son être se fera selon des processus qui vont de la simple identification « romanesque « , à la quasi exégèse sacrée ou encore sur la base du mysticisme ou bien simplement de l'exemple .
C'est ce qui fait de l'Iliade un texte très difficile à lire , on y a très souvent l'impression que quelque chose nous échappes . On se demande quel est le sens de tel passage , et souvent quant on trouve un passage inutile , c'est que le sens hellénique nous échappes .
Cependant la plus grande partie du texte est accessible , on est dans une trame narrative ou le plus souvent il y a un sens obvie , sens immédiat qui est trivial , intelligible et simple , une sorte de premier niveau de lecture quasi « romanesque « , ou bien historique , où il est aisé de percevoir des enseignements et ou on est susceptible d'engranger des connaissances historiques et de rejoindre à cette occasion de grands hommes dans l'intimité .
La profusion des détails , les noms et les mots qui impliquent de comprendre leurs sens et leur portée , pour comprendre le ou les sens de beaucoup de passages , complique la lecture . Un texte difficile qui reste assez agréable à lire , à cause d'un vocabulaire imagé et d'une approche très scénique à forte intensité généralement , et ce , qu'il s'agisse de ruse , de destinée , de sentiments humains ou divins , d'évènements , de gestes , d'humour ...
En lisant l'Iliade , en acceptant l'idée pendant la lecture que c'est un texte destiné à nous enseigner et à nous nourrir philosophiquement , c'est finalement à l'imprégnation par l'âme hellénique que confine la lecture . C'est une vrai rencontre avec l'âme grecque et avec la vision hellénique du monde ainsi que avec les règles qui le régisse .
On aurait tort en tant que lecteur contemporain , de croire prétentieusement que c'est un texte naïf ou enfantin car c'est un texte de vie , à la portée quasi mystique , si on se réfère au caractère entêtant du phrasé du texte et si on se réfère à sa composition où les ressentis se valident et s'épaississent par couches cumulatives de dépôts successifs .
Le texte est fixé par écrit au VIe siècle avant l'ère commune à Athènes . Il se réfère à des périodes plus anciennes encore mais très confusément cependant , du point de vue de sa compréhension historique . Il fut composé à partir du IXe siècle .
C'est un texte connus de tous les grecs , dont beaucoup pouvaient en réciter de très larges sections . On apprenait à lire avec , on apprenait à le réciter et à y chercher du sens édifiant , on se divertissait avec et on y apprenait aussi la métrique et plus généralement la poétique .
Si un jour vous êtes en Grèce , offrez-vous le plaisir d'écouter une lecture « iliadique « , de préférence dans un cadre enchanteur tel que le théâtre d'Eleusis ou encore Sur le cap Sounion , en Attique , sur fond du temple de Poséidon , localisé sur le site de ce cap rocailleux et battu par les vents .
Je dis cela parce que c'est beau , la langue est musicale , très riche en voyelles . Il y a une réelle utilisation poétique de l'accent tonique ( antépénultième syllabe ) , pour apporter du sens , et ce n'est donc pas une simple question de rythme ou de rime ou encore d'euphonie qui préside à la composition .
Le sens du texte est construit et appuyé par et avec les sons . A la récitation on perçoit facilement l'importance fondamentale des fins de phrases , avec toujours une attention spéciale qui est à accorder aux adjectifs qualificatifs et aux épithètes , dont les portées ( musicalité et signification ) s'additionnent , alors qu'elles se déposent en strates cumulatives et que l'effet en devient entêtant .
Je dis cela pour insister sur l'oralité fondamentale de ce texte qui est fondamentalement composé pour être entendu plus que pour être lu , l'Iliade se repartie donc en chants et non pas en chapitres .
Le poème est très cohérent , sa langue est ionienne , éolienne aussi , une langue plutôt archaïsante qui est le reflet donc des dialectes parmi ceux des plus anciens habitants grecs du pays . L'Iliade sous la forme que nous connaissons est le reflet des structures sociales et morales des âges sombres helléniques et ce ne sont pas forcément ceux de la période classique qui est la plus emblématique de la Grèce dans la conscience collective contemporaine .
Vous y trouverez , des armes en bronze , des chars , des pentécontères , des duels héroïques , des rois ... et j'en passe ...
On aurait tort de penser que l'Iliade est un simple poème ou une élégante distraction . L'Iliade est quasiment un texte sacré , pas au sens où ce texte serait saint . Mais il est conçu comme un enseignement édifiant totalisant , où l'on est susceptible de découvrir et de comprendre le sens de la vie . C'est un texte sur lequel on débattait , où on s'interrogeait , finalement on s'en nourrissait .
Les dieux y agissent constamment de diverses façons , les héros ne se comportent pas toujours comme tel , et les rois et les dieux non plus .
On y est dans un lointain passé dans lequel l'identité hellénique est déjà formée et ou finalement le grec des époques ultérieures , se reconnaît dans ses ancêtres héroïques , alors qu'ils sont les jeux du destin , du hasard arbitraire et des dieux , tout comme lui .
L'auditeur de l'Iliade y verra tour à tour des symboles , de l'histoire hellénique , différentes variétés dialectales et au travers du langage , il y trouvera de l'identité et une définition personnelle . Il y trouvera la somme de toutes les choses qui font qu'il est lui-même .
Il savourera la poétique des sons et du sens , il analysera les agissements et les attributs des divinités et de leurs symboliques existentielles . Bref il y trouvera des arguments pour comprendre son quotidien , pour le sublimer . Ce travail sur son être se fera selon des processus qui vont de la simple identification « romanesque « , à la quasi exégèse sacrée ou encore sur la base du mysticisme ou bien simplement de l'exemple .
C'est ce qui fait de l'Iliade un texte très difficile à lire , on y a très souvent l'impression que quelque chose nous échappes . On se demande quel est le sens de tel passage , et souvent quant on trouve un passage inutile , c'est que le sens hellénique nous échappes .
Cependant la plus grande partie du texte est accessible , on est dans une trame narrative ou le plus souvent il y a un sens obvie , sens immédiat qui est trivial , intelligible et simple , une sorte de premier niveau de lecture quasi « romanesque « , ou bien historique , où il est aisé de percevoir des enseignements et ou on est susceptible d'engranger des connaissances historiques et de rejoindre à cette occasion de grands hommes dans l'intimité .
La profusion des détails , les noms et les mots qui impliquent de comprendre leurs sens et leur portée , pour comprendre le ou les sens de beaucoup de passages , complique la lecture . Un texte difficile qui reste assez agréable à lire , à cause d'un vocabulaire imagé et d'une approche très scénique à forte intensité généralement , et ce , qu'il s'agisse de ruse , de destinée , de sentiments humains ou divins , d'évènements , de gestes , d'humour ...
En lisant l'Iliade , en acceptant l'idée pendant la lecture que c'est un texte destiné à nous enseigner et à nous nourrir philosophiquement , c'est finalement à l'imprégnation par l'âme hellénique que confine la lecture . C'est une vrai rencontre avec l'âme grecque et avec la vision hellénique du monde ainsi que avec les règles qui le régisse .
On aurait tort en tant que lecteur contemporain , de croire prétentieusement que c'est un texte naïf ou enfantin car c'est un texte de vie , à la portée quasi mystique , si on se réfère au caractère entêtant du phrasé du texte et si on se réfère à sa composition où les ressentis se valident et s'épaississent par couches cumulatives de dépôts successifs .
Wagner, vous connaissez ? TA-TAM, TA-TA-TAM ! TA-TAM, TA-TA-TAM ! TAM ! La chevauchée des vaches-qui-rit… ou le caprice des dieux, un des deux. Quoi qu'il en soit, les dieux se montrent assez capricieux et nous mettent du Wagner plein les oreilles dès le début de ce troisième tome de l'édition bilingue de l'Iliade.
Patrocle a juste eu le temps de signer de son sang : « Homère m'a tueR____ » Et Hector, non content de ses exploits et d'avoir Zeus avec lui en profite pour dérober les armes de Patrocle, qui sont en fait celles d'Achille, forgées rien que pour lui par Héphaïstos en personne.
Alors ça ferraille à tout va, on lutte à mort pour garder le cadavre de Patrocle, les Ajax font le ménage, mais la saleté résiste. C'est une mêlée sauvage à Troie contre Huns. Les Grecs plient mais ne rompent pas. N'empêche qu'on envoie discrètement quelqu'un prévenir Achille de la mort de Patrocle. Si seulement ça pouvait le décider…
Soudain… un grand cri… un tonnerre sorti d'une bouche… Un dieu ? non, pas tout à fait, mais c'est tout comme. C'est la douleur d'Achille qu'on vient d'entendre. Patrocle, c'était son ami, son frère, pour ainsi dire son sang. Tiens ? mais il pleut !
Non, ce sont les larmes d'Achille… grosses comme des fleuves… Il est effondré, Achille. Il a les yeux rouges et la bave à la bouche et ce tremblement dans ses mains… c'est la colère d'Achille, ce sont ses phalanges qui crient vengeance…, mais que peut faire Achille ? N'empêche qu'à l'écoute de ce hurlement, notre ami Hector a eu comme un frisson dans le dos…
Pas plier, les gars, pas plier. Ce sont les dieux qui décident… aujourd'hui on gagne, demain on perd…, après demain ? Allez savoir… Le destin, ça s'appelle. On va y mettre tout notre cœur et le destin choisira… Des braves vont mourir, des braves vont rester… mais je ne vous en dirai pas plus.
La clôture en beauté de l'Iliade, une dernière belle empoignade, des apports culturels à foison et… un petit regret : l'envie de connaître la suite qu'on ne connaîtra jamais puisqu'elle est perdue à tout jamais, engloutie dans le grand intestin de l'histoire des œuvres disparues… Mais ceci n'est bien sûr qu'un vil avis, la toute petite chose qui sort du grand intestin de l'histoire des œuvres disparues, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Patrocle a juste eu le temps de signer de son sang : « Homère m'a tueR____ » Et Hector, non content de ses exploits et d'avoir Zeus avec lui en profite pour dérober les armes de Patrocle, qui sont en fait celles d'Achille, forgées rien que pour lui par Héphaïstos en personne.
Alors ça ferraille à tout va, on lutte à mort pour garder le cadavre de Patrocle, les Ajax font le ménage, mais la saleté résiste. C'est une mêlée sauvage à Troie contre Huns. Les Grecs plient mais ne rompent pas. N'empêche qu'on envoie discrètement quelqu'un prévenir Achille de la mort de Patrocle. Si seulement ça pouvait le décider…
Soudain… un grand cri… un tonnerre sorti d'une bouche… Un dieu ? non, pas tout à fait, mais c'est tout comme. C'est la douleur d'Achille qu'on vient d'entendre. Patrocle, c'était son ami, son frère, pour ainsi dire son sang. Tiens ? mais il pleut !
Non, ce sont les larmes d'Achille… grosses comme des fleuves… Il est effondré, Achille. Il a les yeux rouges et la bave à la bouche et ce tremblement dans ses mains… c'est la colère d'Achille, ce sont ses phalanges qui crient vengeance…, mais que peut faire Achille ? N'empêche qu'à l'écoute de ce hurlement, notre ami Hector a eu comme un frisson dans le dos…
Pas plier, les gars, pas plier. Ce sont les dieux qui décident… aujourd'hui on gagne, demain on perd…, après demain ? Allez savoir… Le destin, ça s'appelle. On va y mettre tout notre cœur et le destin choisira… Des braves vont mourir, des braves vont rester… mais je ne vous en dirai pas plus.
La clôture en beauté de l'Iliade, une dernière belle empoignade, des apports culturels à foison et… un petit regret : l'envie de connaître la suite qu'on ne connaîtra jamais puisqu'elle est perdue à tout jamais, engloutie dans le grand intestin de l'histoire des œuvres disparues… Mais ceci n'est bien sûr qu'un vil avis, la toute petite chose qui sort du grand intestin de l'histoire des œuvres disparues, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Amorce de petit débat et clin d'oeil à Gwen21 qui est restée imperméable à "L'Odyssée" : la lecture enchanteresse (Circé... Nausicaa... Calypso...) de "L'Odyssée" d'HOMERE traduite par ce bon Victor Bérard m'apportera toujours cent-mille fois plus de bonheur qu'un ennième bouquin de Foenkinos, Nothomb, Angot, Legardinier, Khadra, etc. etc.... (sans présager de ce que nous lisons tous...) .
J'assume donc ici mon statut de Béotien définitif (ou d'insulaire de l'île d'Ithaque).
J'écouterais donc sagement à mon tour le "couseur de mots", ce "dérouleur de chants", l' "achik" ("amoureux") ou "rhapsode" ("interprête") immémorial - Cf. les beaux romans du kurdo-turc Yachar KEMAL : l'être aujourd'hui mystérieux que fut Homère, rhapsode ou aède...
M'assierai donc parmi la foule autour du type à la cithare, qui psalmodie ses chants épiques, sans discontinuer... Trois jours et trois nuit, s'il le faut ! On alimente le feu de brindilles pour tenir chaud à l'Aède.
"Aède" : celui qui savait faire chanter la langue.
Circé et ses "charmes", Nausicaa "aux bras blancs", Calypso "la bouclée" ne quittant plus sa grotte... où elle retient "prisonnier Ulysse" ("prison océane" d'avant la "prison aérienne" de la fée Viviane pour Merlin l'enchanteur...)
Je ne crois d'ailleurs pas à la notion (trop pratique et potentiellement mystificatrice) d' "auteur" mais bien plutôt à celle d'artiste. Artiste, oui, pratiquant un ART littéraire qui "devrait" être effectivement "pure exigence esthétique"...
"Ecrire beau" : pas à la portée du premier venu... et les étals de nos libraires et des grandes surfaces débordent actuellement "plutôt" de paralittérature que de belle et plaisante Littérature... La forêt de pacotille de la paralittérature (si extensive et toujours plus envahissante...) pourra un jour finir par cacher à nos sens anesthésiés et fatigués l'Arbre immémorial de la Littérature... A nous de veiller affectueusement sur ce bel Arbre : notre héritage d'humanité, bien sûr !
Amicalement à tous.
Lien : http://fleuvlitterature.cana..
J'assume donc ici mon statut de Béotien définitif (ou d'insulaire de l'île d'Ithaque).
J'écouterais donc sagement à mon tour le "couseur de mots", ce "dérouleur de chants", l' "achik" ("amoureux") ou "rhapsode" ("interprête") immémorial - Cf. les beaux romans du kurdo-turc Yachar KEMAL : l'être aujourd'hui mystérieux que fut Homère, rhapsode ou aède...
M'assierai donc parmi la foule autour du type à la cithare, qui psalmodie ses chants épiques, sans discontinuer... Trois jours et trois nuit, s'il le faut ! On alimente le feu de brindilles pour tenir chaud à l'Aède.
"Aède" : celui qui savait faire chanter la langue.
Circé et ses "charmes", Nausicaa "aux bras blancs", Calypso "la bouclée" ne quittant plus sa grotte... où elle retient "prisonnier Ulysse" ("prison océane" d'avant la "prison aérienne" de la fée Viviane pour Merlin l'enchanteur...)
Je ne crois d'ailleurs pas à la notion (trop pratique et potentiellement mystificatrice) d' "auteur" mais bien plutôt à celle d'artiste. Artiste, oui, pratiquant un ART littéraire qui "devrait" être effectivement "pure exigence esthétique"...
"Ecrire beau" : pas à la portée du premier venu... et les étals de nos libraires et des grandes surfaces débordent actuellement "plutôt" de paralittérature que de belle et plaisante Littérature... La forêt de pacotille de la paralittérature (si extensive et toujours plus envahissante...) pourra un jour finir par cacher à nos sens anesthésiés et fatigués l'Arbre immémorial de la Littérature... A nous de veiller affectueusement sur ce bel Arbre : notre héritage d'humanité, bien sûr !
Amicalement à tous.
Lien : http://fleuvlitterature.cana..
Ulysse est un grand prétentiard, imbu de sa personne qui s'aime beaucoup, beaucoup. Evidemment il adore raconter ses exploits à qui mieux mieux et il est légèrement mégalo, il parle de lui à la troisième personne. Ainsi il se vante d'avoir eu de multiples conquêtes féminines : Nausicaa, Calypso, Circé et de nombreuse autres femmes, toutes folles de lui à l'entendre. Féminines certes mais pourtant certaines mauvaises langues parmi sa troupe, prétendent qu'à propos de femme, c'est lui Ulysse qui tenait ce rôle quand les marins restaient trop longtemps en mer à la recherche du chemin du retour. Un adepte donc du : "A voile et à vapeur". Ça s'appelle l'adaptabilité !
Parmi les exploits dont il est très fier, ce sadique a crevé l'oeil d'un pauvre cyclope végétarien qui ne faisait pas de mal à une mouche. Ça n'est pas très très gentil!
Ensuite Ulysse s'est promené aux Enfers, s'amusant caché derrière les piliers, à faire peur aux pauvres âmes en peine en leur criant "bouh ! ". Quand Hadès a été mis au courant, il a viré ce grand imbécile à coup de fourche dans le derche.
Comme autre exploit, Ulysse s'est attaché à un mat pour entendre le fameux chant des Sirènes, chant soi-disant mortel, mouais, bof, bof. Puis lui-même, pour faire connaître sa belle voix s'est mis à chanter " Vous les femmes, vous le charme ! " et alors là, ça été radical, toutes les Sirènes se sont suicidées.
Après dix ans, Ulysse qui était nul en navigation, a enfin retrouvé son chemin et a rejoint sa terre natale. Malgré la légende, Pénélope n'avait pas suivi d'abstinence sexuelle, elle avait couché avec quelques prétendants très craquants qui tournaient autour d'elle, elle aurait eu tort de se priver. Elle accueillit donc le grand m'as-tu-vu avec circonspection. Pour finir, le chien d'Ulysse est venu pisser sur ses godasses en signe de dédain.
Parmi les exploits dont il est très fier, ce sadique a crevé l'oeil d'un pauvre cyclope végétarien qui ne faisait pas de mal à une mouche. Ça n'est pas très très gentil!
Ensuite Ulysse s'est promené aux Enfers, s'amusant caché derrière les piliers, à faire peur aux pauvres âmes en peine en leur criant "bouh ! ". Quand Hadès a été mis au courant, il a viré ce grand imbécile à coup de fourche dans le derche.
Comme autre exploit, Ulysse s'est attaché à un mat pour entendre le fameux chant des Sirènes, chant soi-disant mortel, mouais, bof, bof. Puis lui-même, pour faire connaître sa belle voix s'est mis à chanter " Vous les femmes, vous le charme ! " et alors là, ça été radical, toutes les Sirènes se sont suicidées.
Après dix ans, Ulysse qui était nul en navigation, a enfin retrouvé son chemin et a rejoint sa terre natale. Malgré la légende, Pénélope n'avait pas suivi d'abstinence sexuelle, elle avait couché avec quelques prétendants très craquants qui tournaient autour d'elle, elle aurait eu tort de se priver. Elle accueillit donc le grand m'as-tu-vu avec circonspection. Pour finir, le chien d'Ulysse est venu pisser sur ses godasses en signe de dédain.
Au risque de m'attirer les foudres de l'un ou l'autre des locataires de l'Olympe, je vais tenter un angle d'attaque un peu osé qui pourrait éventuellement surprendre ou scandaliser les puristes. Je m'en excuse auprès d'eux dès à présent.
Et si je prétextais que ces six premiers chants de l'Iliade m'évoquent fort un manga pour jeunes ados de qualité moyenne ? En fait, à peu de chose près, selon moi, l'Iliade, c'est du Saint Seiya vieux de 2800 ans.
Au cours de ces six premiers chants, on assiste d'abord à la querelle d'Achille et d'Agamemnon à propos d'une femme qui avait été promise à Achille et dont finalement le chef des Achéens s'est octroyé la pleine possession. Si bien que le vaillant soldat reste à bouder dans son coin et ne prend pas part aux combats.
C'est ensuite une sorte d'inventaire des forces en présence, tant côté des Grecs que des Troyens. Suite à cet état des lieux, on croit entrevoir une possibilité de résolution du conflit vieux de plus de neuf ans. Il s'agirait d'un duel entre Ménélas, le Grec offensé par le rapt de sa femme Hélène et Pâris, le Troyen auteur du rapt. Le vainqueur du duel emportant Hélène et les trésors et permettant une solution à l'amiable entre les deux armées, un peu comme dans la célèbre tragédie de Corneille : Horace.
Mais il n'en est rien car Pâris quitte le combat et les dieux eux-mêmes poussent les Troyens à rompre le pacte de non agression, notamment en envoyant une flèche sur Ménélas, casus belli caractérisé.
Et là ça tourne à la franche baston, au pugilat organisé, tant les Grecs que les Troyens jouent de la javeline, du char, de l'arc et de l'épée. Ça tombe à qui mieux mieux. De part et d'autre il y a des champions, Diomède notamment côté grec, mais il y a aussi et surtout le recours ou non aux dieux de l'Olympe qui prennent ouvertement parti pour leurs poulains, se querellant eux-mêmes au passage.
Enfin, le sixième chant marque une petite pause où la situation, plutôt mal engagée pour les Troyens, semble être amenée à bouger un petit peu car Hector demande ouvertement aux femmes d'aller faire des offrandes à Athéna et il en profite également pour ramener Pâris au combat, lui qui s'était débiné comme un malpropre.
Mais ce n'est pas selon moi étonnant que les producteurs américains aient pu faire de Troie un film à grand spectacle particulièrement adapté pour un public adolescent car tous les clichés du manga y sont présents, avec des gros muscles, des valeurs d'honneur et de sacrifice qui ravissent toujours les teen-agers, aujourd'hui comme hier, même à 2800 ans d'intervalle.
Donc, un récit mythique plein d'action et de combats qui, passé les petites difficultés de la langue plus trop en phase avec l'époque, pourrait ravir la jeunesse. Moi, il m'arrive de m'y ennuyer un peu, mais je proposerai dans une prochaine critique de l'œuvre dans son entier, une lecture encore un peu différente de ce poème épique, œuvre fondatrice s'il en est. En outre, ceci n'est qu'un avis, c'est-à-dire bien peu de chose.
Et si je prétextais que ces six premiers chants de l'Iliade m'évoquent fort un manga pour jeunes ados de qualité moyenne ? En fait, à peu de chose près, selon moi, l'Iliade, c'est du Saint Seiya vieux de 2800 ans.
Au cours de ces six premiers chants, on assiste d'abord à la querelle d'Achille et d'Agamemnon à propos d'une femme qui avait été promise à Achille et dont finalement le chef des Achéens s'est octroyé la pleine possession. Si bien que le vaillant soldat reste à bouder dans son coin et ne prend pas part aux combats.
C'est ensuite une sorte d'inventaire des forces en présence, tant côté des Grecs que des Troyens. Suite à cet état des lieux, on croit entrevoir une possibilité de résolution du conflit vieux de plus de neuf ans. Il s'agirait d'un duel entre Ménélas, le Grec offensé par le rapt de sa femme Hélène et Pâris, le Troyen auteur du rapt. Le vainqueur du duel emportant Hélène et les trésors et permettant une solution à l'amiable entre les deux armées, un peu comme dans la célèbre tragédie de Corneille : Horace.
Mais il n'en est rien car Pâris quitte le combat et les dieux eux-mêmes poussent les Troyens à rompre le pacte de non agression, notamment en envoyant une flèche sur Ménélas, casus belli caractérisé.
Et là ça tourne à la franche baston, au pugilat organisé, tant les Grecs que les Troyens jouent de la javeline, du char, de l'arc et de l'épée. Ça tombe à qui mieux mieux. De part et d'autre il y a des champions, Diomède notamment côté grec, mais il y a aussi et surtout le recours ou non aux dieux de l'Olympe qui prennent ouvertement parti pour leurs poulains, se querellant eux-mêmes au passage.
Enfin, le sixième chant marque une petite pause où la situation, plutôt mal engagée pour les Troyens, semble être amenée à bouger un petit peu car Hector demande ouvertement aux femmes d'aller faire des offrandes à Athéna et il en profite également pour ramener Pâris au combat, lui qui s'était débiné comme un malpropre.
Mais ce n'est pas selon moi étonnant que les producteurs américains aient pu faire de Troie un film à grand spectacle particulièrement adapté pour un public adolescent car tous les clichés du manga y sont présents, avec des gros muscles, des valeurs d'honneur et de sacrifice qui ravissent toujours les teen-agers, aujourd'hui comme hier, même à 2800 ans d'intervalle.
Donc, un récit mythique plein d'action et de combats qui, passé les petites difficultés de la langue plus trop en phase avec l'époque, pourrait ravir la jeunesse. Moi, il m'arrive de m'y ennuyer un peu, mais je proposerai dans une prochaine critique de l'œuvre dans son entier, une lecture encore un peu différente de ce poème épique, œuvre fondatrice s'il en est. En outre, ceci n'est qu'un avis, c'est-à-dire bien peu de chose.
Je souhaiterais m'attarder ici moins sur l'aspect factuel et la narration des péripéties concernant les héros humains de ce second tiers de l'Iliade que sur l'une des dimensions du poème épique, à savoir : un récit mythique.
Par excellence, l'Iliade est un récit mythique, c'est-à-dire un récit des origines qui fait l'inventaire des mythes fondateurs sur lesquels s'appuie toute une société. Un récit mythique dit en général à ceux à qui il s'adresse 1) d'où ils viennent, 2) comment ils se sont installés ou constitués en tant que groupe autonome, 3) comment de divines ou semi-divines les identités marquantes en sont venues peu à peu à la forme humaine que nous connaissons aujourd'hui, 4) quelles sont les règles qui ont présidé au succès du groupe en question et donc, comment les membres actuels de ce groupe doivent se comporter pour perpétuer et maintenir le succès dudit groupe auquel s'adresse le récit des mythes fondateurs.
Ici dans ce second tome de l'Iliade dans l'édition en trois tomes, vous êtes en plein cœur de la tourmente quand aux péripéties des combats et aux mouvements successifs qui alternent, telle la marée et son balancement bien connu, entre Troyens d'une part et Achéens, d'autre part.
J'ai déjà abordé ailleurs certains de ces aspects. J'aimerais plutôt amener votre curiosité sur les aspects du divin dans l'Iliade. Et, dans ce second tiers, c'est particulièrement intéressant. On y aborde ce qui constitue mon quatrième point de la nature du récit mythique, à savoir, comment l'on doit se comporter en tant que membre de cette société.
Si l'on y regarde attentivement, l'implantation des dieux dans l'Olympe ressemble à s'y méprendre à l'installation d'une cellule familiale dans un village. Vous y trouvez le père de famille en exercice : Zeus ; sa bouillante épouse : Héra ; les frères cadets du chef de famille : Poséidon et Hadès ; les fils et filles du chef de famille, enfants légitimes : Arès, Héphaïstos ou illégitimes : Apollon et Athéna, pour ne citer qu'eux et enfin, les vieux parents gâteux : Cronos et Rhéa. Les autres sont tous plus ou moins des parents éloignés, consanguins ou cousins.
On y relève donc certains éléments typiques d'une société extrêmement patriarcale, où le chef de famille a toujours le dernier mot, où il est communément admis qu'il puisse avoir des relations extraconjugales avec progéniture associée mais on ne le tolèrerait évidemment pas de son épouse. Il est très intéressant de noter aussi qu'il n'y a pas nécessairement un culte des anciens. C'est le chef de famille en exercice qui commande, exactement comme dans les familles où le grand-père est encore au foyer familial mais que c'est son fils qui prend les décisions.
Il est à noter aussi que, bien que l'autorité soit clairement établie dans la cellule familiale, il n'y est pas interdit d'y exprimer son désaccord et son mécontentement à l'égard du chef. Poséidon ne s'en prive pas, Héra non plus. L'on apprend même que les lots (le ciel, la mer et la terre, le royaume des morts) ont été attribués aux trois frères que sont Zeus, Poséidon et Hadès par tirage au sort et que c'est juste son droit d'ainesse qui donne son ascendant supplémentaire à Zeus sur les deux autres.
Fréquence des conflits et des querelles à propos des décisions, remise en cause de l'autorité du chef sans trop de dommages, tirage au sort (de même que l'insoumission d'Achille vis-à-vis d'Agamemnon) nous indiquent par ailleurs clairement les canons d'une société assez égalitaire (toutes proportions gardées, bien évidemment). Dans un système social plus strict de telles libertés de la part des subordonnés ne seraient pas tolérées et l'ampleur de la sanction dissuaderait quiconque d'y réessayer à deux fois.
C'est particulièrement marqué dans les chants IX (Achille qui envoie promener Agamemnon), XIII (Poséidon qui n'en fait qu'à sa tête en opposition directe avec son frère Zeus) et XIV (Héra qui tente une combine pour embobiner Zeus et ainsi faire le contraire de ce qu'il a prescrit). Le côté " défi " ou " compétition " y est très valorisé, ce qui est aussi l'une des variables constitutives de la société grecque, l'une des plus compétitive de tous les temps, où même les pièces de théâtre faisaient l'objet d'une compétition et d'un prix.
En somme, être Grec, c'est aussi pouvoir montrer son caractère, exprimer un mécontentement, essayer des coalitions pour faire ployer l'autorité, dire aux anciens que leur temps est passé, etc., en un mot défier l'autre, prendre un risque social. Ce n'est pas si fréquent dans les sociétés antiques et je tenais à le souligner. Mais ceci n'est, une fois encore, qu'un modeste avis, que des spécialistes ou des plus férus que moi pourraient probablement battre en brèche, c'est-à-dire, tout bien considéré, pas grand-chose.
Par excellence, l'Iliade est un récit mythique, c'est-à-dire un récit des origines qui fait l'inventaire des mythes fondateurs sur lesquels s'appuie toute une société. Un récit mythique dit en général à ceux à qui il s'adresse 1) d'où ils viennent, 2) comment ils se sont installés ou constitués en tant que groupe autonome, 3) comment de divines ou semi-divines les identités marquantes en sont venues peu à peu à la forme humaine que nous connaissons aujourd'hui, 4) quelles sont les règles qui ont présidé au succès du groupe en question et donc, comment les membres actuels de ce groupe doivent se comporter pour perpétuer et maintenir le succès dudit groupe auquel s'adresse le récit des mythes fondateurs.
Ici dans ce second tome de l'Iliade dans l'édition en trois tomes, vous êtes en plein cœur de la tourmente quand aux péripéties des combats et aux mouvements successifs qui alternent, telle la marée et son balancement bien connu, entre Troyens d'une part et Achéens, d'autre part.
J'ai déjà abordé ailleurs certains de ces aspects. J'aimerais plutôt amener votre curiosité sur les aspects du divin dans l'Iliade. Et, dans ce second tiers, c'est particulièrement intéressant. On y aborde ce qui constitue mon quatrième point de la nature du récit mythique, à savoir, comment l'on doit se comporter en tant que membre de cette société.
Si l'on y regarde attentivement, l'implantation des dieux dans l'Olympe ressemble à s'y méprendre à l'installation d'une cellule familiale dans un village. Vous y trouvez le père de famille en exercice : Zeus ; sa bouillante épouse : Héra ; les frères cadets du chef de famille : Poséidon et Hadès ; les fils et filles du chef de famille, enfants légitimes : Arès, Héphaïstos ou illégitimes : Apollon et Athéna, pour ne citer qu'eux et enfin, les vieux parents gâteux : Cronos et Rhéa. Les autres sont tous plus ou moins des parents éloignés, consanguins ou cousins.
On y relève donc certains éléments typiques d'une société extrêmement patriarcale, où le chef de famille a toujours le dernier mot, où il est communément admis qu'il puisse avoir des relations extraconjugales avec progéniture associée mais on ne le tolèrerait évidemment pas de son épouse. Il est très intéressant de noter aussi qu'il n'y a pas nécessairement un culte des anciens. C'est le chef de famille en exercice qui commande, exactement comme dans les familles où le grand-père est encore au foyer familial mais que c'est son fils qui prend les décisions.
Il est à noter aussi que, bien que l'autorité soit clairement établie dans la cellule familiale, il n'y est pas interdit d'y exprimer son désaccord et son mécontentement à l'égard du chef. Poséidon ne s'en prive pas, Héra non plus. L'on apprend même que les lots (le ciel, la mer et la terre, le royaume des morts) ont été attribués aux trois frères que sont Zeus, Poséidon et Hadès par tirage au sort et que c'est juste son droit d'ainesse qui donne son ascendant supplémentaire à Zeus sur les deux autres.
Fréquence des conflits et des querelles à propos des décisions, remise en cause de l'autorité du chef sans trop de dommages, tirage au sort (de même que l'insoumission d'Achille vis-à-vis d'Agamemnon) nous indiquent par ailleurs clairement les canons d'une société assez égalitaire (toutes proportions gardées, bien évidemment). Dans un système social plus strict de telles libertés de la part des subordonnés ne seraient pas tolérées et l'ampleur de la sanction dissuaderait quiconque d'y réessayer à deux fois.
C'est particulièrement marqué dans les chants IX (Achille qui envoie promener Agamemnon), XIII (Poséidon qui n'en fait qu'à sa tête en opposition directe avec son frère Zeus) et XIV (Héra qui tente une combine pour embobiner Zeus et ainsi faire le contraire de ce qu'il a prescrit). Le côté " défi " ou " compétition " y est très valorisé, ce qui est aussi l'une des variables constitutives de la société grecque, l'une des plus compétitive de tous les temps, où même les pièces de théâtre faisaient l'objet d'une compétition et d'un prix.
En somme, être Grec, c'est aussi pouvoir montrer son caractère, exprimer un mécontentement, essayer des coalitions pour faire ployer l'autorité, dire aux anciens que leur temps est passé, etc., en un mot défier l'autre, prendre un risque social. Ce n'est pas si fréquent dans les sociétés antiques et je tenais à le souligner. Mais ceci n'est, une fois encore, qu'un modeste avis, que des spécialistes ou des plus férus que moi pourraient probablement battre en brèche, c'est-à-dire, tout bien considéré, pas grand-chose.
CLING ! BONG ! TOC ! PAF ! PFFIJJJ ! ZZUIPP ! CLONG ! CHPLOC !
Oui, dans ces chants VII à XII vous êtes en plein cœur de la mêlée. Ça ne rigole pas et les armes blanches prennent des teintes rouges. Le bronze des casques s'agite et le cuir des boucliers se déchire. En termes clairs, c'est la grosse, méchante, furieuse baston entre Achéens et Troyens.
Après un premier tome où l'on a vu les Troyens accuser le coup, ce tome 2 s'ouvre sur une volonté d'Hector (le chef de guerre des Troyens) de mettre fin au carnage et de sauver sa cité. Il propose donc un combat singulier où l'un des Grecs viendrait combattre contre lui. L'issue du combat entre les deux hommes déterminerait l'issue du conflit qui s'éternise depuis déjà neuf années.
Mais quel champion Agamemnon, chef de guerre des Grecs, va-t-il désigner puisque cette forte tête d'Achille refuse toujours de lui pardonner son outrage et de venir reprendre le combat ? Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont de taille à se mesurer à Hector dans un duel à mort.
Diomède ? Ulysse peut-être ? ou Ajax (le fils de Télamon, précision importante car ils sont deux Ajax, l'autre, le fils d'Oïlée, lui aussi jouera un rôle important plus tard) ? quelqu'un d'autre encore ? On tire à la courte paille et c'est Ajax qui sort. Pas mécontents les autres, car c'est un drôle de client Hector. Mais Ajax lui est un taureau que rien n'effraie, un genre de Russell Crowe antique, avec la bave à la gueule.
Il est même carrément en train de lui mettre la pâtée à Hector quand celui-ci est sauvé par la tombée de la nuit et le combat interrompu. Les Troyens, au plus bas, réclament une pause. Les Grecs n'autorisent que la crémation des morts.
C'est alors que Zeus en personne prend un peu les choses en main et apporte son appui officiel à Hector et aux Troyens qui ne tardent donc pas à faire reculer les Achéens (ça veut dire Grecs en langage homérique). Ces derniers se lamentent en pensant que tout serait décidément plus simple si cette tête de mule d'Achille arrêtait de bouder dans son coin et revenait prendre part aux combats.
Ils envoient donc une nouvelle délégation pour essayer de convaincre Achille et là, y a pas à dire, Agamemnon met le paquet : excuses, octroi de la femme qui était l'objet de sa discorde plus quelques autres au cas où, des richesses et des honneurs à gogo, des intérêts et des stock-options sur les butins à venir, sans oublier que comme messagers, il ne délègue pas des bras cassés, rien moins qu'Ulysse et Ajax. Mais rien n'y fait. Quand Achille est furax, il est furax. Il n'est pas du genre à passer l'éponge facilement et, pour tout dire, il ne porte pas particulièrement Agamemnon dans son cœur et c'est peut-être pour ça qu'il refuse de reprendre du service et que ce soit l'autre coco qui en retire tous les honneurs en tant que chef des armées grecques coalisées.
Le vieux Nestor, lui, sent bien qu'il y a péril en la demeure alors, de nuit, il exhorte Diomède et Ulysse, un costaud et un malin, d'aller faire un petit tour sur les lignes ennemies, histoire de glaner quelques informations et, si l'occasion s'en trouve, d'aller trucider un Troyen ou deux dans des conditions par super réglo, mais bon…, c'est le résultat qui compte.
Au petit matin, les deux éclaireurs ont fait un sort à Rhésos et lui ont piqué son bel attelage tout en ayant obtenu les informations qu'ils désiraient. Mais ça, voyez-vous, Zeus n'aime pas tellement. Alors il envoie un présage pour la bataille du jour : dès qu'Agamemnon recevra une blessure, ce sera le signe que les Troyens prendront l'avantage.
Et effectivement, dès que le patron des Grecs se fait écorcher, ceux-ci sont obligés de reculer. C'est même franchement la déroute, ils courent tous en ordre dispersé se mettre à l'abri derrière le mur de protection qu'ils ont construit pour protéger leurs embarcations. Achille semble encore et toujours le seul espoir, mais bon, vous savez ce qu'il en est... Néanmoins, Nestor cherche encore et toujours à le convaincre, en le prenant par les sentiments cette fois-ci, via son grand copain Patrocle.
Mais là, ça ne rigole plus, les amis, c'est la bataille furieuse autour du mur des Argiens (c'est encore une autre façon de dire les Grecs en langage homérique). Les Troyens savent que les bateaux sont à deux pas derrière ce mur. Il suffirait d'un petit incendie bien senti, un joli feu de joie avec les barques, pour leur couper toute retraite.
C'est la guerre totale, les combats sont rudes, tous les coups sont permis. Ce n'est pas toujours extrêmement élégant mais si on peut écrabouiller du monde à coups de gros cailloux, on ne va pas s'en priver. Et une fois encore, Zeus favorise Hector qui, malgré la résistance héroïque des Grecs, en particulier les deux Ajax, parvient malgré tout à forcer le mur et à s'introduire dans le bastion des Danaens (c'est encore une dernière façon de parler des Grecs en langage homérique).
Que va-t-il advenir maintenant ? C'est ce que vous saurez dans le prochain tome des aventures d'Hector le Troyen. Un poème épique pas nécessairement captivant, quoique personnellement j'aime plutôt bien, mais absolument indispensable pour comprendre la culture grecque, et de là, une partie de la nôtre. En outre, bien entendu, ceci n'est qu'un tout petit avant goût, une maigre sauce, une persillade, disons même une perce-iliade, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Oui, dans ces chants VII à XII vous êtes en plein cœur de la mêlée. Ça ne rigole pas et les armes blanches prennent des teintes rouges. Le bronze des casques s'agite et le cuir des boucliers se déchire. En termes clairs, c'est la grosse, méchante, furieuse baston entre Achéens et Troyens.
Après un premier tome où l'on a vu les Troyens accuser le coup, ce tome 2 s'ouvre sur une volonté d'Hector (le chef de guerre des Troyens) de mettre fin au carnage et de sauver sa cité. Il propose donc un combat singulier où l'un des Grecs viendrait combattre contre lui. L'issue du combat entre les deux hommes déterminerait l'issue du conflit qui s'éternise depuis déjà neuf années.
Mais quel champion Agamemnon, chef de guerre des Grecs, va-t-il désigner puisque cette forte tête d'Achille refuse toujours de lui pardonner son outrage et de venir reprendre le combat ? Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont de taille à se mesurer à Hector dans un duel à mort.
Diomède ? Ulysse peut-être ? ou Ajax (le fils de Télamon, précision importante car ils sont deux Ajax, l'autre, le fils d'Oïlée, lui aussi jouera un rôle important plus tard) ? quelqu'un d'autre encore ? On tire à la courte paille et c'est Ajax qui sort. Pas mécontents les autres, car c'est un drôle de client Hector. Mais Ajax lui est un taureau que rien n'effraie, un genre de Russell Crowe antique, avec la bave à la gueule.
Il est même carrément en train de lui mettre la pâtée à Hector quand celui-ci est sauvé par la tombée de la nuit et le combat interrompu. Les Troyens, au plus bas, réclament une pause. Les Grecs n'autorisent que la crémation des morts.
C'est alors que Zeus en personne prend un peu les choses en main et apporte son appui officiel à Hector et aux Troyens qui ne tardent donc pas à faire reculer les Achéens (ça veut dire Grecs en langage homérique). Ces derniers se lamentent en pensant que tout serait décidément plus simple si cette tête de mule d'Achille arrêtait de bouder dans son coin et revenait prendre part aux combats.
Ils envoient donc une nouvelle délégation pour essayer de convaincre Achille et là, y a pas à dire, Agamemnon met le paquet : excuses, octroi de la femme qui était l'objet de sa discorde plus quelques autres au cas où, des richesses et des honneurs à gogo, des intérêts et des stock-options sur les butins à venir, sans oublier que comme messagers, il ne délègue pas des bras cassés, rien moins qu'Ulysse et Ajax. Mais rien n'y fait. Quand Achille est furax, il est furax. Il n'est pas du genre à passer l'éponge facilement et, pour tout dire, il ne porte pas particulièrement Agamemnon dans son cœur et c'est peut-être pour ça qu'il refuse de reprendre du service et que ce soit l'autre coco qui en retire tous les honneurs en tant que chef des armées grecques coalisées.
Le vieux Nestor, lui, sent bien qu'il y a péril en la demeure alors, de nuit, il exhorte Diomède et Ulysse, un costaud et un malin, d'aller faire un petit tour sur les lignes ennemies, histoire de glaner quelques informations et, si l'occasion s'en trouve, d'aller trucider un Troyen ou deux dans des conditions par super réglo, mais bon…, c'est le résultat qui compte.
Au petit matin, les deux éclaireurs ont fait un sort à Rhésos et lui ont piqué son bel attelage tout en ayant obtenu les informations qu'ils désiraient. Mais ça, voyez-vous, Zeus n'aime pas tellement. Alors il envoie un présage pour la bataille du jour : dès qu'Agamemnon recevra une blessure, ce sera le signe que les Troyens prendront l'avantage.
Et effectivement, dès que le patron des Grecs se fait écorcher, ceux-ci sont obligés de reculer. C'est même franchement la déroute, ils courent tous en ordre dispersé se mettre à l'abri derrière le mur de protection qu'ils ont construit pour protéger leurs embarcations. Achille semble encore et toujours le seul espoir, mais bon, vous savez ce qu'il en est... Néanmoins, Nestor cherche encore et toujours à le convaincre, en le prenant par les sentiments cette fois-ci, via son grand copain Patrocle.
Mais là, ça ne rigole plus, les amis, c'est la bataille furieuse autour du mur des Argiens (c'est encore une autre façon de dire les Grecs en langage homérique). Les Troyens savent que les bateaux sont à deux pas derrière ce mur. Il suffirait d'un petit incendie bien senti, un joli feu de joie avec les barques, pour leur couper toute retraite.
C'est la guerre totale, les combats sont rudes, tous les coups sont permis. Ce n'est pas toujours extrêmement élégant mais si on peut écrabouiller du monde à coups de gros cailloux, on ne va pas s'en priver. Et une fois encore, Zeus favorise Hector qui, malgré la résistance héroïque des Grecs, en particulier les deux Ajax, parvient malgré tout à forcer le mur et à s'introduire dans le bastion des Danaens (c'est encore une dernière façon de parler des Grecs en langage homérique).
Que va-t-il advenir maintenant ? C'est ce que vous saurez dans le prochain tome des aventures d'Hector le Troyen. Un poème épique pas nécessairement captivant, quoique personnellement j'aime plutôt bien, mais absolument indispensable pour comprendre la culture grecque, et de là, une partie de la nôtre. En outre, bien entendu, ceci n'est qu'un tout petit avant goût, une maigre sauce, une persillade, disons même une perce-iliade, c'est-à-dire, pas grand-chose.
À l'issue de ce premier tiers de l'Iliade, le bouillant Achille n'a pas encore véritablement fait son entrée dans l'épopée. Le combat titanesque qui doit opposer le champion des Troyen, Hector, au champion des Achéens, Achille, donc, n'est pas encore au programme.
Ce dernier est resté sur la plage avec ses hommes parce qu'il reproche à Agamemnon, sorte de général en chef des Grecs, de l'avoir lésé lors de la dernière remise de butin et refuse donc de reprendre le combat tant qu'il n'aura pas recouvré son dû.
C'est donc un premier indice que nous lègue(nt) le ou plus exactement les rédacteurs de l'Iliade, qu'on baptise toujours sous le même chapeau commode d'Homère, bien que ce texte ait manifestement été établi sur plusieurs siècles et qu'il n'y a peut-être jamais eu plus d'Homère pour l'Iliade et l'Odyssée que de Moïse pour la Bible. Le copyright n'existant pas à l'époque, les auteurs successifs qui se relayaient pour les mettre en forme oubliaient souvent de préciser leur pedigree ; le fond et le désir de transmission prévalant sur l'identité du rédacteur.
Ces plusieurs que par commodité l'on nomme Homère, nous indiquent que, comme fondement de cette société dont cet écrit est l'un des piliers, il y a la possibilité de ne pas être d'accord avec l'autorité. En quelque sorte, un droit à se rebeller si la cause est juste et justifiée.
J'en veux pour preuve que même au panthéon de l'Olympe, il arrive très fréquemment aux dieux de ne pas être d'accord entre eux, et, par exemple, Athéna et Héra, s'opposent même très ouvertement à Zeus, qui est pourtant censé être l'autorité suprême. Ceci est la preuve irréfutable d'un système social relativement égalitaire, en tout cas pour l'époque, et dont tant l'histoire actuelle du XXIe siècle, ou celle récente du XXe siècle nous révèle qu'elle n'est pas toujours égalée sur ce point par beaucoup de sociétés de par le monde, largement plus autoritaires. (*voir le P. S. à ce propos).
Dans ce premier tiers de l'Iliade encore, il est question de droit et de destin. Les Achéens, c'est-à-dire, pour faire simple, les Grecs, sont persuadés d'être dans leur bon droit en venant venger le rapt d'Hélène, femme de Ménélas, le propre frère d'Agamemnon. Selon eux, il y a affront des Troyens, lequel affront doit être lavé dans le sang et au prix de la destruction de la cité de Troie.
Si l'on se place du point de vue Troyen, en revanche, il y a certes une action pas très reluisante de la part de Pâris (aussi nommé Alexandre), l'un des multiples frères d'Hector, les fils de Priam, le vieux roi de Troie. Mais il y a surtout une intervention divine : si Pâris a pu séduire Hélène, c'est qu'elle a été envoûtée par l'entremise d'Aphrodite, la déesse de la beauté ; et Pâris n'a donc été que l'instrument d'un destin qui lui est supérieur et sur lequel il n'a que peu de prises.
En somme, Justice et Destin sont deux variables qui s'opposent tant sur les causes du conflit, débuté il y a neuf ans de cela, que sur chacun de ses développements. Le juste est constamment mis en faillite par l'entremise du destin (dit plus clairement, l'intervention volontaire d'un dieu quelconque), mais réciproquement, le destin est lui-aussi mis à mal par moments par le rétablissement du juste et du loyal.
De ce fait, l'on assiste, après une revue des forces en présence, à une succession de combats, d'actes héroïques, de harangues, et d'interventions divines qui font pencher la balance tantôt côté Achéen, tantôt côté Troyen (je rappelle que Troie était située sur la côte Nord-Ouest de l'actuelle Turquie, sur le versant asiatique).
En force pure, les Achéens ont des héros qui semblent légèrement plus forts que les Troyens, notamment Diomède et Ajax, présentés comme deux véritables taureaux indomptables, et l'on ne parle même pas encore d'Achille, lui qui n'interviendra qu'à partir du second tiers de l'Iliade.
Chez les Troyens, hormis Hector, ce ne sont pas les gros bras qui se bousculent, et même Hector semble moins robuste qu'Ajax lorsqu'ils s'affrontent tous deux. C'est plutôt leur savoir technique qui semble être leur meilleur atout, notamment l'envoi de flèches à distance, ou le maniement du char à la rapidité incomparable.
Reste l'esprit. Certes Hector n'en semble pas démuni, mais là encore, c'est du côté grec que semblent se trouver les plus beaux spécimens ; il y a bien entendu la sagesse légendaire du vieux Nestor, mais aussi et surtout, la ruse, parfois même un peu fourbe du fameux Ulysse, l'identité même du peuple grec.
En guise de conclusion, à l'issue de ce premier tiers de l'œuvre, dans une version bilingue très sympa, vous êtes prêts à pénétrer de plain pied dans la symbolique mythique du premier grand peuple européen de l'histoire mondiale dont nous sommes, nous autres, en quelque sorte, les ultimes avatars. C'est donc une plongée vers nos propres origines, toujours intéressante à mener. Mais bien sûr, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
(* P. S. : Des chercheurs en primatologie ont montré de façon très convaincante qu'il existe chez de nombreuses espèces de primates une covariation des différentes variables sociales permettant d'expliquer sinon tout, du moins une très grande partie des différences de style social entre espèces proches. Ainsi entre les espèces très tolérantes socialement à une extrémité et les espèces très autoritaires à l'autre extrémité, il n'y a parfois qu'une infime variation d'un des paramètres mais qui entraîne à sa suite tous les autres.
Par exemple, Bernard Thierry a montré que parmi les 21 espèces de macaques répertoriées, l'essentiel des différences comportementales proviennent de l'intensité de l'agression. Pour ceux que cela intéresse, voici un lien vers l'un des multiples articles qu'il a publié à ce sujet :
http://people.nunn-lab.org/charlie/PDFs/55-Thierry-et-al.-2008.pdf
Quand l'intensité de l'agression est forte, on aura alors un système social très sclérosé, avec un héritage fort du rang social d'une génération à la suivante et une quasi impossibilité d'évoluer dans la hiérarchie sociale, des mères très restrictives et ultra-protectrices vis-à-vis de leurs petits. Ce faisant, ces groupes sont relativement apaisés et les contestations très rares. Disons que c'est l'homologue du système nord-coréen de l'espèce humaine.
À l'opposé, lorsque l'intensité de l'agression est plus faible, le risque de blessure étant moindre, les contestations sont beaucoup plus fréquentes et, comme sous produit, on constate beaucoup de coalitions d'individus moyens ou faibles de la hiérarchie contre des plus forts. Il est beaucoup plus possible d'évoluer hiérarchiquement par rapport à ses parents. De même, les mères sont plus permissives et encouragent même leurs petits à nouer des liens, notamment avec d'autres petits issus de femelles de statut social plus élevé.
Ceci donne des groupes extraordinairement bruyants et turbulents où les crêpages de chignons sont monnaie courante et suivis de grandes séances de réconciliation générale à l'autel de l'épouillage... jusqu'à la prochaine rixe. Ce système ressemble beaucoup à notre propre système de république molle et vaguement démocratique dans lequel tout le monde crie et où les règles sont respectées avec des critères à géométrie variable...)
Ce dernier est resté sur la plage avec ses hommes parce qu'il reproche à Agamemnon, sorte de général en chef des Grecs, de l'avoir lésé lors de la dernière remise de butin et refuse donc de reprendre le combat tant qu'il n'aura pas recouvré son dû.
C'est donc un premier indice que nous lègue(nt) le ou plus exactement les rédacteurs de l'Iliade, qu'on baptise toujours sous le même chapeau commode d'Homère, bien que ce texte ait manifestement été établi sur plusieurs siècles et qu'il n'y a peut-être jamais eu plus d'Homère pour l'Iliade et l'Odyssée que de Moïse pour la Bible. Le copyright n'existant pas à l'époque, les auteurs successifs qui se relayaient pour les mettre en forme oubliaient souvent de préciser leur pedigree ; le fond et le désir de transmission prévalant sur l'identité du rédacteur.
Ces plusieurs que par commodité l'on nomme Homère, nous indiquent que, comme fondement de cette société dont cet écrit est l'un des piliers, il y a la possibilité de ne pas être d'accord avec l'autorité. En quelque sorte, un droit à se rebeller si la cause est juste et justifiée.
J'en veux pour preuve que même au panthéon de l'Olympe, il arrive très fréquemment aux dieux de ne pas être d'accord entre eux, et, par exemple, Athéna et Héra, s'opposent même très ouvertement à Zeus, qui est pourtant censé être l'autorité suprême. Ceci est la preuve irréfutable d'un système social relativement égalitaire, en tout cas pour l'époque, et dont tant l'histoire actuelle du XXIe siècle, ou celle récente du XXe siècle nous révèle qu'elle n'est pas toujours égalée sur ce point par beaucoup de sociétés de par le monde, largement plus autoritaires. (*voir le P. S. à ce propos).
Dans ce premier tiers de l'Iliade encore, il est question de droit et de destin. Les Achéens, c'est-à-dire, pour faire simple, les Grecs, sont persuadés d'être dans leur bon droit en venant venger le rapt d'Hélène, femme de Ménélas, le propre frère d'Agamemnon. Selon eux, il y a affront des Troyens, lequel affront doit être lavé dans le sang et au prix de la destruction de la cité de Troie.
Si l'on se place du point de vue Troyen, en revanche, il y a certes une action pas très reluisante de la part de Pâris (aussi nommé Alexandre), l'un des multiples frères d'Hector, les fils de Priam, le vieux roi de Troie. Mais il y a surtout une intervention divine : si Pâris a pu séduire Hélène, c'est qu'elle a été envoûtée par l'entremise d'Aphrodite, la déesse de la beauté ; et Pâris n'a donc été que l'instrument d'un destin qui lui est supérieur et sur lequel il n'a que peu de prises.
En somme, Justice et Destin sont deux variables qui s'opposent tant sur les causes du conflit, débuté il y a neuf ans de cela, que sur chacun de ses développements. Le juste est constamment mis en faillite par l'entremise du destin (dit plus clairement, l'intervention volontaire d'un dieu quelconque), mais réciproquement, le destin est lui-aussi mis à mal par moments par le rétablissement du juste et du loyal.
De ce fait, l'on assiste, après une revue des forces en présence, à une succession de combats, d'actes héroïques, de harangues, et d'interventions divines qui font pencher la balance tantôt côté Achéen, tantôt côté Troyen (je rappelle que Troie était située sur la côte Nord-Ouest de l'actuelle Turquie, sur le versant asiatique).
En force pure, les Achéens ont des héros qui semblent légèrement plus forts que les Troyens, notamment Diomède et Ajax, présentés comme deux véritables taureaux indomptables, et l'on ne parle même pas encore d'Achille, lui qui n'interviendra qu'à partir du second tiers de l'Iliade.
Chez les Troyens, hormis Hector, ce ne sont pas les gros bras qui se bousculent, et même Hector semble moins robuste qu'Ajax lorsqu'ils s'affrontent tous deux. C'est plutôt leur savoir technique qui semble être leur meilleur atout, notamment l'envoi de flèches à distance, ou le maniement du char à la rapidité incomparable.
Reste l'esprit. Certes Hector n'en semble pas démuni, mais là encore, c'est du côté grec que semblent se trouver les plus beaux spécimens ; il y a bien entendu la sagesse légendaire du vieux Nestor, mais aussi et surtout, la ruse, parfois même un peu fourbe du fameux Ulysse, l'identité même du peuple grec.
En guise de conclusion, à l'issue de ce premier tiers de l'œuvre, dans une version bilingue très sympa, vous êtes prêts à pénétrer de plain pied dans la symbolique mythique du premier grand peuple européen de l'histoire mondiale dont nous sommes, nous autres, en quelque sorte, les ultimes avatars. C'est donc une plongée vers nos propres origines, toujours intéressante à mener. Mais bien sûr, ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
(* P. S. : Des chercheurs en primatologie ont montré de façon très convaincante qu'il existe chez de nombreuses espèces de primates une covariation des différentes variables sociales permettant d'expliquer sinon tout, du moins une très grande partie des différences de style social entre espèces proches. Ainsi entre les espèces très tolérantes socialement à une extrémité et les espèces très autoritaires à l'autre extrémité, il n'y a parfois qu'une infime variation d'un des paramètres mais qui entraîne à sa suite tous les autres.
Par exemple, Bernard Thierry a montré que parmi les 21 espèces de macaques répertoriées, l'essentiel des différences comportementales proviennent de l'intensité de l'agression. Pour ceux que cela intéresse, voici un lien vers l'un des multiples articles qu'il a publié à ce sujet :
http://people.nunn-lab.org/charlie/PDFs/55-Thierry-et-al.-2008.pdf
Quand l'intensité de l'agression est forte, on aura alors un système social très sclérosé, avec un héritage fort du rang social d'une génération à la suivante et une quasi impossibilité d'évoluer dans la hiérarchie sociale, des mères très restrictives et ultra-protectrices vis-à-vis de leurs petits. Ce faisant, ces groupes sont relativement apaisés et les contestations très rares. Disons que c'est l'homologue du système nord-coréen de l'espèce humaine.
À l'opposé, lorsque l'intensité de l'agression est plus faible, le risque de blessure étant moindre, les contestations sont beaucoup plus fréquentes et, comme sous produit, on constate beaucoup de coalitions d'individus moyens ou faibles de la hiérarchie contre des plus forts. Il est beaucoup plus possible d'évoluer hiérarchiquement par rapport à ses parents. De même, les mères sont plus permissives et encouragent même leurs petits à nouer des liens, notamment avec d'autres petits issus de femelles de statut social plus élevé.
Ceci donne des groupes extraordinairement bruyants et turbulents où les crêpages de chignons sont monnaie courante et suivis de grandes séances de réconciliation générale à l'autel de l'épouillage... jusqu'à la prochaine rixe. Ce système ressemble beaucoup à notre propre système de république molle et vaguement démocratique dans lequel tout le monde crie et où les règles sont respectées avec des critères à géométrie variable...)
Le roman fondateur de la littérature, celui qui va inspirer toutes les narrations futures.
On connait l'histoire d'Ulysse, on a lu quelques épisodes, vu un film mais lire l'ensemble de l'œuvre, avec ces longs chapitres, les épithètes homériques et les longues descriptions du monde marin avec ses monstres et ses démons.
On a l'impression d'assister à un huis-clos sur la mer et pourtant, Ulysse ne fait qu'accoster pour mieux reprendre la mer, comme si la terre ferme lui était non seulement interdite mais aussi néfaste, comme si sa condamnation à errer sur la mer était plus bénéfique sur l'eau que sur terre.
Et puis il y a les épisodes dignes d'un roman d'aventures, les Sirènes, symboles du chant littéraire, de la voix de l'auteur qui nous emmène où on veut et peut nous détruire (tiens, Bovary...), les monstres comme Charybde et Sylla...
Enfin, et cela surprend, on parle plus des autres, de Télémaque son fils qui le cherche, de Pénélope qui l'attend que de lui qui veut revenir.
C'est le roman qui a presque tout : la recherche de l'autre, la quête, le chant des mots, le plaisir du retour chez soi. Il est aussi plaisant de l'étudier et le comprendre, tellement il regorge de symboles, que le lire.
On connait l'histoire d'Ulysse, on a lu quelques épisodes, vu un film mais lire l'ensemble de l'œuvre, avec ces longs chapitres, les épithètes homériques et les longues descriptions du monde marin avec ses monstres et ses démons.
On a l'impression d'assister à un huis-clos sur la mer et pourtant, Ulysse ne fait qu'accoster pour mieux reprendre la mer, comme si la terre ferme lui était non seulement interdite mais aussi néfaste, comme si sa condamnation à errer sur la mer était plus bénéfique sur l'eau que sur terre.
Et puis il y a les épisodes dignes d'un roman d'aventures, les Sirènes, symboles du chant littéraire, de la voix de l'auteur qui nous emmène où on veut et peut nous détruire (tiens, Bovary...), les monstres comme Charybde et Sylla...
Enfin, et cela surprend, on parle plus des autres, de Télémaque son fils qui le cherche, de Pénélope qui l'attend que de lui qui veut revenir.
C'est le roman qui a presque tout : la recherche de l'autre, la quête, le chant des mots, le plaisir du retour chez soi. Il est aussi plaisant de l'étudier et le comprendre, tellement il regorge de symboles, que le lire.
Je me suis lancée dans la lecture de L’Odyssée parce que mes deux enfants, dans leurs cursus respectifs, sont en train de l’étudier et que j’avais envie de participer à leurs conversations !
Et alors que je ne m’y attendais pas, j’ai été vraiment surprise et amusée.
Surprise par la construction narrative, Homère est terriblement moderne, il a su enchâsser des récits dans les récits, faire des retours en arrière, il y a des reprises, des anticipations. Quand je pense à la façon dont Chrétien de Troyes écrira quatre siècles plus tard… je suis scotchée…
Et amusée par l’absence de sagesse, le côté enfantin de ces hommes et ces Dieux. Calypso qui joue les vierges outragée parce qu’on lui vole son joujou, Ulysse, alors qu’elle l’emprisonne sans vergogne depuis sept années, Ulysse qui par orgueil (ou préjugé 😉) révèle au cyclope qu’il vient d’éborgner… euh… comme il n’y avait qu’un œil, qu’il vient d’aveugler, son nom, ce qui évidemment lui vaudra la colère de Poséidon (c’est le papa du cyclope), les prétendants qui ont inventé le loft avant l’heure, un endroit où on ne paie rien, ou on vit à l’œil en fainéantant dans la joie et l’allégresse et où on s’étonne ensuite d’être massacré par le légitime propriétaire des lieux… Parfois, je crois que certains élèves de grande section pourraient leur en apprendre à tous !
L’histoire commence alors qu’Ulysse a déjà vécu toutes ses périlleuses aventures, il est prisonnier chez la déesse Calypso. Il se morfond sur la plage, parce que seul et sans bateau il ne peut pas rentrer chez lui… enfin il se morfond, tout est relatif, le fait d’être prisonnier de Calypso ne l’empêche pas d’honorer la déesse, le soir, dans son lit !
Puis Homère nous entraîne sur l’île d’Ithaque, on découvre le désespoir de Télémaque, le fils d’Ulysse, face à la horde de prétendants qui vit nonchalamment chez lui, en pillant toutes ses richesses et ses réserves.
Il va prendre la mer, pour tenter d’avoir des nouvelles de son père. N’oublions pas que personne ne sait s’il est mort ou vivant. Il reviendra sur son ile natale après l’arrivée d’Ulysse.
Pendant ce temps Athéna fait les doux yeux à papa Zeus et obtient de lui la libération d’Ulysse. Calypso de mauvaise grâce lui indique comment il peut construire un radeau. Et le voilà sur les flots. Il arrive chez les Phaéciens et après leur avoir caché son identité (c’est un gars prudent Ulysse qui aime bien tester avant de se dévoiler), il dit qui il est et raconte ses péripéties : les Cicones, les Lotophages, les Cyclopes, Eole et la bourse pleine de vents, les géants cannibales, Circé, les enfers, les sirènes, Charybde et Scylla, l’île d’Héllios où la totalité des compagnons d’Ulysse mourront, de nouveau Charybde et Scylla et le naufrage d’Ulysse sur l’île de Calypso.
Puis les Phaéciens décident d’aider Ulysse, ils le couvrent de présents et le raccompagnent sur Ithaque. Là il commence par se cacher de tous sous les traits d’un vieux mendiant en haillons, il veut vérifier l’état d’esprit de ceux qu’il a quitté vingt ans plus tôt. Enfin (j’ai cru que ça n’arriverait jamais, tellement le teasing est intense à la fin), aidé de son fils Télémaque, du porcher et du bouvier, il massacre la totalité des prétendants. Et Athéna interviendra pour que les familles de ces hommes ne se vengent pas.
Pour terminer ce petit billet, je dirai que j’ai beaucoup aimé cette lecture, je craignais qu’elle soit difficile, ça n’a pas du tout été le cas, et je l’ai vraiment trouvée divertissante.
Et alors que je ne m’y attendais pas, j’ai été vraiment surprise et amusée.
Surprise par la construction narrative, Homère est terriblement moderne, il a su enchâsser des récits dans les récits, faire des retours en arrière, il y a des reprises, des anticipations. Quand je pense à la façon dont Chrétien de Troyes écrira quatre siècles plus tard… je suis scotchée…
Et amusée par l’absence de sagesse, le côté enfantin de ces hommes et ces Dieux. Calypso qui joue les vierges outragée parce qu’on lui vole son joujou, Ulysse, alors qu’elle l’emprisonne sans vergogne depuis sept années, Ulysse qui par orgueil (ou préjugé 😉) révèle au cyclope qu’il vient d’éborgner… euh… comme il n’y avait qu’un œil, qu’il vient d’aveugler, son nom, ce qui évidemment lui vaudra la colère de Poséidon (c’est le papa du cyclope), les prétendants qui ont inventé le loft avant l’heure, un endroit où on ne paie rien, ou on vit à l’œil en fainéantant dans la joie et l’allégresse et où on s’étonne ensuite d’être massacré par le légitime propriétaire des lieux… Parfois, je crois que certains élèves de grande section pourraient leur en apprendre à tous !
L’histoire commence alors qu’Ulysse a déjà vécu toutes ses périlleuses aventures, il est prisonnier chez la déesse Calypso. Il se morfond sur la plage, parce que seul et sans bateau il ne peut pas rentrer chez lui… enfin il se morfond, tout est relatif, le fait d’être prisonnier de Calypso ne l’empêche pas d’honorer la déesse, le soir, dans son lit !
Puis Homère nous entraîne sur l’île d’Ithaque, on découvre le désespoir de Télémaque, le fils d’Ulysse, face à la horde de prétendants qui vit nonchalamment chez lui, en pillant toutes ses richesses et ses réserves.
Il va prendre la mer, pour tenter d’avoir des nouvelles de son père. N’oublions pas que personne ne sait s’il est mort ou vivant. Il reviendra sur son ile natale après l’arrivée d’Ulysse.
Pendant ce temps Athéna fait les doux yeux à papa Zeus et obtient de lui la libération d’Ulysse. Calypso de mauvaise grâce lui indique comment il peut construire un radeau. Et le voilà sur les flots. Il arrive chez les Phaéciens et après leur avoir caché son identité (c’est un gars prudent Ulysse qui aime bien tester avant de se dévoiler), il dit qui il est et raconte ses péripéties : les Cicones, les Lotophages, les Cyclopes, Eole et la bourse pleine de vents, les géants cannibales, Circé, les enfers, les sirènes, Charybde et Scylla, l’île d’Héllios où la totalité des compagnons d’Ulysse mourront, de nouveau Charybde et Scylla et le naufrage d’Ulysse sur l’île de Calypso.
Puis les Phaéciens décident d’aider Ulysse, ils le couvrent de présents et le raccompagnent sur Ithaque. Là il commence par se cacher de tous sous les traits d’un vieux mendiant en haillons, il veut vérifier l’état d’esprit de ceux qu’il a quitté vingt ans plus tôt. Enfin (j’ai cru que ça n’arriverait jamais, tellement le teasing est intense à la fin), aidé de son fils Télémaque, du porcher et du bouvier, il massacre la totalité des prétendants. Et Athéna interviendra pour que les familles de ces hommes ne se vengent pas.
Pour terminer ce petit billet, je dirai que j’ai beaucoup aimé cette lecture, je craignais qu’elle soit difficile, ça n’a pas du tout été le cas, et je l’ai vraiment trouvée divertissante.
Tèlémakhos averti par la déesse Athènè aux yeux clairs que son père est peut-être vivant part à sa recherche, abandonnant sa mère Pènélopéia aux voraces prétendants, et pendant que les anciens compagnons d'arme de son père lui racontent ses hauts faits lors de la guerre de Troie, celui-ci, captif de la divine Kalypsô la convainc de le laisser quitter son île sur un radeau mais Poseidaôn qui ébranle la terre se fâche et il échoue chez la vierge Nausikaa où il raconte comment furent décimés ses camarades chez le kyklôps dont l'éborgnement fâcha si fort son frère Poseidaôn, les géants, l'empoisonneuse Kirkè ne le laissant partir qu'à condition qu'il aie consulter l'âme du Thébain Teirésias dans l'Aidès auprès de l'implacable Perséphonéia, le chant des divines Seirènes, le monstre Skyllè aux six cous puis la fureur d'Hélios dont les boeufs avaient été sacrifiés.
Reste au retour à reprendre l'île d'Ithaque aux insolents prétendants .
Une construction moderne 'à tiroirs' du récit le rendant plus vivant, beaucoup de poésie dans la belle traduction de Charles-René-Marie Leconte de L'Isle par exemple pour décrire un lever de soleil:'Hèlios, quittant son beau lac, monta dans l'Ouranos d'airain, afin de porter la lumière aux immortels et aux hommes mortels sur la terre féconde.'
Mais ce qui m'a le plus profondément touché en pénétrant un mode de vie datant de 3000 ans, c'est la poignante fragilité de ce peuple soumis aux caprices des dieux, crainte ou confiance, espoirs, abandon.
Reste au retour à reprendre l'île d'Ithaque aux insolents prétendants .
Une construction moderne 'à tiroirs' du récit le rendant plus vivant, beaucoup de poésie dans la belle traduction de Charles-René-Marie Leconte de L'Isle par exemple pour décrire un lever de soleil:'Hèlios, quittant son beau lac, monta dans l'Ouranos d'airain, afin de porter la lumière aux immortels et aux hommes mortels sur la terre féconde.'
Mais ce qui m'a le plus profondément touché en pénétrant un mode de vie datant de 3000 ans, c'est la poignante fragilité de ce peuple soumis aux caprices des dieux, crainte ou confiance, espoirs, abandon.
Après avoir lu des petits livres, puis de plus gros pour enfants sur la mythologie grecque, j'ai fini par avoir envie de lire la vraie Odyssée, celle écrite par Homère! En fait, aussitôt se pose la question de la version: il y en a tellement! J'ai acheté en livre de poche l'une des plus courantes, celle de Victor Bérard, tout simplement parce qu'en le feuilletant il me donnait l'envie de le lire.
L'Odyssée est d'une grande poésie, mais c'est aussi un vrai roman d'aventures: le voyage interminable d'Ulysse le confronte à des monstres, des ensorceleuses et des Dieux parfois hostiles qui le mettent à rude épreuve. Une fois enfin rentré à Ithaque, le récit prend les allures d'un film d'action bourré de meurtres et d'affrontements entre de gros costauds, avant que l'amour ne conclue le tout. Les ingrédients sont parfaits pour une grande épopée!
Ulysse lui-même n'est pas si blanc que ça: formé à la guerre, téméraire au point de mettre en danger son équipage qui, par son arrogance, se fera dévorer par le Cyclope, querelleur avec les prétendants de sa femme et ses servantes à elle parce qu'elles profitent de la nuit pour être volages, et enfin, mythomane. Il en raconte, des histoires, à ses sauveurs, pour ne pas donner sa véritable identité. Au point qu'on pourrait se demander si toute son odyssée n'est pas une véritable fumisterie, une fuite qu'il déguiserait puisque c'est par ses propres récits qu'on découvre ce long périple.
Il se trouve que le Magazine Littéraire consacre ce mois-ci un numéro à Homère que j'ai juste eu le temps de lire avant de finir les 50 dernières pages de l'Odyssée, et je vous conseille cette lecture si vous vous intéressez à Homère.
Quant à moi, Nausicaa, Polyphème, Carybde et Scylla, les Enfers et les Dieux Grecs me sont beaucoup plus proches et je ne m'y tromperai sûrement plus. En plus de ça, j'en ai aimé la lecture!
L'Odyssée est d'une grande poésie, mais c'est aussi un vrai roman d'aventures: le voyage interminable d'Ulysse le confronte à des monstres, des ensorceleuses et des Dieux parfois hostiles qui le mettent à rude épreuve. Une fois enfin rentré à Ithaque, le récit prend les allures d'un film d'action bourré de meurtres et d'affrontements entre de gros costauds, avant que l'amour ne conclue le tout. Les ingrédients sont parfaits pour une grande épopée!
Ulysse lui-même n'est pas si blanc que ça: formé à la guerre, téméraire au point de mettre en danger son équipage qui, par son arrogance, se fera dévorer par le Cyclope, querelleur avec les prétendants de sa femme et ses servantes à elle parce qu'elles profitent de la nuit pour être volages, et enfin, mythomane. Il en raconte, des histoires, à ses sauveurs, pour ne pas donner sa véritable identité. Au point qu'on pourrait se demander si toute son odyssée n'est pas une véritable fumisterie, une fuite qu'il déguiserait puisque c'est par ses propres récits qu'on découvre ce long périple.
Il se trouve que le Magazine Littéraire consacre ce mois-ci un numéro à Homère que j'ai juste eu le temps de lire avant de finir les 50 dernières pages de l'Odyssée, et je vous conseille cette lecture si vous vous intéressez à Homère.
Quant à moi, Nausicaa, Polyphème, Carybde et Scylla, les Enfers et les Dieux Grecs me sont beaucoup plus proches et je ne m'y tromperai sûrement plus. En plus de ça, j'en ai aimé la lecture!
C'est au moins ma troisième relecture de cette version écourtée de l'Odyssée, et je prends toujours autant de plaisir à la redécouvrir. Quel bonheur de replonger dans les aventures du magnanime Ulysse !
Je ne m'étendrai pas outre-mesure sur des mythes connus de tous.
Ce qui rend la lecture fabuleuse est la grande poésie du texte et cette incroyable plongée dans la mer, sombre comme le vin, de notre imaginaire.
Cette coupe a cependant goût de trop peu, et je boirai l'Odyssée jusqu'à la lie dans sa version intégrale.
Je ne m'étendrai pas outre-mesure sur des mythes connus de tous.
Ce qui rend la lecture fabuleuse est la grande poésie du texte et cette incroyable plongée dans la mer, sombre comme le vin, de notre imaginaire.
Cette coupe a cependant goût de trop peu, et je boirai l'Odyssée jusqu'à la lie dans sa version intégrale.
« Patrocle s’approche, le pique de sa lance à la mâchoire, à droite, et passe à travers les dents. Alors, avec la lance, il le soulève et le tire par-dessus la rampe du char, comme un homme assis sur un cap rocheux tire hors de la mer un énorme poisson avec un fil de lin et un bronze luisant ; de la même façon, il tire du char l’homme, bouche ouverte, avec sa lance éclatante, puis le rejette à terre, la face en avant, et, dès qu’il est à terre, la vie l’abandonne. »
Première constatation : L’Iliade, c’est vraiment gore ! Ce conflit qui s’éternise devant les remparts de la ville de Troie (plus de dix ans) voit s’opposer Achéens et Troyens, sous la surveillance des dieux, eux-aussi divisés sur son issue. D’un côté, près de la mer, les Achéens ont leurs embarcations, auxquelles ont été ajoutées des baraquements provisoires et des fortifications. En face, dans la plaine, la ville de Troie. Des combats d’une grande violence s’y tiennent. A se demander comment au bout de dix ans il reste suffisamment de monde pour s’entretuer…
Deuxième remarque, l’Iliade est vraiment le reflet d’une mentalité archaïque, qui laisse libre cours à sa soif de colère, de meurtres et de sacrifices. Elle est souvent déconcertante. Par exemple, si les déesses se révèlent pugnaces, les mortelles ont une place purement utilitaire et décorative. Seule compte leur valeur marchande, mais elles passent visiblement bien après les trépieds (je ne suis pas parvenu à comprendre pourquoi ces objets utilitaires ont une telle importance), les chars, les chevaux et les armes.
Nos amis les animaux sont tout aussi maltraités. Les dieux grecs sont avides de sang et du fumet de viandes rôties, tout comme les mortels. Un cauchemar de végan, donc.
Malgré ce fort décalage spatio-temporel, je suis parvenu à m’intéresser à ce texte fondateur (d’où les cinq étoiles), si étrange et barbare. Les images poétiques sont essentiellement marquées par la nature : oiseaux, fauves, puissance des éléments. Les rapports entre les dieux, et des dieux avec les mortels dont ils sont parfois les géniteurs, ne sont pas simples. Là c’est plutôt l’image d’une organisation mafieuse qui s’est imposée à moi !
En conclusion, si vous voulez du dépaysement tentez l’Iliade. On est loin du feel-good.
Première constatation : L’Iliade, c’est vraiment gore ! Ce conflit qui s’éternise devant les remparts de la ville de Troie (plus de dix ans) voit s’opposer Achéens et Troyens, sous la surveillance des dieux, eux-aussi divisés sur son issue. D’un côté, près de la mer, les Achéens ont leurs embarcations, auxquelles ont été ajoutées des baraquements provisoires et des fortifications. En face, dans la plaine, la ville de Troie. Des combats d’une grande violence s’y tiennent. A se demander comment au bout de dix ans il reste suffisamment de monde pour s’entretuer…
Deuxième remarque, l’Iliade est vraiment le reflet d’une mentalité archaïque, qui laisse libre cours à sa soif de colère, de meurtres et de sacrifices. Elle est souvent déconcertante. Par exemple, si les déesses se révèlent pugnaces, les mortelles ont une place purement utilitaire et décorative. Seule compte leur valeur marchande, mais elles passent visiblement bien après les trépieds (je ne suis pas parvenu à comprendre pourquoi ces objets utilitaires ont une telle importance), les chars, les chevaux et les armes.
Nos amis les animaux sont tout aussi maltraités. Les dieux grecs sont avides de sang et du fumet de viandes rôties, tout comme les mortels. Un cauchemar de végan, donc.
Malgré ce fort décalage spatio-temporel, je suis parvenu à m’intéresser à ce texte fondateur (d’où les cinq étoiles), si étrange et barbare. Les images poétiques sont essentiellement marquées par la nature : oiseaux, fauves, puissance des éléments. Les rapports entre les dieux, et des dieux avec les mortels dont ils sont parfois les géniteurs, ne sont pas simples. Là c’est plutôt l’image d’une organisation mafieuse qui s’est imposée à moi !
En conclusion, si vous voulez du dépaysement tentez l’Iliade. On est loin du feel-good.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Homère
Lecteurs de Homère Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Odyssée
Comment s'appelle l'île sur laquelle vit Ulysse?
Calypso
Ithaque
Ilion
Péloponnèse
10 questions
2592 lecteurs ont répondu
Thème : L'Odyssée de
HomèreCréer un quiz sur cet auteur2592 lecteurs ont répondu