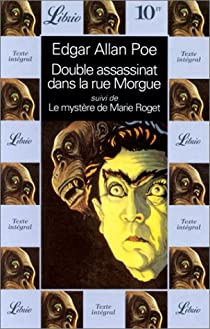>
Critique de berni_29
Bon, je n'ai pas de chance, s'agissant des personnages féminins dans ma découverte de l'univers littéraire d'Edgar Allan Poe. Souvenez-vous de mon billet, Aventures d'Arthur Gordon Pym, où je déplorais avec désarroi l'absence totale de femmes dans le récit.
Pour une fois que les deux nouvelles dont je vais vous parler en comportent, elles se font tout de suite assassinées dès le début de l'histoire et, qui plus, dans des circonstances sordides. Vous me direz, la manière aurait été plus douce, que le résultat n'en aurait pas été idifférent et mon chagrin tout aussi présent. Edgar Allan Poe ne m'a même pas donné le loisir d'apprendre à les connaître.
Double assassinat dans la rue Morgue est une nouvelle d'Edgar Allan Poe parue en 1841. C'est la première apparition d'un certain Auguste Dupin, détective français imaginé par l'écrivain américain qui devient ainsi l'inventeur du roman policier.
La nouvelle débute par une longue et savante réflexion sur l'importance qu'on donne à l'analyse dans l'esprit humain, propos développé avec brio par Auguste Dupin à son narrateur pour prendre le contre-pied des techniques policières jusqu'alors pratiquées et reposant essentiellement sur l'ingéniosité. Ici nous assistons à une brillante leçon qui cherche à démontrer la supériorité de l'intelligence méthodique sur le règne de l'apparence, Auguste Dupin n'hésitant pas à fustiger un des personnages fétiches qui a bercé mes souvenirs d'enfance devant le petit écran lorsqu'il n'y avait encore qu'une seule chaîne en noir et blanc, - non je ne vous parle pas de Thierry la Fronde, mais bien de Vidocq, Eugène-François Vidocq, ancien forçat évadé, devenu chef de la Sûreté Parisienne, puis qui fonda la première agence de détectives privés.
De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas... Bientôt un drame va permettre à Auguste Dupin de faire la démonstration au narrateur des propositions qu'il vient de lui avancer.
Nous sommes à Paris. Auguste Dupin et le narrateur apprennent qu'un double meurtre a été commis au quatrième étage de la rue Morgue, oui vous savez cette petite rue dans le quartier Saint-Roch : celui de Mme l'Espanaye et de sa fille Camille, occupant toutes deux le même appartement de l'étage. C'est une scène morbide qui s'offre alors sous nos yeux. On vient de retrouver le corps de la jeune fille encastré, pour ne pas dire enfourné, la tête en bas, dans le conduit de la cheminée de l'appartement, tandis que la mère gît quatre étages plus bas dans la cour pavée, au pied de l'immeuble, la gorge tranchée, la tête détachée du tronc. Un désordre saugrenu règne dans l'appartement, tandis que les témoins, n'ayant cependant rien vu de la scène ni de celui qui a commis cette tragédie, s'accordent à dire qu'ils auraient entendu une voix s'exprimant dans une langue étrangère. Mais surtout rien n'a été volé, ce que la police n'arrive pas à comprendre.
Auguste Dupin finira par éclaircir le mystère et aider celle-ci à mettre la main sur le coupable.
Mais le dénouement est-il l'aspect majeur de cette nouvelle ? Dans ce bijou littéraire, n'est-ce pas plutôt l'intention d'Edgar Allan Poe qui prévaut dans sa vision du monde, la manière de regarder ce monde, cette vision esthétique qui parfois nous obsède et nous emporte à notre détriment ?
Cette nouvelle et son incroyable dénouement ne portent-t-il pas cette idée que les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent, que notre oeil et nos émotions peuvent parfois se laisser impressionner, duper, en oublier la réalité de ce qui a pu être ou de ce qui est.
Derrière l'illusion apparente et chaotique du monde, n'existe-t-il pas un ordre immuable, qui échapperait à l'intelligence, en raison de nos passions ?
La seconde nouvelle dont je vais vous parler est tout aussi intéressante, mais m'a bien moins passionné dans ma lecture. Aussi ai-je été glaner quelque autre déambulation dans l'écho macabre de cette triste histoire.
Nous sommes de nouveau à Paris, dans ce Paris du XIXème siècle. Marie Roget et sa mère habitent rue Pavée Saint-André, la mère y tient une pension de famille. Quand elle atteint l'âge de vingt-deux ans, Marie, jeune femme d'une grande beauté, attire l'attention d'un parfumeur, qui l'embauche pour travailler dans sa boutique. Un an plus tard, Marie disparaît, mais réapparaît au bout d'une semaine, l'air triste et fatigué. Agacée de la curiosité consécutive à sa disparition, elle quitte la boutique du parfumeur. Cinq mois plus tard, elle disparaît de nouveau. Quatre jours après on retrouve son corps dans la Seine. La police parisienne est perdue en conjectures et n'avance pas.
Et qui croyez-vous va mener l'enquête et démêler l'écheveau de ce mystère insondable ? Notre ami Auguste Dupin, comme de bien entendu, toujours suivi de notre narrateur insatiable de curiosité et dégustant avec plaisir le bénéfice d'une nouvelle leçon du brillant détective.
Comme dans la première nouvelle, Auguste Dupin va prendre plaisir à défaire les jugements à l'emporte-pièce, combattre les généralités, les opinions, l'apparences des faits, mettant en pièce les observations des journaux de l'époque, qui ont vite fait de trouver un coupable idéal sans réflexion ni véritable fondement. Non, je vous assure, tout ceci se passe bien dans un autre temps qu'aujourd'hui...
Pendant qu'Auguste Dupin disserte sur le comportement du corps des noyés une fois plongés dans l'eau, le nombre de jours au bout desquels ils remontent à la surface, qui varie en fonction de leur poids, de leur masse, mais aussi la nature élastique d'une jarretière à agrafe..., je me suis plu à imaginer que Marie Roget était devenue durant quelques temps cette célèbre inconnue, cette jeune femme belle et non identifiée, dont on prétend que le corps aurait été repêché dans la Seine et dont le masque mortuaire de son visage présumé devint un véritable mythe qui envoûtera l'imaginaire des artistes parisiens de la fin du XIXème siècle. Je me souviens que Louis Aragon évoquait le souvenir de cette inconnue de la Seine et lui rendait un bel hommage dans son magnifique roman, Aurélien.
Pendant que je déambulais sur les berges de l'Île Saint-Louis et que je rêvais à la belle inconnue de la Seine, Auguste Dupin s'ingéniait à déconstruire méthodiquement les apparences, au risque d'agacer la police officielle, jetant les bases des suites de l'enquête et des étapes à suivre pour prouver que le coupable est bien...
Alors je me suis demandé, mais pourquoi diable Auguste Dupin est moins célèbre que Sherlock Holmes alors que ce dernier lui doit presque tout ?
Pour une fois que les deux nouvelles dont je vais vous parler en comportent, elles se font tout de suite assassinées dès le début de l'histoire et, qui plus, dans des circonstances sordides. Vous me direz, la manière aurait été plus douce, que le résultat n'en aurait pas été idifférent et mon chagrin tout aussi présent. Edgar Allan Poe ne m'a même pas donné le loisir d'apprendre à les connaître.
Double assassinat dans la rue Morgue est une nouvelle d'Edgar Allan Poe parue en 1841. C'est la première apparition d'un certain Auguste Dupin, détective français imaginé par l'écrivain américain qui devient ainsi l'inventeur du roman policier.
La nouvelle débute par une longue et savante réflexion sur l'importance qu'on donne à l'analyse dans l'esprit humain, propos développé avec brio par Auguste Dupin à son narrateur pour prendre le contre-pied des techniques policières jusqu'alors pratiquées et reposant essentiellement sur l'ingéniosité. Ici nous assistons à une brillante leçon qui cherche à démontrer la supériorité de l'intelligence méthodique sur le règne de l'apparence, Auguste Dupin n'hésitant pas à fustiger un des personnages fétiches qui a bercé mes souvenirs d'enfance devant le petit écran lorsqu'il n'y avait encore qu'une seule chaîne en noir et blanc, - non je ne vous parle pas de Thierry la Fronde, mais bien de Vidocq, Eugène-François Vidocq, ancien forçat évadé, devenu chef de la Sûreté Parisienne, puis qui fonda la première agence de détectives privés.
De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas... Bientôt un drame va permettre à Auguste Dupin de faire la démonstration au narrateur des propositions qu'il vient de lui avancer.
Nous sommes à Paris. Auguste Dupin et le narrateur apprennent qu'un double meurtre a été commis au quatrième étage de la rue Morgue, oui vous savez cette petite rue dans le quartier Saint-Roch : celui de Mme l'Espanaye et de sa fille Camille, occupant toutes deux le même appartement de l'étage. C'est une scène morbide qui s'offre alors sous nos yeux. On vient de retrouver le corps de la jeune fille encastré, pour ne pas dire enfourné, la tête en bas, dans le conduit de la cheminée de l'appartement, tandis que la mère gît quatre étages plus bas dans la cour pavée, au pied de l'immeuble, la gorge tranchée, la tête détachée du tronc. Un désordre saugrenu règne dans l'appartement, tandis que les témoins, n'ayant cependant rien vu de la scène ni de celui qui a commis cette tragédie, s'accordent à dire qu'ils auraient entendu une voix s'exprimant dans une langue étrangère. Mais surtout rien n'a été volé, ce que la police n'arrive pas à comprendre.
Auguste Dupin finira par éclaircir le mystère et aider celle-ci à mettre la main sur le coupable.
Mais le dénouement est-il l'aspect majeur de cette nouvelle ? Dans ce bijou littéraire, n'est-ce pas plutôt l'intention d'Edgar Allan Poe qui prévaut dans sa vision du monde, la manière de regarder ce monde, cette vision esthétique qui parfois nous obsède et nous emporte à notre détriment ?
Cette nouvelle et son incroyable dénouement ne portent-t-il pas cette idée que les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent, que notre oeil et nos émotions peuvent parfois se laisser impressionner, duper, en oublier la réalité de ce qui a pu être ou de ce qui est.
Derrière l'illusion apparente et chaotique du monde, n'existe-t-il pas un ordre immuable, qui échapperait à l'intelligence, en raison de nos passions ?
La seconde nouvelle dont je vais vous parler est tout aussi intéressante, mais m'a bien moins passionné dans ma lecture. Aussi ai-je été glaner quelque autre déambulation dans l'écho macabre de cette triste histoire.
Nous sommes de nouveau à Paris, dans ce Paris du XIXème siècle. Marie Roget et sa mère habitent rue Pavée Saint-André, la mère y tient une pension de famille. Quand elle atteint l'âge de vingt-deux ans, Marie, jeune femme d'une grande beauté, attire l'attention d'un parfumeur, qui l'embauche pour travailler dans sa boutique. Un an plus tard, Marie disparaît, mais réapparaît au bout d'une semaine, l'air triste et fatigué. Agacée de la curiosité consécutive à sa disparition, elle quitte la boutique du parfumeur. Cinq mois plus tard, elle disparaît de nouveau. Quatre jours après on retrouve son corps dans la Seine. La police parisienne est perdue en conjectures et n'avance pas.
Et qui croyez-vous va mener l'enquête et démêler l'écheveau de ce mystère insondable ? Notre ami Auguste Dupin, comme de bien entendu, toujours suivi de notre narrateur insatiable de curiosité et dégustant avec plaisir le bénéfice d'une nouvelle leçon du brillant détective.
Comme dans la première nouvelle, Auguste Dupin va prendre plaisir à défaire les jugements à l'emporte-pièce, combattre les généralités, les opinions, l'apparences des faits, mettant en pièce les observations des journaux de l'époque, qui ont vite fait de trouver un coupable idéal sans réflexion ni véritable fondement. Non, je vous assure, tout ceci se passe bien dans un autre temps qu'aujourd'hui...
Pendant qu'Auguste Dupin disserte sur le comportement du corps des noyés une fois plongés dans l'eau, le nombre de jours au bout desquels ils remontent à la surface, qui varie en fonction de leur poids, de leur masse, mais aussi la nature élastique d'une jarretière à agrafe..., je me suis plu à imaginer que Marie Roget était devenue durant quelques temps cette célèbre inconnue, cette jeune femme belle et non identifiée, dont on prétend que le corps aurait été repêché dans la Seine et dont le masque mortuaire de son visage présumé devint un véritable mythe qui envoûtera l'imaginaire des artistes parisiens de la fin du XIXème siècle. Je me souviens que Louis Aragon évoquait le souvenir de cette inconnue de la Seine et lui rendait un bel hommage dans son magnifique roman, Aurélien.
Pendant que je déambulais sur les berges de l'Île Saint-Louis et que je rêvais à la belle inconnue de la Seine, Auguste Dupin s'ingéniait à déconstruire méthodiquement les apparences, au risque d'agacer la police officielle, jetant les bases des suites de l'enquête et des étapes à suivre pour prouver que le coupable est bien...
Alors je me suis demandé, mais pourquoi diable Auguste Dupin est moins célèbre que Sherlock Holmes alors que ce dernier lui doit presque tout ?