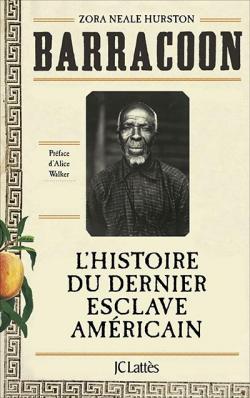>
Critique de DoubleMarge
" le livre est précieux aussi parce qu'il nous fait entrer dans cet abîme de désespoir que les Africains nomment Maafa, « terme swahili signifiant à la fois le désastre et la manière dont les hommes réagissent face à lui. » A l'instar du Samudaripen, de la Shoah, de la Naqba, mais avec une portée infiniment plus vaste, puisqu'elle désigne à la fois le déracinement, l'ethnocide, le génocide, l'esclavage, la traite, et ce pendant des siècles, cette expression porte l'horreur inédite du destin africain, mais aussi de cette résistance profonde, obscure, entêtée à ce qu'on pourrait appeler la nuit sans fin de la dépossession, de la déshumanisation. On ne peut qu'être épouvanté par la vie terrible que raconte Kossoula. La fin de l'esclavage ne verra évidemment pas la fin de ses tribulations. Comme le disait Wilde non sans perspicacité, « Les esclaves se retrouvèrent libres, absolument libres de mourir de faim ». Chassés des plantations sans le moindre dédommagement pour les années de travail gratuit, en butte à un racisme qui n'avait pas fléchi pour l'issue d'une guerre ou un texte de loi, ils devaient travailler dur pour peu. Dans sa naïveté, Kossoula demande à son ex-propriétaire un bout de terre pour s'y installer avec ses compagnes et compagnons, une fois qu'il a compris dans la douleur que jamais le fruit de son travail ne lui permettra de payer le voyage retour vers l'Afrique. le planteur, qui estime avoir toujours été bon avec ses esclaves (et en effet ce n'est pas une brute comme il en existe beaucoup) se met alors en colère, outré, et lui explique qu'il ne lui doit plus rien puisqu'il ne lui appartient plus. Au prix d'années de labeur, les Africains déportés du Clotilda acquièrent alors collectivement un lopin de terre où ils installent leur ville, Africatown (Plateau, en Alabama). Ce sera, pendant toute leur vie, un succédané d'Afrique où pourtant la vie n'est jamais facile. Entre Africains au début, ils sont rejoints par des afro-américains qui n'ont jamais connu l'Afrique, parlent anglais et les considèrent comme des sauvages. Douleur du massacre de sa famille et de l'arrachement, douleur de la déportation, douleur de la nostalgie et du mal du pays, douleur de l'esclavage et de l'humiliation, douleur lancinante et inguérissable du déracinement dans la violence, Kossoula décline toutes les facettes du Maafa. La trentaine d'Africains à rester ensemble, Principalement des Yoruba et des Fon, leur permet de continuer à parler leur langue, ne pas perdre leurs histoires, leurs contes, leurs proverbes, leur mémoire. Mais ils ont une vie d'assiégés, dure et violente, limitée en tout, sans espoir de retour. Malgré la férocité de son sort, Kossoula est un vieillard enjoué, changeant, parfois abattu et grincheux, mais la plupart du temps étonnament disert et avide de bonheur. le lien qui se tisse entre lui et Zora, alors âgée de 38 ans, est plein de fraîcheur et de spontanéité. Déporté à 19 ans, il a une mémoire très précise de tout ce qui s'est passé, et en lui l'Afrique est restée la part la plus intense et la plus lumineuse de sa vie, bien qu'il n'y ait passé que la fugacité de son extrême jeunesse. À l'époque où Zora le rencontre, il a perdu successivement quatre de ses enfants, sa femme, Abila, déportée en même temps que lui, et pour finir son dernier fils. Ne restent auprès de lui que sa belle-fille et ses petits-enfants. Sa famille a constitué pour lui un sanctuaire d'amour et de bonheur, le seul, dans une détresse constante. Mais d'elle aussi il a été dépouillé. Il cultive son jardin. À aucun moment de son récit il ne se présente comme le personnage central de sa propre vie. Il a tout subi, il a fait ce qu'il a pu, il a aimé pourtant, il s'est efforcé de résister à la cruauté du sort. Il est si pauvre que Zora et son éditrice lui porteront secours à plusieurs reprise, lui évitant de sombrer dans l'indigence. Il est devenu un bon chrétien, mais garde, à travers ses paraboles et ses contes, sa vision originelle de l'existence. ( ...) À partir du moment où on est né, on peut être dépossédé de l'avenir et de son destin, mais pas de ses origines. On est tout étonné de voir sortir des griffes d'une insatiable méchanceté ce vieillard qui parle d'amour, et qui sans cesse parle dans un présent aussi long que sa longue, très longue route. "
Lonnie, extrait de l'article paru dans DM
Lien : https://doublemarge.com/barr..
Lonnie, extrait de l'article paru dans DM
Lien : https://doublemarge.com/barr..