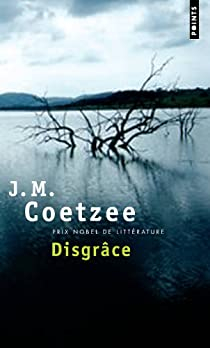>
Critique de Creisifiction
Faut-il un malheur pour abandonner ses mauvaises habitudes, ses vieux réflexes, modifier sa mentalité, changer de vie à défaut de pouvoir changer de peau..? On aimerait, bien évidemment, le cas échéant, pouvoir y arriver parce que touchés par la grâce, alors qu'en réalité ce sont, hélas, nos «disgrâces» qui la plupart du temps semblent ouvrir la voie aux véritables transformations...
David Lurie pensait, quant à lui, avoir réussi à régler sa vie comme du papier à musique. Tout compte fait, «à l'aune dont on mesure le bonheur», il se croyait provisoirement «heureux».
Vraiment ?
Lurie, 52 ans, est enseignant à l'Université du Cap. Suite à une restructuration interne, il s'était vu à contrecoeur reléguer de la chaire de langues modernes qu'il occupait auparavant vers un département et un poste sans aucun intérêt pour lui, en tant que «professeur associé en communication». Auteur frustré de trois essais «passés inaperçus dans le monde universitaire», sa carrière académique ronronne entre un vague projet constamment différé d'écriture d'un opéra de chambre inspiré d'un épisode de la vie de Lord Byron («Byron en Italie») et la carotte encore une peu verte d'une retraite paisible dans quelques années.
Marié et divorcé deux fois, ex-homme-à-femmes au magnétisme sexuel sur lequel il avait pu compter à chaque occasion par le passé, avant de constater un beau jour que «le pouvoir de son charme l'avait abandonné», ses besoins affectifs et sexuels sont assouvis par une liaison avec une call-girl dont il est depuis quelque temps aux abonnés fidèles («1h30 tous les jeudis après-midi»). Cependant, à partir d'un concours de circonstances anodin, absorbé malgré lui et malgré tout le bon sens dont il se croyait pourvu, par l'idée de sortir leurs rapports de l'anonymat implicite à ce type de transaction, David se met à enquêter sur sa vie. Devenu trop envahissant et pressant aux yeux de cette femme, qui tient quant à elle à garder une barrière infranchissable entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, celle-ci lui signifie brusquement un terme définitif à leurs rapports tarifés.
L'arrêt brutal de cette relation amoureuse aseptisée, lâchant dans la nature un démon de midi désormais délesté de toutes chaînes, conduira notre héros à sa «disgrâce». Tombé dans un véritable imbroglio érotico-amoureux impliquant une de ses élèves qu'il aura réussi à séduire grâce à son rôle et à son statut plutôt qu'à - tel qu'il aurait bien aimé pouvoir l'attribuer- des attraits irrésistibles résiduels ayant pu subsister chez lui, la jeune femme en question, apparemment consentante au départ (?), à ses yeux en tout cas, finit cependant par estimer avoir été abusée sexuellement par lui et par le dénoncer publiquement. David Lurie, de son côté, refusant inexplicablement, vis-à-vis de son entourage et de ses collègues, de fournir la moindre justification à ses actes, se récusant surtout à tout procès disciplinaire interne, décide de plaider coupable et se retrouve bientôt démis de ses fonctions.
Ni particulièrement sympathique, ni franchement antipathique, comme c'est souvent le cas avec les personnages au centre des récits de Coetzee, mâle hétérosexuel blanc vieillissant lambda, représentant d'une espèce qui se verrait en l'espace de quelques années sérieusement menacée d'émasculation ontologique par la peur des assauts dévastateurs d'un «Metoo», entre autres, David Lurie ne semblait visiblement pas, à l'aube du nouveau millénium, réaliser encore à quel point l'avènement d'un nouvel ordre, à la fois sur le plan moral et sociétal, entraînant par la même occasion une polarisation croissante entre individus et groupes d'appartenances différentes, pourrait avoir des conséquences directes et dramatiques sur sa vie personnelle jusque-là solidement balisée. Un ordre nouveau surgissant à ce moment-là et auquel l'impact représenté par les années Sida et la violence exponentielle d'un ultralibéralisme économique décomplexé auront probablement contribué à faire émerger.
Cette grosse déconfiture subie par le personnage au début du roman constituera en quelque sorte le paradigme à partir duquel une série d'évènements présentant une analogie possible, directe ou indirectement, avec cette disgrâce inaugurale va être déployée par l'auteur. Point de départ d'un récit dont la simplicité n'est qu'apparente, la narration s'y révèlera néanmoins toujours limpide, très incisive et réaliste, attelée surtout aux faits et à leur enchaînement, composée d'instantanés, de scènes et de dialogues dans lesquels, comme d'habitude chez l'auteur, chaque détail est révélateur, chaque mot semble avoir sa juste place et où rien ne paraît accessoire ou gratuit.
Suite donc au scandale et à la perte de son travail, David cherche un refuge provisoire auprès de Lucy, sa fille. Lucy, de son côté, mène une existence aux antipodes de celle de son père, néo-rurale et alternative, cohérente avec ses valeurs anti-bourgeoises et écologiques. Depuis le départ de sa compagne, elle vit seule dans une vielle ferme qu'elle tient à bout de bras, grâce notamment à son fort caractère et à la force inamovible de ses convictions personnelles. Installée dans une zone reculée dans les hautes terres du Cap-Oriental, dans une région particulièrement éprouvée sur le plan historique par des conflits violents entre les anciens colonisateurs et le peuple autochtone Xhosa, et où dans le cadre de la politique d'apartheid, le gouvernement sud-africain avait créé en 1959 deux bantoustans à l'intention de ceux-ci, une tension importante entre les deux principales communautés raciales, malgré la fin de l'apartheid, y subsisterait toujours de manière assez palpable, prête à s'embraser à la moindre étincelle. Une violence qui se manifestera de manière spectaculaire pendant le séjour de David, à laquelle Lucy et son père devront directement faire face, mais que la jeune femme voudra passer sous silence, préférant à son tour pâtir des traumatismes provoqués par cet épisode déplorable, par ailleurs lourd de sens pour son avenir à elle, au lieu de chercher à se défendre ouvertement contre ses agresseurs.
Témoin actif de ce qui arrive à sa fille, entre les deux les rôles d'une certaine manière s'échangeront, s'inverseront, les disgrâces se feront miroir l'une de l'autre, les interrogations et les incompréhensions aussi, les reproches entre père et fille, entre deux générations, entre deux visions du monde, entre deux manières d'envisager une reconstruction possible de soi-même s'affronteront et s'accumuleront sans qu'aucun des deux ne puisse véritablement prendre le dessus sur l'autre.
L'on a parfois le sentiment que ce qui arrive aux personnages de Coetzee, leurs réactions ou absence de réactions, ne sert pas simplement à illustrer un propos quelconque, philosophique, moral ou existentiel, à extraire un sens en particulier au détriment d'autres, voire à essayer d'établir une hiérarchie parmi ces derniers. Leurs attitudes ne sont d'ailleurs pas toujours susceptibles d'être interprétées de manière univoque. Voilà peut-être ce qu'il faut retenir avant tout de cette prose sagace et subtilement subversive. Voilà peut-être ce que ses personnages eux-mêmes devraient en fin compte apprendre de ce qui leur tombe dessus, y compris de leurs disgrâces, et qu'ils refusaient au départ d'entendre. «Tu peux penser ce que tu veux -rappelle une Lucy excédée à son père- mais les réalités sont là».
La prose de Coetzee aspirerait-elle à une sorte d'extra-lucidité qui consisterait avant tout à pointer différentes possibilités envisageables aux problématiques soulevées par l'existence, sans qu'aucune soit exclue, suggérant au contraire des symétries possibles entre elles, des liens et des résonnances multiples entre des éléments en apparence indépendants ou disparates, ici, en l'occurrence, entre les domaines du public et du privé, entre histoire collective et individuelle, entre violences infligées et violences subies, entre «crimes du passé» et «souffrance dans le présent», entre disgrâces à expier et l'élaboration possible d'un projet viable d'avenir ?
Une dizaine d'années se sont écoulées depuis la fin officielle de l'apartheid, cinq depuis l'élection de Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud (1994) – emblème s'il en est de la normalisation qu'ont censé avoir connu les relations interraciales dans le pays -, au moment où paraît le roman.
La publication de «Disgrâce» déclencherait néanmoins quelque chose d'absolument imprévisible pour son auteur, et qu'on pourrait très bien imaginer comme relevant d'une symétrie de plus, complémentaire à celles développées dans son roman, confirmant en même temps l'extrême pertinence de son propos : la mise au ban de l'écrivain lui-même par une partie considérable de l'opinion dans son pays, puis, quelque temps après sa «disgrâce» à lui, son départ volontaire et son installation définitive à l'étranger, en Australie, où J.M. Coetzee vit depuis 2002 et dont il finirait par acquérir la nationalité en 2006.
«Il n'est bon bruit que d'homme banni» (François Villon)
David Lurie pensait, quant à lui, avoir réussi à régler sa vie comme du papier à musique. Tout compte fait, «à l'aune dont on mesure le bonheur», il se croyait provisoirement «heureux».
Vraiment ?
Lurie, 52 ans, est enseignant à l'Université du Cap. Suite à une restructuration interne, il s'était vu à contrecoeur reléguer de la chaire de langues modernes qu'il occupait auparavant vers un département et un poste sans aucun intérêt pour lui, en tant que «professeur associé en communication». Auteur frustré de trois essais «passés inaperçus dans le monde universitaire», sa carrière académique ronronne entre un vague projet constamment différé d'écriture d'un opéra de chambre inspiré d'un épisode de la vie de Lord Byron («Byron en Italie») et la carotte encore une peu verte d'une retraite paisible dans quelques années.
Marié et divorcé deux fois, ex-homme-à-femmes au magnétisme sexuel sur lequel il avait pu compter à chaque occasion par le passé, avant de constater un beau jour que «le pouvoir de son charme l'avait abandonné», ses besoins affectifs et sexuels sont assouvis par une liaison avec une call-girl dont il est depuis quelque temps aux abonnés fidèles («1h30 tous les jeudis après-midi»). Cependant, à partir d'un concours de circonstances anodin, absorbé malgré lui et malgré tout le bon sens dont il se croyait pourvu, par l'idée de sortir leurs rapports de l'anonymat implicite à ce type de transaction, David se met à enquêter sur sa vie. Devenu trop envahissant et pressant aux yeux de cette femme, qui tient quant à elle à garder une barrière infranchissable entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, celle-ci lui signifie brusquement un terme définitif à leurs rapports tarifés.
L'arrêt brutal de cette relation amoureuse aseptisée, lâchant dans la nature un démon de midi désormais délesté de toutes chaînes, conduira notre héros à sa «disgrâce». Tombé dans un véritable imbroglio érotico-amoureux impliquant une de ses élèves qu'il aura réussi à séduire grâce à son rôle et à son statut plutôt qu'à - tel qu'il aurait bien aimé pouvoir l'attribuer- des attraits irrésistibles résiduels ayant pu subsister chez lui, la jeune femme en question, apparemment consentante au départ (?), à ses yeux en tout cas, finit cependant par estimer avoir été abusée sexuellement par lui et par le dénoncer publiquement. David Lurie, de son côté, refusant inexplicablement, vis-à-vis de son entourage et de ses collègues, de fournir la moindre justification à ses actes, se récusant surtout à tout procès disciplinaire interne, décide de plaider coupable et se retrouve bientôt démis de ses fonctions.
Ni particulièrement sympathique, ni franchement antipathique, comme c'est souvent le cas avec les personnages au centre des récits de Coetzee, mâle hétérosexuel blanc vieillissant lambda, représentant d'une espèce qui se verrait en l'espace de quelques années sérieusement menacée d'émasculation ontologique par la peur des assauts dévastateurs d'un «Metoo», entre autres, David Lurie ne semblait visiblement pas, à l'aube du nouveau millénium, réaliser encore à quel point l'avènement d'un nouvel ordre, à la fois sur le plan moral et sociétal, entraînant par la même occasion une polarisation croissante entre individus et groupes d'appartenances différentes, pourrait avoir des conséquences directes et dramatiques sur sa vie personnelle jusque-là solidement balisée. Un ordre nouveau surgissant à ce moment-là et auquel l'impact représenté par les années Sida et la violence exponentielle d'un ultralibéralisme économique décomplexé auront probablement contribué à faire émerger.
Cette grosse déconfiture subie par le personnage au début du roman constituera en quelque sorte le paradigme à partir duquel une série d'évènements présentant une analogie possible, directe ou indirectement, avec cette disgrâce inaugurale va être déployée par l'auteur. Point de départ d'un récit dont la simplicité n'est qu'apparente, la narration s'y révèlera néanmoins toujours limpide, très incisive et réaliste, attelée surtout aux faits et à leur enchaînement, composée d'instantanés, de scènes et de dialogues dans lesquels, comme d'habitude chez l'auteur, chaque détail est révélateur, chaque mot semble avoir sa juste place et où rien ne paraît accessoire ou gratuit.
Suite donc au scandale et à la perte de son travail, David cherche un refuge provisoire auprès de Lucy, sa fille. Lucy, de son côté, mène une existence aux antipodes de celle de son père, néo-rurale et alternative, cohérente avec ses valeurs anti-bourgeoises et écologiques. Depuis le départ de sa compagne, elle vit seule dans une vielle ferme qu'elle tient à bout de bras, grâce notamment à son fort caractère et à la force inamovible de ses convictions personnelles. Installée dans une zone reculée dans les hautes terres du Cap-Oriental, dans une région particulièrement éprouvée sur le plan historique par des conflits violents entre les anciens colonisateurs et le peuple autochtone Xhosa, et où dans le cadre de la politique d'apartheid, le gouvernement sud-africain avait créé en 1959 deux bantoustans à l'intention de ceux-ci, une tension importante entre les deux principales communautés raciales, malgré la fin de l'apartheid, y subsisterait toujours de manière assez palpable, prête à s'embraser à la moindre étincelle. Une violence qui se manifestera de manière spectaculaire pendant le séjour de David, à laquelle Lucy et son père devront directement faire face, mais que la jeune femme voudra passer sous silence, préférant à son tour pâtir des traumatismes provoqués par cet épisode déplorable, par ailleurs lourd de sens pour son avenir à elle, au lieu de chercher à se défendre ouvertement contre ses agresseurs.
Témoin actif de ce qui arrive à sa fille, entre les deux les rôles d'une certaine manière s'échangeront, s'inverseront, les disgrâces se feront miroir l'une de l'autre, les interrogations et les incompréhensions aussi, les reproches entre père et fille, entre deux générations, entre deux visions du monde, entre deux manières d'envisager une reconstruction possible de soi-même s'affronteront et s'accumuleront sans qu'aucun des deux ne puisse véritablement prendre le dessus sur l'autre.
L'on a parfois le sentiment que ce qui arrive aux personnages de Coetzee, leurs réactions ou absence de réactions, ne sert pas simplement à illustrer un propos quelconque, philosophique, moral ou existentiel, à extraire un sens en particulier au détriment d'autres, voire à essayer d'établir une hiérarchie parmi ces derniers. Leurs attitudes ne sont d'ailleurs pas toujours susceptibles d'être interprétées de manière univoque. Voilà peut-être ce qu'il faut retenir avant tout de cette prose sagace et subtilement subversive. Voilà peut-être ce que ses personnages eux-mêmes devraient en fin compte apprendre de ce qui leur tombe dessus, y compris de leurs disgrâces, et qu'ils refusaient au départ d'entendre. «Tu peux penser ce que tu veux -rappelle une Lucy excédée à son père- mais les réalités sont là».
La prose de Coetzee aspirerait-elle à une sorte d'extra-lucidité qui consisterait avant tout à pointer différentes possibilités envisageables aux problématiques soulevées par l'existence, sans qu'aucune soit exclue, suggérant au contraire des symétries possibles entre elles, des liens et des résonnances multiples entre des éléments en apparence indépendants ou disparates, ici, en l'occurrence, entre les domaines du public et du privé, entre histoire collective et individuelle, entre violences infligées et violences subies, entre «crimes du passé» et «souffrance dans le présent», entre disgrâces à expier et l'élaboration possible d'un projet viable d'avenir ?
Une dizaine d'années se sont écoulées depuis la fin officielle de l'apartheid, cinq depuis l'élection de Nelson Mandela à la présidence de l'Afrique du Sud (1994) – emblème s'il en est de la normalisation qu'ont censé avoir connu les relations interraciales dans le pays -, au moment où paraît le roman.
La publication de «Disgrâce» déclencherait néanmoins quelque chose d'absolument imprévisible pour son auteur, et qu'on pourrait très bien imaginer comme relevant d'une symétrie de plus, complémentaire à celles développées dans son roman, confirmant en même temps l'extrême pertinence de son propos : la mise au ban de l'écrivain lui-même par une partie considérable de l'opinion dans son pays, puis, quelque temps après sa «disgrâce» à lui, son départ volontaire et son installation définitive à l'étranger, en Australie, où J.M. Coetzee vit depuis 2002 et dont il finirait par acquérir la nationalité en 2006.
«Il n'est bon bruit que d'homme banni» (François Villon)