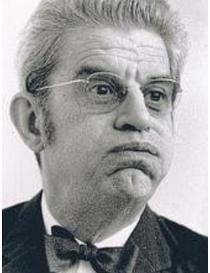Citation de colimasson
C’est donc une expérience qui est posée à l’impuissance originelle de l’être humain. L’organisme n’est pas capable de provoquer la réaction spécifique qui lui permettrait de supprimer la tension. Cette action nécessite le recours à une aide extérieure, par exemple l’apport de nourriture d’une personne que l’enfant alerte, par exemple, par ses cris, d’où, entre parenthèses, la valeur que FREUD accorde à ce moyen de communication. Mais, au-delà de ce résultat actuel, l’expérience entraîne les conséquences que vous savez, à savoir que, d’une part, l’image de l’objet qui a procuré la satisfaction est fortement investie, ainsi que le mouvement réflexe, ce qui a permis la décharge finale, de sorte que, quand apparaît à nouveau l’état de tension, les images à la fois de ce mouvement et l’objet désiré, sont réactivées, et il en résulte quelque chose d’analogue à une perception, c’est-à-dire une hallucination.
Si quelque incitation à l’acte réflexe se produit, alors une déception se produit : l’objet réel n’est pas là. Il semble qu’une telle expérience ait toujours gardé pour FREUD une fonction de prototype, puisque le sujet cherche toujours à la reproduire, et que le désir trouve là son modèle, son principe. Le processus primaire cherchant à la reproduire immédiatement par la voie de l’identité de perception et le processus secondaire médiatement par la voie d’une identité de pensée.
Je pense que c’est à cette expérience que FREUD se réfère dans le texte sur La dénégation, quand il veut mettre en évidence le caractère tout à fait irréductible de cette satisfaction originelle, et la fonction décisive qu’elle garde pour la recherche ultérieure de tous les objets, quand on ne se livre à l’épreuve de la réalité que parce que les objets autrefois cause de satisfaction réelle ont été perdus. Ce passage est souvent cité. Il est assez énigmatique et se réfère à cette expérience originelle de satisfaction, expérience réelle, vécue, mais qui a une fonction de mythe dans le développement ultérieur.
Donc originairement - ceci est très frappant - il n’y a véritablement qu’un seul principe qui joue, qui est le principe de plaisir. Si bien d’ailleurs que FREUD ne parle jamais de principe de réalité comme complément du principe de plaisir, mais seulement d’indice de réalité. Et ceci est important, parce que cela marque absolument la prévalence du principe de plaisir, prévalence qui n’est jamais atteinte, même quand des frayages entre neurones, qui permettent la retenue de la quantité, la constitution du système secondaire, du système Ψ, même ces frayages servent à la fonction primaire. Ils ne permettent en aucun cas de la dépasser. Ils favorisent même le leurre hallucinatoire. C’est dire que l’espèce de filtrage qui est réalisé par le système Ψ n’a toujours pas de valeur biologique. Répétée, la satisfaction effective, le vécu de l’épreuve de la satisfaction, répétée cette satisfaction modèle le désir humain, conduit à l’hallucination. Autrement dit, pour tâcher d’être plus clair, le désir ignore le principe même de sa satisfaction effective. Dans sa loi, en tant que désir, il ne fait aucune espèce de différence entre la satisfaction hallucinatoire et la satisfaction réelle. Et il y a vraiment là une variation dernière, et quasi humoristique, de l’hédonisme. S’il est vrai que l’organisme ne peut vouloir que son propre bien, dans la perspective de FREUD ce propre bien peut se confondre totalement avec sa destruction. Le processus primaire reste absolument prévalent. [...]
Donc ce n’est pas du tout le principe de plaisir qui se soumet, comme on l’écrit souvent, au principe de réalité, ici à l’indice de réalité. C’est, à l’inverse, l’indice de réalité qui est présenté au désir.
[Lefèvre-Pontalis]
Si quelque incitation à l’acte réflexe se produit, alors une déception se produit : l’objet réel n’est pas là. Il semble qu’une telle expérience ait toujours gardé pour FREUD une fonction de prototype, puisque le sujet cherche toujours à la reproduire, et que le désir trouve là son modèle, son principe. Le processus primaire cherchant à la reproduire immédiatement par la voie de l’identité de perception et le processus secondaire médiatement par la voie d’une identité de pensée.
Je pense que c’est à cette expérience que FREUD se réfère dans le texte sur La dénégation, quand il veut mettre en évidence le caractère tout à fait irréductible de cette satisfaction originelle, et la fonction décisive qu’elle garde pour la recherche ultérieure de tous les objets, quand on ne se livre à l’épreuve de la réalité que parce que les objets autrefois cause de satisfaction réelle ont été perdus. Ce passage est souvent cité. Il est assez énigmatique et se réfère à cette expérience originelle de satisfaction, expérience réelle, vécue, mais qui a une fonction de mythe dans le développement ultérieur.
Donc originairement - ceci est très frappant - il n’y a véritablement qu’un seul principe qui joue, qui est le principe de plaisir. Si bien d’ailleurs que FREUD ne parle jamais de principe de réalité comme complément du principe de plaisir, mais seulement d’indice de réalité. Et ceci est important, parce que cela marque absolument la prévalence du principe de plaisir, prévalence qui n’est jamais atteinte, même quand des frayages entre neurones, qui permettent la retenue de la quantité, la constitution du système secondaire, du système Ψ, même ces frayages servent à la fonction primaire. Ils ne permettent en aucun cas de la dépasser. Ils favorisent même le leurre hallucinatoire. C’est dire que l’espèce de filtrage qui est réalisé par le système Ψ n’a toujours pas de valeur biologique. Répétée, la satisfaction effective, le vécu de l’épreuve de la satisfaction, répétée cette satisfaction modèle le désir humain, conduit à l’hallucination. Autrement dit, pour tâcher d’être plus clair, le désir ignore le principe même de sa satisfaction effective. Dans sa loi, en tant que désir, il ne fait aucune espèce de différence entre la satisfaction hallucinatoire et la satisfaction réelle. Et il y a vraiment là une variation dernière, et quasi humoristique, de l’hédonisme. S’il est vrai que l’organisme ne peut vouloir que son propre bien, dans la perspective de FREUD ce propre bien peut se confondre totalement avec sa destruction. Le processus primaire reste absolument prévalent. [...]
Donc ce n’est pas du tout le principe de plaisir qui se soumet, comme on l’écrit souvent, au principe de réalité, ici à l’indice de réalité. C’est, à l’inverse, l’indice de réalité qui est présenté au désir.
[Lefèvre-Pontalis]