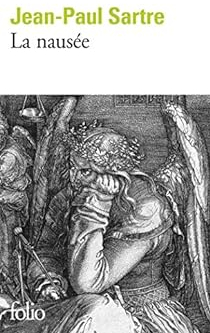>
Critique de candlemas
Après ma critique de Huis Clos et les Mouches, qui fut ma première lecture de Sartre, il me semblait intéressant de poursuivre par son premier roman, de 1938, la Nausée.
En partie autobiographique, ce roman se déroule assez clairement dans la riante ville du Havre, dans des années 30 marquées par la crise de 29 et la montée des totalitarismes. Il prend la forme d'un journal, que le narrateur aurait retrouvé, incomplet, et dont il rend compte avec un détachement qui accroit le caractère morbide de la narration.
Ce roman met en en scène, sous la forme d'un journal, un homme ayant vécu, voyagé, et qui, n'y trouvant plus sens, se fait rat de bibliothèque, contraint au voyage immobile par un comportement d'anorexique mental. Roquentin, confronté à son vide intérieur et ayant cessé de compenser par un course extérieure, prend conscience du non-sens de sa vie, de la vie, et en conçoit... La nausée, sentiment morbide qui l'éloigne peu à peu de ses semblables et de lui-même, un peu comme dans le Horla ou la Métamorphose. Au départ donc, ce roman semble s'inspirer de l'univers de Kafka, du dégoût de Céline, et préfigurer l'absurde de Ionesco.
Mais La Nausée est bien avant tout l'une des premières oeuvres de Sartre, et donc l'un des tous premiers manifestes existentialistes, version négative de l'Etre et le Néant. Grâce à sa Nausée, Roquentin prend conscience du vide d'une vie d'apparence -celle vécu par les bourgeois honnis qui l'entourent-, mais aussi de la liberté fondamentale que constitue cette prise de conscience même. Si ni sa relation avec Anny ni ses échanges intellectuels avec l'Autodidacte -nouvelles distractions extérieures sans doute ? - ne parviennent à l'extraire de sa Nausée, c'est finalement l'écoute d'un morceau de jazz à la terrasse d'un café, et la vision d'un humain n'existant qu'à travers l'acte créatif, qui semblent consister en fin d'ouvrage un remède. Ainsi, si les "salauds" hédonistes sont définitivement exclus des espoirs sartriens, une autre forme d'humanisme semble se dessiner en fin de roman. le lecteur en sort provisoirement soulagé, car sentant bien que la réponse est un peu courte, et dans l'obligation morale de poursuivre le chemin philosophique de Sartre das ses oeuvres ultérieures, ou de bifurquer vers d'autres recherches de sens.
En conclusion, la Nausée rend compte d'une première intuition philosophique -mais déjà creusée depuis des années par l'auteur-, par le ressenti. Se situant dans une veine "dépressive" de l'expression littéraire reliant Céline à Houellebecq, l'ouvrage semble introduire la réflexion de Sartre d'abord par l'effacement des cadres convenus, et laisse le lecteur en suspens au bord du vide, avec un simple airbag dans les bras. A la différence d'ouvrages postérieurs plus intellectuellement construits, Sartre cherche à montrer sans ménagement, dans un style sobre et faussement détaché, mais surtout par le partage de perceptions et de sensations vraies, la contingence brute des choses et de l'être. Bien qu'on sente l'intention "professorale" derrière cette démonstration, il parvient, avec des mots simples et des images concrètes, non dépourvus d'une poésie empruntant à la fois au spleen Baudelairien et au surréalisme hallucinogène, à transmettre ce ressenti, et par suite, à faire partager sa quête de sens -et de non sens- au lecteur.
Comme pour de nombreux autres lecteurs, ce n'est pas mon ouvrage préféré de Sartre, parce que son théâtre est plus percutant et ses oeuvres ultérieures plus précises quant à sa pensée philosophique ; mais j'ai néanmoins apprécié cette version en négatif de l'Etre et le Néant, ainsi que son écriture romanesque, proche de Kafka et Huysmans.
En partie autobiographique, ce roman se déroule assez clairement dans la riante ville du Havre, dans des années 30 marquées par la crise de 29 et la montée des totalitarismes. Il prend la forme d'un journal, que le narrateur aurait retrouvé, incomplet, et dont il rend compte avec un détachement qui accroit le caractère morbide de la narration.
Ce roman met en en scène, sous la forme d'un journal, un homme ayant vécu, voyagé, et qui, n'y trouvant plus sens, se fait rat de bibliothèque, contraint au voyage immobile par un comportement d'anorexique mental. Roquentin, confronté à son vide intérieur et ayant cessé de compenser par un course extérieure, prend conscience du non-sens de sa vie, de la vie, et en conçoit... La nausée, sentiment morbide qui l'éloigne peu à peu de ses semblables et de lui-même, un peu comme dans le Horla ou la Métamorphose. Au départ donc, ce roman semble s'inspirer de l'univers de Kafka, du dégoût de Céline, et préfigurer l'absurde de Ionesco.
Mais La Nausée est bien avant tout l'une des premières oeuvres de Sartre, et donc l'un des tous premiers manifestes existentialistes, version négative de l'Etre et le Néant. Grâce à sa Nausée, Roquentin prend conscience du vide d'une vie d'apparence -celle vécu par les bourgeois honnis qui l'entourent-, mais aussi de la liberté fondamentale que constitue cette prise de conscience même. Si ni sa relation avec Anny ni ses échanges intellectuels avec l'Autodidacte -nouvelles distractions extérieures sans doute ? - ne parviennent à l'extraire de sa Nausée, c'est finalement l'écoute d'un morceau de jazz à la terrasse d'un café, et la vision d'un humain n'existant qu'à travers l'acte créatif, qui semblent consister en fin d'ouvrage un remède. Ainsi, si les "salauds" hédonistes sont définitivement exclus des espoirs sartriens, une autre forme d'humanisme semble se dessiner en fin de roman. le lecteur en sort provisoirement soulagé, car sentant bien que la réponse est un peu courte, et dans l'obligation morale de poursuivre le chemin philosophique de Sartre das ses oeuvres ultérieures, ou de bifurquer vers d'autres recherches de sens.
En conclusion, la Nausée rend compte d'une première intuition philosophique -mais déjà creusée depuis des années par l'auteur-, par le ressenti. Se situant dans une veine "dépressive" de l'expression littéraire reliant Céline à Houellebecq, l'ouvrage semble introduire la réflexion de Sartre d'abord par l'effacement des cadres convenus, et laisse le lecteur en suspens au bord du vide, avec un simple airbag dans les bras. A la différence d'ouvrages postérieurs plus intellectuellement construits, Sartre cherche à montrer sans ménagement, dans un style sobre et faussement détaché, mais surtout par le partage de perceptions et de sensations vraies, la contingence brute des choses et de l'être. Bien qu'on sente l'intention "professorale" derrière cette démonstration, il parvient, avec des mots simples et des images concrètes, non dépourvus d'une poésie empruntant à la fois au spleen Baudelairien et au surréalisme hallucinogène, à transmettre ce ressenti, et par suite, à faire partager sa quête de sens -et de non sens- au lecteur.
Comme pour de nombreux autres lecteurs, ce n'est pas mon ouvrage préféré de Sartre, parce que son théâtre est plus percutant et ses oeuvres ultérieures plus précises quant à sa pensée philosophique ; mais j'ai néanmoins apprécié cette version en négatif de l'Etre et le Néant, ainsi que son écriture romanesque, proche de Kafka et Huysmans.