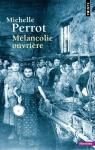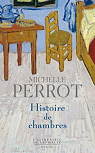Critiques de Michelle Perrot (137)
Mélancolie ouvrière: "Je suis entrée comme apprentie, j'avais alors douze ans..." (Lucie Baud)
Michelle Perrot
Michelle Perrot
Curieusement, mon avant-dernière chronique portait sur la quête de Sandrine Treiner pour éviter que son héroïne, Manya Schwartzman, ne sombre dans l'oubli, dans l'ouvrage présent, c'est au tour de Michelle Perrot pour se lancer à la recherche d'une héroïne de la lutte ouvrière, Lucie Baud, pour éviter que son nom et efforts ne soient à jamais oubliés.
Avant de continuer, permettez-moi, Madame, de vous souhaiter un joyeux anniversaire !!! Il se trouve que Michelle Perrot a fêté hier ses 90 ans !
Indépendamment de cet heureux événement, il convient de souligner que l'auteure est une historienne à réputation des plus solides : professeure éméritée d'histoire à l'université de Paris-Diderot et auteure d'une impressionnante série d'ouvrages historiques et littéraires. Dans sa volumineuse production d'écrits, la grande constante est son souci pour les conditions de travail et de vie des simples ouvriers, et comme féministe, surtout celles des ouvrières au siècle dernier.
C'est dans cette logique que s'inscrit son "Mélancolie ouvrière", dans lequel elle cherche à tout savoir sur la vie et l'oeuvre de Lucie Baud, afin de répondre à la question : est-ce qu'une ouvrière méconnue peut être considérée comme une héroïne ?
Lucie Baud, née Martin à Saint-Pierre-de-Mésage près de Grenoble en 1870, est devenue - tout comme sa mère - à 12 ans, ouvrière dans une usine de soie. À 21 ans elle épousa le garde-champêtre, Pierre Baud de 20 ans son aîné, avec qui elle a eu 3 enfants : Alexandrine en 1892, Pierre Auguste en 1897 et Marguerite en 1900. Écoeurée par les conditions lamentables de travail des ouvrières dans les usines de soie, elle organise des manifestations et grèves. En 1902, après la mort de son garde-champêtre, elle fonda le "Syndicat des ouvriers et ouvrières en soierie du canton de Vizille" et est, à ce titre, invitée au 6ème Congrès national ouvrier de l'industrie textile, en 1904, à Reims. Ce sera l'unique voyage de sa vie et le comble, en tant que femme, on n'accorde même pas la parole à ce "météore du mouvement ouvrier" lors de ce congrès !
En 1906, elle fait une tentative de suicide, en se tirant 3 coups de revolver dans la mâchoire, ce qui la défigure évidemment sérieusement. Sept ans plus tard, en 1913, elle meurt. Elle venait juste d'avoir 43 ans.
On a des difficultés à s'imaginer les conditions de travail de ces pauvres ouvrières de la soie : des journées de dur labeur de 12 à 13 heures, qui commencèrent à 6 heures du matin et qui se terminèrent le soir vers 19 heures, "rythmées par des pauses strictes pour les repas", une soupe et un plat qui ne comporte que rarement de la viande. Avec des nouvelles machineries (importées des États-Unis), le tempo du travail s'accélérait et " avec chaque perfectionnement de matériel, c'était une nouvelle diminution de salaire". Il fallait bien que les riches industriels. résidant à Lyon ou Paris, amortissent leur investissement ! Les ateliers étaient mal ventilés et les poussières de soie étaient souvent à l'origine de maladies pulmonaires. L'hygiène était quasi inexistante et "les cabinets d'aisances minables". En plus, ces jeunes femmes et filles avaient le grand bonheur d'être constamment surveillées par des contrôleurs hommes, bien entendu, qui pouvaient intervenir à tout moment et distribuer des punitions à leur guise. Qu'il y ait eu toutes sortes d'abus sexuels n'étonnera personne, bien que Michelle Perrot soit assez discrète à ce sujet.
Et comme ces pauvres Françaises ne rapportaient pas suffisamment de sous, les industriels importèrent des Italiennes, qu'ils logaient dans der dortoirs insalubres aux bons soins de religieuses. On leur avait promis un voyage de retour par an, mais une fois arrivées dans le bagne de soie, au bout de 3 ans, elles ne pouvaient même pas rembourser le prix du voyage initial, prélevé systématiquement sur leurs maigres salaires !
À la question de savoir si une jeune ouvrière, avec peu d'instruction, qui se rebelle pour ses consoeurs peut être considérée comme une héroïne, je crois que la réponse est un massif OUI ! En fin de volume, Michelle Perrot, publie un texte de Lucie Baud de 1908, intitulé "Les tisseuses de soie dans la région de Vizille". Un document de 12 pages impressionnant par sa lucidité, bon sens et intelligence.
Grâce aux travaux de notre historienne, une rue à Vizille porte dorénavant le nom de cette "Pasionaria" syndicaliste.
En même temps que cet opus, j'ai commandé de Michelle Perrot "Les femmes ou les silences de l'histoire". Un ouvrage de 494 pages en édition poche (et en petits caractères), à propos d'un sujet sur lequel, en tant qu'homme, il me reste encore énormément à apprendre. Donc, n'attendez pas ma chronique demain matin à l'aube.
En attendant, je vous livre une petite citation de notre grande historienne : "La nature est-elle jamais en accord avec nos sentiments ? Il fait toujours beau les jours de deuil où l'on a du chagrin" (page 42).
Avant de continuer, permettez-moi, Madame, de vous souhaiter un joyeux anniversaire !!! Il se trouve que Michelle Perrot a fêté hier ses 90 ans !
Indépendamment de cet heureux événement, il convient de souligner que l'auteure est une historienne à réputation des plus solides : professeure éméritée d'histoire à l'université de Paris-Diderot et auteure d'une impressionnante série d'ouvrages historiques et littéraires. Dans sa volumineuse production d'écrits, la grande constante est son souci pour les conditions de travail et de vie des simples ouvriers, et comme féministe, surtout celles des ouvrières au siècle dernier.
C'est dans cette logique que s'inscrit son "Mélancolie ouvrière", dans lequel elle cherche à tout savoir sur la vie et l'oeuvre de Lucie Baud, afin de répondre à la question : est-ce qu'une ouvrière méconnue peut être considérée comme une héroïne ?
Lucie Baud, née Martin à Saint-Pierre-de-Mésage près de Grenoble en 1870, est devenue - tout comme sa mère - à 12 ans, ouvrière dans une usine de soie. À 21 ans elle épousa le garde-champêtre, Pierre Baud de 20 ans son aîné, avec qui elle a eu 3 enfants : Alexandrine en 1892, Pierre Auguste en 1897 et Marguerite en 1900. Écoeurée par les conditions lamentables de travail des ouvrières dans les usines de soie, elle organise des manifestations et grèves. En 1902, après la mort de son garde-champêtre, elle fonda le "Syndicat des ouvriers et ouvrières en soierie du canton de Vizille" et est, à ce titre, invitée au 6ème Congrès national ouvrier de l'industrie textile, en 1904, à Reims. Ce sera l'unique voyage de sa vie et le comble, en tant que femme, on n'accorde même pas la parole à ce "météore du mouvement ouvrier" lors de ce congrès !
En 1906, elle fait une tentative de suicide, en se tirant 3 coups de revolver dans la mâchoire, ce qui la défigure évidemment sérieusement. Sept ans plus tard, en 1913, elle meurt. Elle venait juste d'avoir 43 ans.
On a des difficultés à s'imaginer les conditions de travail de ces pauvres ouvrières de la soie : des journées de dur labeur de 12 à 13 heures, qui commencèrent à 6 heures du matin et qui se terminèrent le soir vers 19 heures, "rythmées par des pauses strictes pour les repas", une soupe et un plat qui ne comporte que rarement de la viande. Avec des nouvelles machineries (importées des États-Unis), le tempo du travail s'accélérait et " avec chaque perfectionnement de matériel, c'était une nouvelle diminution de salaire". Il fallait bien que les riches industriels. résidant à Lyon ou Paris, amortissent leur investissement ! Les ateliers étaient mal ventilés et les poussières de soie étaient souvent à l'origine de maladies pulmonaires. L'hygiène était quasi inexistante et "les cabinets d'aisances minables". En plus, ces jeunes femmes et filles avaient le grand bonheur d'être constamment surveillées par des contrôleurs hommes, bien entendu, qui pouvaient intervenir à tout moment et distribuer des punitions à leur guise. Qu'il y ait eu toutes sortes d'abus sexuels n'étonnera personne, bien que Michelle Perrot soit assez discrète à ce sujet.
Et comme ces pauvres Françaises ne rapportaient pas suffisamment de sous, les industriels importèrent des Italiennes, qu'ils logaient dans der dortoirs insalubres aux bons soins de religieuses. On leur avait promis un voyage de retour par an, mais une fois arrivées dans le bagne de soie, au bout de 3 ans, elles ne pouvaient même pas rembourser le prix du voyage initial, prélevé systématiquement sur leurs maigres salaires !
À la question de savoir si une jeune ouvrière, avec peu d'instruction, qui se rebelle pour ses consoeurs peut être considérée comme une héroïne, je crois que la réponse est un massif OUI ! En fin de volume, Michelle Perrot, publie un texte de Lucie Baud de 1908, intitulé "Les tisseuses de soie dans la région de Vizille". Un document de 12 pages impressionnant par sa lucidité, bon sens et intelligence.
Grâce aux travaux de notre historienne, une rue à Vizille porte dorénavant le nom de cette "Pasionaria" syndicaliste.
En même temps que cet opus, j'ai commandé de Michelle Perrot "Les femmes ou les silences de l'histoire". Un ouvrage de 494 pages en édition poche (et en petits caractères), à propos d'un sujet sur lequel, en tant qu'homme, il me reste encore énormément à apprendre. Donc, n'attendez pas ma chronique demain matin à l'aube.
En attendant, je vous livre une petite citation de notre grande historienne : "La nature est-elle jamais en accord avec nos sentiments ? Il fait toujours beau les jours de deuil où l'on a du chagrin" (page 42).
En cette période de confinement, dont nous nous extirpons peu à peu, je vous invite à visiter la chambre, lieu de confinement par excellence. La chambre ? Mais quelle chambre, il y en a tant ? Et la chambre de qui ?
Histoire de chambres, est un bijou d'érudition, une véritable encyclopédie du lieu visitée dans le prisme croisé de l'histoire, de la société et de la littérature.
Dans ce livre, Michelle Perrot, historienne, nous invite à visiter l'intimité de quelques chambres, de personnes célèbres et d'autres anonymes, des rois jusqu'aux ouvriers les plus modestes, sans oublier les cellules les plus recrues, prisons ou monastères ou bien encore les chambres d'hôtel, du plus modeste au palace...
Nous découvrons la chambre dans tout ce qu'elle est capable de recueillir, de produire et d'imaginer : la chambre où l'on vit, où l'on se retire, où l'on s'abandonne, où l'on médite, où l'on lit, où l'on prie, où l'on garde ses secrets, où l'on écrit, où l'on est enfermé, où l'on naît, où l'on fait l'amour, où les femmes accouchent, où l'on agonie, où l'on meurt, ah j'oubliais : où il arrive de dormir aussi...
Noblesse oblige, le livre s'ouvre sur la chambre de Louis XIV. Nous savons tous qu'une véritable cour se bousculait tous les matins pour assister au lever du Roi Soleil dans sa chambre. Nous découvrons, sans surprise que tout ceci était un peu une mise en scène, ce n'est pas vraiment à cet endroit qu'il dormait ou qu'il honorait ses maîtresses. Le temps d'une nuit, entre le crépuscule solaire et l'aube publique, il lui arrivait d'ailleurs de visiter maintes chambres et maints lits. C'est dur la vie d'un roi !
Sur le registre des chambres célèbres, j'ai préféré avec émotion visiter celle de Marcel Proust ou encore celle de George Sand. L'auteure nous invite à assister à ce lieu dont ces deux écrivains parmi tant d'autres ont fait un véritable territoire de création, nous vivons à ces endroits respectifs aussi leurs derniers instants. C'est particulièrement touchant ; ainsi vient notamment Céleste, témoin fidèle et dévouée des tourments et des joies de l'auteur d'À la recherche du temps perdu, de son agonie et sa mort aussi...
Zola, quant à lui, nous invite tantôt dans les chambres des plus modestes, des chambres ouvrières, taudis surpeuplés, dans Germinal ou L'Assommoir, tantôt dans des chambres plus luxueuses, comme dans La Curée, tantôt dans des chambres de prostituées, comme dans Nana... L'oeuvre de Zola, et notamment la fresque des Rougon-Macquart, est peuplée d'une multitude de chambres, théâtres d'émotions, de passions et de violences.
Mais la chambre a vécu au fil de l'histoire et des conditions sociales, maintes péripéties. Elle n'a pas toujours été ce lieu de confinement, ce lieu intime. L'intimité est dédiée tout d'abord à l'aristocratie et à la bourgeoisie. Les catégories les plus modestes, agricoles, ouvrières, dorment ensemble dans la même chambre jusqu'à une époque très tardive, parfois jusqu'au siècle dernier...
La chambre conjugale est un îlot moderne au regard de l'histoire de notre société occidentale. Elle peut être le lieu où le couple se retrouve, mais ne dort pas forcément à cet endroit...
La chambre, c'est aussi un lit, ce lieu secret à part entière. D'ailleurs, nous apprend Michelle Perrot, la première apparition d'un lit sur une scène théâtrale fit scandale. Il y a des géométries variables sur le sujet selon l'époque, la condition sociale que j'évoquais à l'instant, selon les pays... La chambre au Japon n'a pas le même degré d'intimité qu'une chambre française, allemande, ou américaine...
À ce sujet, je voudrais vous évoquer quelque chose d'original, de typique à une Bretagne qui m'est chère, le fameux lit-clos évoqué dans le livre de Michelle Perrot. Les bretons d'ici et ceux qui ont visité des écomusées lors de séjours estivaux en Bretagne savent de quoi je veux parler. Un lit enfermé, étroit, où il était difficile d'étaler son corps, quoique les bretons à cette époque n'étaient pas très grands... Ma grand-mère m'avait parlé de son expérience réjouissante... Mais je me souviens d'une femme toute petite... Aujourd'hui, dans beaucoup d'anciennes maisons bretonnes, les lits-clos sont devenus des armoires où ranger le linge ou bien qui servent de vaisseliers...
Homme ou femme, nous dit Michelle Perrot, l'approche de la chambre n'est pas la même. Elle accueille le propos de Virginia Wolf qui exprime un voeu ardent à juste raison, avoir une chambre à soi.
Voilà, je vous laisse découvrir la suite... J'ai surtout pioché ici et là quelques propos qui m'ont séduit afin de vous mettre en appétit. J'ai été époustouflé par la puissance de l'érudition qui se dégage de cet essai.
Désormais, dans notre société, on ne naît plus, ou très rarement dans la chambre d'une maison. La mort, c'est une autre histoire... Disons que les défunts ne sont plus veillés dans leur chambre même si c'est à cet endroit qu'ils ont poussé leur dernier soupir... On les expédie aussitôt dans des chambres mortuaires prévus à cet effet. Étrange société qui évacue du lieu intime ces intervalles extrêmes de nos vies, la naissance et la mort...
Que reste-t-il des chambres d'antan ? Que devient la chambre de maintenant, de demain ? questionne l'auteure. J'ai aimé l'une des phrases ultimes de sa conclusion : « la chambre est la possibilité d'une île ».
Derrière l'érudition foisonnante du texte, il y a aussi une poésie qui dit les secrets d'une chambre, son âme fugitive, les fissures qui se promènent sur un mur, un lieu qui tangue dans la solitude, l'indiscrétion d'un trou de serrure, l'éphémère, l'inconnaissable, peut-être simplement un territoire à la dérive entre quatre murs...
Histoire de chambres, est un bijou d'érudition, une véritable encyclopédie du lieu visitée dans le prisme croisé de l'histoire, de la société et de la littérature.
Dans ce livre, Michelle Perrot, historienne, nous invite à visiter l'intimité de quelques chambres, de personnes célèbres et d'autres anonymes, des rois jusqu'aux ouvriers les plus modestes, sans oublier les cellules les plus recrues, prisons ou monastères ou bien encore les chambres d'hôtel, du plus modeste au palace...
Nous découvrons la chambre dans tout ce qu'elle est capable de recueillir, de produire et d'imaginer : la chambre où l'on vit, où l'on se retire, où l'on s'abandonne, où l'on médite, où l'on lit, où l'on prie, où l'on garde ses secrets, où l'on écrit, où l'on est enfermé, où l'on naît, où l'on fait l'amour, où les femmes accouchent, où l'on agonie, où l'on meurt, ah j'oubliais : où il arrive de dormir aussi...
Noblesse oblige, le livre s'ouvre sur la chambre de Louis XIV. Nous savons tous qu'une véritable cour se bousculait tous les matins pour assister au lever du Roi Soleil dans sa chambre. Nous découvrons, sans surprise que tout ceci était un peu une mise en scène, ce n'est pas vraiment à cet endroit qu'il dormait ou qu'il honorait ses maîtresses. Le temps d'une nuit, entre le crépuscule solaire et l'aube publique, il lui arrivait d'ailleurs de visiter maintes chambres et maints lits. C'est dur la vie d'un roi !
Sur le registre des chambres célèbres, j'ai préféré avec émotion visiter celle de Marcel Proust ou encore celle de George Sand. L'auteure nous invite à assister à ce lieu dont ces deux écrivains parmi tant d'autres ont fait un véritable territoire de création, nous vivons à ces endroits respectifs aussi leurs derniers instants. C'est particulièrement touchant ; ainsi vient notamment Céleste, témoin fidèle et dévouée des tourments et des joies de l'auteur d'À la recherche du temps perdu, de son agonie et sa mort aussi...
Zola, quant à lui, nous invite tantôt dans les chambres des plus modestes, des chambres ouvrières, taudis surpeuplés, dans Germinal ou L'Assommoir, tantôt dans des chambres plus luxueuses, comme dans La Curée, tantôt dans des chambres de prostituées, comme dans Nana... L'oeuvre de Zola, et notamment la fresque des Rougon-Macquart, est peuplée d'une multitude de chambres, théâtres d'émotions, de passions et de violences.
Mais la chambre a vécu au fil de l'histoire et des conditions sociales, maintes péripéties. Elle n'a pas toujours été ce lieu de confinement, ce lieu intime. L'intimité est dédiée tout d'abord à l'aristocratie et à la bourgeoisie. Les catégories les plus modestes, agricoles, ouvrières, dorment ensemble dans la même chambre jusqu'à une époque très tardive, parfois jusqu'au siècle dernier...
La chambre conjugale est un îlot moderne au regard de l'histoire de notre société occidentale. Elle peut être le lieu où le couple se retrouve, mais ne dort pas forcément à cet endroit...
La chambre, c'est aussi un lit, ce lieu secret à part entière. D'ailleurs, nous apprend Michelle Perrot, la première apparition d'un lit sur une scène théâtrale fit scandale. Il y a des géométries variables sur le sujet selon l'époque, la condition sociale que j'évoquais à l'instant, selon les pays... La chambre au Japon n'a pas le même degré d'intimité qu'une chambre française, allemande, ou américaine...
À ce sujet, je voudrais vous évoquer quelque chose d'original, de typique à une Bretagne qui m'est chère, le fameux lit-clos évoqué dans le livre de Michelle Perrot. Les bretons d'ici et ceux qui ont visité des écomusées lors de séjours estivaux en Bretagne savent de quoi je veux parler. Un lit enfermé, étroit, où il était difficile d'étaler son corps, quoique les bretons à cette époque n'étaient pas très grands... Ma grand-mère m'avait parlé de son expérience réjouissante... Mais je me souviens d'une femme toute petite... Aujourd'hui, dans beaucoup d'anciennes maisons bretonnes, les lits-clos sont devenus des armoires où ranger le linge ou bien qui servent de vaisseliers...
Homme ou femme, nous dit Michelle Perrot, l'approche de la chambre n'est pas la même. Elle accueille le propos de Virginia Wolf qui exprime un voeu ardent à juste raison, avoir une chambre à soi.
Voilà, je vous laisse découvrir la suite... J'ai surtout pioché ici et là quelques propos qui m'ont séduit afin de vous mettre en appétit. J'ai été époustouflé par la puissance de l'érudition qui se dégage de cet essai.
Désormais, dans notre société, on ne naît plus, ou très rarement dans la chambre d'une maison. La mort, c'est une autre histoire... Disons que les défunts ne sont plus veillés dans leur chambre même si c'est à cet endroit qu'ils ont poussé leur dernier soupir... On les expédie aussitôt dans des chambres mortuaires prévus à cet effet. Étrange société qui évacue du lieu intime ces intervalles extrêmes de nos vies, la naissance et la mort...
Que reste-t-il des chambres d'antan ? Que devient la chambre de maintenant, de demain ? questionne l'auteure. J'ai aimé l'une des phrases ultimes de sa conclusion : « la chambre est la possibilité d'une île ».
Derrière l'érudition foisonnante du texte, il y a aussi une poésie qui dit les secrets d'une chambre, son âme fugitive, les fissures qui se promènent sur un mur, un lieu qui tangue dans la solitude, l'indiscrétion d'un trou de serrure, l'éphémère, l'inconnaissable, peut-être simplement un territoire à la dérive entre quatre murs...
Dans son Histoire des femmes, Michelle Perrot aborde plusieurs aspects de la condition féminine à travers les âges, retraçant le combat des femmes pour conquérir une égalité avec les hommes encore bien fragile…
Peu de sources, les femmes n’écrivent pas ou très peu, on parle peu d’elles, leur rôle dans la cité reste très longtemps limité. Quand elles possèdent un savoir, elles sont dangereuses, vite traitées de sorcières…
Leur destinée c’est la famille, le mariage et assurer une descendance, de préférence mâle. Et la séduction mais qui elle aussi peut mettre en péril la société. Leur travail consiste dans les tâches ménagères ou leur organisation, la cuisine, les enfants à élever, la religion à conserver. Bien que la religion, dans les couvents, ait parfois été une possibilité d’émancipation. Dans les classes sociales supérieures, elles ont un rôle de représentation.
Pourtant les femmes ont toujours travaillé dur, à la maison, dans les champs, à la ferme, à l’usine, elles ont été artistes, écrivains parfois, peu à peu enseignantes, soignantes, employées de bureau. La première guerre mondiale, privant le pays des hommes, leur a permis d’accéder à des métiers qui r étaient réservés à ces derniers. De plus en plus elles se sont engagées dans la lutte syndicale, voir politique, mais n’ont conquis le droit de vote que tardivement.
Féministes pour défendre leurs droits et le libre usage de leur corps, leur grande conquête a été la contraception. Mais aujourd’hui encore, toutes n’ont pas acquis cette liberté, et la libération des femmes demeure une histoire à poursuivre…
Un livre passionnant, accompagné d’un CD des émissions de France Culture dont il est issu, très agréables à écouter également. Michelle Perrot évoque également quelques grandes figures de femmes qui ont permis à leur cause d’avancer. Et nous livre de nombreuses pistes pour nous permettre d’aller plus loin.
Peu de sources, les femmes n’écrivent pas ou très peu, on parle peu d’elles, leur rôle dans la cité reste très longtemps limité. Quand elles possèdent un savoir, elles sont dangereuses, vite traitées de sorcières…
Leur destinée c’est la famille, le mariage et assurer une descendance, de préférence mâle. Et la séduction mais qui elle aussi peut mettre en péril la société. Leur travail consiste dans les tâches ménagères ou leur organisation, la cuisine, les enfants à élever, la religion à conserver. Bien que la religion, dans les couvents, ait parfois été une possibilité d’émancipation. Dans les classes sociales supérieures, elles ont un rôle de représentation.
Pourtant les femmes ont toujours travaillé dur, à la maison, dans les champs, à la ferme, à l’usine, elles ont été artistes, écrivains parfois, peu à peu enseignantes, soignantes, employées de bureau. La première guerre mondiale, privant le pays des hommes, leur a permis d’accéder à des métiers qui r étaient réservés à ces derniers. De plus en plus elles se sont engagées dans la lutte syndicale, voir politique, mais n’ont conquis le droit de vote que tardivement.
Féministes pour défendre leurs droits et le libre usage de leur corps, leur grande conquête a été la contraception. Mais aujourd’hui encore, toutes n’ont pas acquis cette liberté, et la libération des femmes demeure une histoire à poursuivre…
Un livre passionnant, accompagné d’un CD des émissions de France Culture dont il est issu, très agréables à écouter également. Michelle Perrot évoque également quelques grandes figures de femmes qui ont permis à leur cause d’avancer. Et nous livre de nombreuses pistes pour nous permettre d’aller plus loin.
Lecture des plus éclairantes sur L Histoire pénitentiaire en France....
En tout premier lieu, tous mes remerciements à Babelio et aux Presses Universitaires de Rennes de m'avoir envoyé ce livre d'entretiens d'une historienne, Michelle Perrot, dont je suis depuis très longtemps les travaux et les recherches pluridisciplinaires sur L' hitoire des femmes.
J'avoue que je méconnaissais totalement son immense engagement sur des chantiers de réflexion concernant l'univers pénitentiaire et les " modèles d'enfermement...aux côtés de Michel Foucault et Robert Badinter....et ensuite, indépendamment...
Ces entretiens dirigés par Frédéric Chauvaud, lui-même professeur d'Histoire contemporaine à l'université de Poitiers et rédacteur de plusieurs ouvrages sur la justice pénale, questionne Michelle Perrot, aborde une multitude de thématiques, faisant se croiser toutes les dusciplines: L Histoire, le Droit, la Sociologie, la Ohilosophie, la Psychologie, L Histoire politique et même l'Architecture et la Littérature !
Ces entretiens débutent par des questionnements et des développements sur la base d' un texte fondateur de Michel Foucault, " Surveiller et punir", publié en 1975...
J'appréhendais quelque peu une aridité et un jargon abscons qui freineraient la lecture de ce dialogue...Très heureusement surprise ; rien de tout cela; l'ensemble est clairement rendu vivant et abordable...tout en nous proposant une large réflexion sur le système pénitentiaire français, son histoire, les chercheurs ayant travaillé sur sa transformation nécessaire ( dont ma découverte de cet étonnant Monsieur
Bentham !)- Je transcris un extrait pour mettre en avant son idée qui passait par une réflexion "architecturale"...
"À l'ombre des hauts murs
F.C :Jeremy Bentham, qui naquit à Londres au milieu du XVIIIe siècle, auquel vous vous êtes intéressé, notamment dans " L'Oeil du pouvoir " qui est un entretien avec Michel Foucault, a joué un rôle important, hier comme aujourd'hui, dans les réflexions sur la surveillance. (...) le vrai changement, a confié, en 1973, Michel Foucault dans un entretien publié dans " Pro Justitia.Revue politique de droit" , c'est "l'invention du panoptisme " qui est devenu, selon lui , très tôt, une réalité juridique et institutionnelle, mais aussi une " invention technologique", dont la prison est une pièce maîtresse du système pénal.
M.P : Dans " Surveiller et punir" , un chapitre s'appelle le panoptique de Jeremy Bentham qui avait été occulté ou négligé. (...)
La version originale, en anglais, intitulée "Panoption" , a été publiée en 1786.(...)
Il veut s'adresser aux révolutionnaires, en particulier à Condorcet, La Fayette et La Rochefoucauld- Liancourt, en quête de modèle de prison et leur dit à peu près :" Moi j'ai une solution , un modèle architectural qui consiste à faire surveiller un très grand nombre de gens par un tout petit nombre."
Ce livre paraissant " petit" (115 pages) est d'une densité incroyable...
Il est constitué de deux parties distinctes : le premier volet concerne L Histoire pénitentiaire en France
( avec qq comparatifs avec d'autres pays, dont les États-unis), incluant questionnements, et doutes sur " l'utilité et l'efficacité " des prisons...
Dans le second volet, nos deux historiens abordent le phénomène du" Fait-divers ", phénomène qui continue de fasciner jusqu'à inspirer les plus grands écrivains. le " Fait-divers" reflet d'une société, de ses ombres,objet d'étude ambivalent, car il nous interroge sur ce qui peut être inavouable en chaque citoyen !
"Je crois que chaque fait-divers, à la fois parce qu'il est étrange et marginal, passionne et renvoie à soi, à sa part d'ombre et de ce que l'on pourrait faire.Et chacun de se demander: "Suis-je capable de tuer ? Je pense que j'en suis incapable, mais dans de telles circonstances, l'aurais-je fait ?"
Ceci amène à s'interroger et à envisager des actions que l'on n'oserait pas imaginer ni penser.Le fait-divers est une brèche dans la parole convenue dans la bien-pensance.Il atteste de la présence du mal."
Texte accompagné d'une dizaine d'illustrations dont la majorité de dessins fin 19e et 20e , très évocateurs,proviennent des collections du Musée Carnavalet ...
Lecture passionnante tant par le parcours d'historienne et de chercheuse pluridisciplinaire de Michelle Perrot, parcours des plus impressionnants que par les " bilans" , " mises à plat" très larges de l'histoire des prisons et les réalités sociologiques du
" Fait- divers"...
Je ne résiste pas à un dernier extrait qui fait rentrer la littérature dans l'histoire du " Fait-divers", source éminemment "romanesque, qui a aussi ses détracteurs !
"Les écrivains, moralistes et censeurs ne sont pas unanimes. Les critiques les plus vives datent du XIX e siècle. Pour Barbey d'Aurevilly, le fait-divers est appelé à devenir la "vermine" des journaux qu'il rongera de l'intérieur jusqu'à leur anéantissement. Mais Jean- Paul Sartre fera explicitement référence aux soeurs Papin (...)Le fait-divers est entré en Littérature. Flaubert a puisé la trame de Madame Bovary dans "La Gazette des tribunaux ", Mauriac s'est inspiré d'un fait-divers bordelais pour rédiger
" Thérèse Desqueyroux".Devenue source d'inspiration, l'importance romanesque du fait-divers ne cesse de croître comme en témoignent " L'Adversaire " ou " La Serpe", les romans d'Emmanuel Carrère et Philippe Jaenada...
Non seulement le fait divers fait partie intégrante de la communication, mais sélectionné et construit, il renseigne sur ses usages et les préoccupations d'une époque, et parfois sur les conditions de vie et les difficultés d'une existence de misère. "
En tout premier lieu, tous mes remerciements à Babelio et aux Presses Universitaires de Rennes de m'avoir envoyé ce livre d'entretiens d'une historienne, Michelle Perrot, dont je suis depuis très longtemps les travaux et les recherches pluridisciplinaires sur L' hitoire des femmes.
J'avoue que je méconnaissais totalement son immense engagement sur des chantiers de réflexion concernant l'univers pénitentiaire et les " modèles d'enfermement...aux côtés de Michel Foucault et Robert Badinter....et ensuite, indépendamment...
Ces entretiens dirigés par Frédéric Chauvaud, lui-même professeur d'Histoire contemporaine à l'université de Poitiers et rédacteur de plusieurs ouvrages sur la justice pénale, questionne Michelle Perrot, aborde une multitude de thématiques, faisant se croiser toutes les dusciplines: L Histoire, le Droit, la Sociologie, la Ohilosophie, la Psychologie, L Histoire politique et même l'Architecture et la Littérature !
Ces entretiens débutent par des questionnements et des développements sur la base d' un texte fondateur de Michel Foucault, " Surveiller et punir", publié en 1975...
J'appréhendais quelque peu une aridité et un jargon abscons qui freineraient la lecture de ce dialogue...Très heureusement surprise ; rien de tout cela; l'ensemble est clairement rendu vivant et abordable...tout en nous proposant une large réflexion sur le système pénitentiaire français, son histoire, les chercheurs ayant travaillé sur sa transformation nécessaire ( dont ma découverte de cet étonnant Monsieur
Bentham !)- Je transcris un extrait pour mettre en avant son idée qui passait par une réflexion "architecturale"...
"À l'ombre des hauts murs
F.C :Jeremy Bentham, qui naquit à Londres au milieu du XVIIIe siècle, auquel vous vous êtes intéressé, notamment dans " L'Oeil du pouvoir " qui est un entretien avec Michel Foucault, a joué un rôle important, hier comme aujourd'hui, dans les réflexions sur la surveillance. (...) le vrai changement, a confié, en 1973, Michel Foucault dans un entretien publié dans " Pro Justitia.Revue politique de droit" , c'est "l'invention du panoptisme " qui est devenu, selon lui , très tôt, une réalité juridique et institutionnelle, mais aussi une " invention technologique", dont la prison est une pièce maîtresse du système pénal.
M.P : Dans " Surveiller et punir" , un chapitre s'appelle le panoptique de Jeremy Bentham qui avait été occulté ou négligé. (...)
La version originale, en anglais, intitulée "Panoption" , a été publiée en 1786.(...)
Il veut s'adresser aux révolutionnaires, en particulier à Condorcet, La Fayette et La Rochefoucauld- Liancourt, en quête de modèle de prison et leur dit à peu près :" Moi j'ai une solution , un modèle architectural qui consiste à faire surveiller un très grand nombre de gens par un tout petit nombre."
Ce livre paraissant " petit" (115 pages) est d'une densité incroyable...
Il est constitué de deux parties distinctes : le premier volet concerne L Histoire pénitentiaire en France
( avec qq comparatifs avec d'autres pays, dont les États-unis), incluant questionnements, et doutes sur " l'utilité et l'efficacité " des prisons...
Dans le second volet, nos deux historiens abordent le phénomène du" Fait-divers ", phénomène qui continue de fasciner jusqu'à inspirer les plus grands écrivains. le " Fait-divers" reflet d'une société, de ses ombres,objet d'étude ambivalent, car il nous interroge sur ce qui peut être inavouable en chaque citoyen !
"Je crois que chaque fait-divers, à la fois parce qu'il est étrange et marginal, passionne et renvoie à soi, à sa part d'ombre et de ce que l'on pourrait faire.Et chacun de se demander: "Suis-je capable de tuer ? Je pense que j'en suis incapable, mais dans de telles circonstances, l'aurais-je fait ?"
Ceci amène à s'interroger et à envisager des actions que l'on n'oserait pas imaginer ni penser.Le fait-divers est une brèche dans la parole convenue dans la bien-pensance.Il atteste de la présence du mal."
Texte accompagné d'une dizaine d'illustrations dont la majorité de dessins fin 19e et 20e , très évocateurs,proviennent des collections du Musée Carnavalet ...
Lecture passionnante tant par le parcours d'historienne et de chercheuse pluridisciplinaire de Michelle Perrot, parcours des plus impressionnants que par les " bilans" , " mises à plat" très larges de l'histoire des prisons et les réalités sociologiques du
" Fait- divers"...
Je ne résiste pas à un dernier extrait qui fait rentrer la littérature dans l'histoire du " Fait-divers", source éminemment "romanesque, qui a aussi ses détracteurs !
"Les écrivains, moralistes et censeurs ne sont pas unanimes. Les critiques les plus vives datent du XIX e siècle. Pour Barbey d'Aurevilly, le fait-divers est appelé à devenir la "vermine" des journaux qu'il rongera de l'intérieur jusqu'à leur anéantissement. Mais Jean- Paul Sartre fera explicitement référence aux soeurs Papin (...)Le fait-divers est entré en Littérature. Flaubert a puisé la trame de Madame Bovary dans "La Gazette des tribunaux ", Mauriac s'est inspiré d'un fait-divers bordelais pour rédiger
" Thérèse Desqueyroux".Devenue source d'inspiration, l'importance romanesque du fait-divers ne cesse de croître comme en témoignent " L'Adversaire " ou " La Serpe", les romans d'Emmanuel Carrère et Philippe Jaenada...
Non seulement le fait divers fait partie intégrante de la communication, mais sélectionné et construit, il renseigne sur ses usages et les préoccupations d'une époque, et parfois sur les conditions de vie et les difficultés d'une existence de misère. "
Merci à Babelio et les Éditions l’aube pour ce livre et la rencontre, plutôt la lecture de trois grandes dames remarquables.
Mona Ozouf historienne et philosophe, Michelle Perrot historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine, Cynthia Fleury philosophe et psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanités et santé au Cnam.
Toutes trois vont exposer un mot de la devise Républicaine, Mona Ozouf nous retrace l’histoire de cette devise et commence par la « Liberté », elle nous dit que c’est : « un droit naturel dévolu à l’homme antérieurement à toute société, est le chemin d’accès aux deux autres valeurs : seul un homme libre peut entreprendre de réclamer l’égalité, de pratiquer la fraternité. » (page 22)
Pour Michelle Perrot ce sera « l’Egalité » je cite « l’égalité n’est pas une réalité mais un objectif, un but qu’il faut toujours poursuivre. Un chemin, une bataille. Pour acquérir des droits, il a fallu que les inégaux, les hors-droit - esclaves, serfs, pauvres, prolétaires, prisonniers, femmes, Noirs, etc. - se battent (page 34)
Et pour finir, Cynthia Fleury la « fraternité » selon elle, il existe trois manières de la définir « la première renvoie à la dimension religieuse, monastique….la deuxième approche, révolutionnaire….est une fraternité des Lumières, de l’humanisme….la troisième définition possible de la fraternité, celle de 1848 et, au-delà, jusqu’à nos jours : non pas la sacralisation d’un « ici et maintenant », incarné par la République, qui unit les hommes dans leur humanité sociale. (Pages 58-59).
Ces trois entretiens réunis dans cet essai sont très intéressants, accessibles, ils m’ont permis une réflexion, une compréhension et une vision historique. Un petit livre que l’on peut lire et relire pour comprendre notre actualité. J’ai vraiment pris plaisir à cette lecture.
Mona Ozouf historienne et philosophe, Michelle Perrot historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine, Cynthia Fleury philosophe et psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanités et santé au Cnam.
Toutes trois vont exposer un mot de la devise Républicaine, Mona Ozouf nous retrace l’histoire de cette devise et commence par la « Liberté », elle nous dit que c’est : « un droit naturel dévolu à l’homme antérieurement à toute société, est le chemin d’accès aux deux autres valeurs : seul un homme libre peut entreprendre de réclamer l’égalité, de pratiquer la fraternité. » (page 22)
Pour Michelle Perrot ce sera « l’Egalité » je cite « l’égalité n’est pas une réalité mais un objectif, un but qu’il faut toujours poursuivre. Un chemin, une bataille. Pour acquérir des droits, il a fallu que les inégaux, les hors-droit - esclaves, serfs, pauvres, prolétaires, prisonniers, femmes, Noirs, etc. - se battent (page 34)
Et pour finir, Cynthia Fleury la « fraternité » selon elle, il existe trois manières de la définir « la première renvoie à la dimension religieuse, monastique….la deuxième approche, révolutionnaire….est une fraternité des Lumières, de l’humanisme….la troisième définition possible de la fraternité, celle de 1848 et, au-delà, jusqu’à nos jours : non pas la sacralisation d’un « ici et maintenant », incarné par la République, qui unit les hommes dans leur humanité sociale. (Pages 58-59).
Ces trois entretiens réunis dans cet essai sont très intéressants, accessibles, ils m’ont permis une réflexion, une compréhension et une vision historique. Un petit livre que l’on peut lire et relire pour comprendre notre actualité. J’ai vraiment pris plaisir à cette lecture.
Ouvrage emprunté au CDI de mon lycée ( juin 2014)
Une publication passionnante, tant par la qualité des textes, des informations qui sont présentées en forme d'entretiens entre l'historienne, Michelle Perrot et Jean Lebrun, en 5 chapitres, que par la diversité et la richesse de l'iconographie en couleurs :
-Images de femmes
- Lieux de femmes
-Paroles de Femmes
-Front de femmes
- Résistance aux femmes
Un ouvrage à la fois des plus instructifs, et des plus attrayants de par une iconographie exceptionnellement dense et attractive. J'ai une préférence pour "Fronts des femmes"... qui relate les difficultés des femmes dans certains secteurs, dont professionnels:
je retranscris un extrait :
"Il fut plus difficile pour les femmes de devenir médecins ?"
- Oui, et et il y eut à chaque échelon, à chaque spécialité conquise, des conflits de savoir et de pouvoir. Pourtant, dès avant 1914, il existe quelques centaines de femmes médecins en Grande -Bretagne et en France. Les premières furent des juives russes et polonaises chassées par les pogromes et qui avaient bénéficié d'une ouverture précoce de l'université aux filles dans la Russie des tsars. Elles s'introduisent d'abord en gynécologie, en puériculture, tandis que les spécialités plus techniques, et notamment la chirurgie, leur résistèrent longtemps et aujourd'hui encore, dans un secteur médical pourtant largement féminisé. L'hôpital fournit un bon exemple de l'incessante recomposition des frontières entre métiers masculins et féminins.
L'accès aux métiers du droit fut plus difficile, les femmes ne se voyant pas reconnaître d'aptitudes juridiques à titre individuel. Le droit apparaissait comme un apanage masculin" (p. 112)
Publication complétée d'une bibliographie (pp.157-158)
Une publication passionnante, tant par la qualité des textes, des informations qui sont présentées en forme d'entretiens entre l'historienne, Michelle Perrot et Jean Lebrun, en 5 chapitres, que par la diversité et la richesse de l'iconographie en couleurs :
-Images de femmes
- Lieux de femmes
-Paroles de Femmes
-Front de femmes
- Résistance aux femmes
Un ouvrage à la fois des plus instructifs, et des plus attrayants de par une iconographie exceptionnellement dense et attractive. J'ai une préférence pour "Fronts des femmes"... qui relate les difficultés des femmes dans certains secteurs, dont professionnels:
je retranscris un extrait :
"Il fut plus difficile pour les femmes de devenir médecins ?"
- Oui, et et il y eut à chaque échelon, à chaque spécialité conquise, des conflits de savoir et de pouvoir. Pourtant, dès avant 1914, il existe quelques centaines de femmes médecins en Grande -Bretagne et en France. Les premières furent des juives russes et polonaises chassées par les pogromes et qui avaient bénéficié d'une ouverture précoce de l'université aux filles dans la Russie des tsars. Elles s'introduisent d'abord en gynécologie, en puériculture, tandis que les spécialités plus techniques, et notamment la chirurgie, leur résistèrent longtemps et aujourd'hui encore, dans un secteur médical pourtant largement féminisé. L'hôpital fournit un bon exemple de l'incessante recomposition des frontières entre métiers masculins et féminins.
L'accès aux métiers du droit fut plus difficile, les femmes ne se voyant pas reconnaître d'aptitudes juridiques à titre individuel. Le droit apparaissait comme un apanage masculin" (p. 112)
Publication complétée d'une bibliographie (pp.157-158)
Dans ce recueil, il y a l’histoire de Philippe, qui a accompagné jusqu’au dernier jour son ami Bernard, emporté par le sida. Celle d’Astrid et Nolwenn, parties en Espagne pour une insémination artificielle. Farid, musulman, gay et opposé au mariage pour tous. Anne-Marie et Jean-Pierre, parents totalement déboussolés par le comportement de leur fille lesbienne avec laquelle ils sont en conflit permanent. Virginie, infirmière, qui peine à assumer son homosexualité sur son lieu de travail et est incapable de s’installer dans une relation durable. Momo, qui a dû fuir la guinée pour la France après avoir été surpris avec un homme par les siens et qui se sent toujours en danger. Marc, catholique pratiquant ne comprenant pas la volonté du pape d’interdire l’ordination des homosexuels pour combattre la pédophilie (« Je crois qu’il n’a pas compris ce que c’était que d’être homosexuel. Faire l’amalgame entre les deux… je ne comprends pas. »).
Dix témoignages en tout, recueillis par Hubert, auteur de bande dessinée (Miss pas touche) et lui-même homosexuel. L’idée de ce collectif émane de l’association BD Boum, créatrice du festival de Blois. Le but est ici d’aborder la question du genre au moyen d’entretiens menés auprès de la population LGBT (lesbiennes – gay – bi – trans) de l’agglomération tourangelle. Le résultat est saisissant de sincérité, chaque histoire explorant des vies entières et touchant à l'intime. Sida, mariage, adoption, difficulté à affirmer son homosexualité dans le cadre professionnel, relation aux parents ou à la religion, les thèmes traités sont aussi vastes que complexes. Cinq articles universitaires sont insérés entre les chapitres. Des éclairages théoriques ardus mais passionnants sur l’évolution du droit en matière d’homosexualité depuis 1810, la religion, l’homosexualité et l’homophobie ou encore la question de la transidentité. Ajoutez une somptueuse préface de Robert Badinter et en annexe le statut légal de l’homosexualité dans le monde pays par pays et vous obtenez une somme en tout point remarquable qui devrait permettre à plus d’un lecteur de dépasser clichés et préjugés à l’heure où l’hystérie anti-gay aura si tristement marqué cette année 2013.
Aux pinceaux j’ai eu le plaisir de retrouver Cyril Pedrosa, Alexis Dormal (Pico Bogue), Simon Hureau, Virginie Augustin et quelques autres dont je ne connaissais pas les travaux. Le résultat est graphiquement aussi riche que varié.
Un ouvrage important, essentiel même. A lire et à faire lire.
Lien : http://litterature-a-blog.bl..
Dix témoignages en tout, recueillis par Hubert, auteur de bande dessinée (Miss pas touche) et lui-même homosexuel. L’idée de ce collectif émane de l’association BD Boum, créatrice du festival de Blois. Le but est ici d’aborder la question du genre au moyen d’entretiens menés auprès de la population LGBT (lesbiennes – gay – bi – trans) de l’agglomération tourangelle. Le résultat est saisissant de sincérité, chaque histoire explorant des vies entières et touchant à l'intime. Sida, mariage, adoption, difficulté à affirmer son homosexualité dans le cadre professionnel, relation aux parents ou à la religion, les thèmes traités sont aussi vastes que complexes. Cinq articles universitaires sont insérés entre les chapitres. Des éclairages théoriques ardus mais passionnants sur l’évolution du droit en matière d’homosexualité depuis 1810, la religion, l’homosexualité et l’homophobie ou encore la question de la transidentité. Ajoutez une somptueuse préface de Robert Badinter et en annexe le statut légal de l’homosexualité dans le monde pays par pays et vous obtenez une somme en tout point remarquable qui devrait permettre à plus d’un lecteur de dépasser clichés et préjugés à l’heure où l’hystérie anti-gay aura si tristement marqué cette année 2013.
Aux pinceaux j’ai eu le plaisir de retrouver Cyril Pedrosa, Alexis Dormal (Pico Bogue), Simon Hureau, Virginie Augustin et quelques autres dont je ne connaissais pas les travaux. Le résultat est graphiquement aussi riche que varié.
Un ouvrage important, essentiel même. A lire et à faire lire.
Lien : http://litterature-a-blog.bl..
La maison de Nohant dans le Berry avait été achetée par la grand-mère de George Sand, Marie-Aurore de Saxe, en 1793. Belle demeure entourée d’un grand parc, George Sand en hérite et en fait une maison d’artiste : elle y écrit l’essentiel de ses livres, la nuit, plus propice à la concentration. De nombreux artistes, peintres, musiciens, écrivains y séjournent, parfois plusieurs années. Chopin y compose une partie de son œuvre, Balzac vient y puiser quelques inspirations, Théodore Rousseau y peindre quelques toiles. Le théâtre ainsi que le théâtre de marionnettes y occupent également une grande place. Elle y organise des spectacles avec son cher Marceau sous l’œil jaloux de son fils Maurice. De nombreux espaces sont dédiés aux activités artistiques dans la maison : cabinets de travail, bibliothèque, installation d’un piano, atelier, théâtre…Tout le village est convié aux représentations.
Nohant est aussi un jardin, lieu d’activités rurales auxquelles tient beaucoup George. Elle s’intéresse au jardinage, au potager, à l’étude des insectes puis des minéraux. Une serre est installée pour les plantes tropicales. Elle est également attentive au peuple, s’intéresse aux mœurs paysannes, à leur dialecte, leur culture, soucieuse de leur éducation, en républicaine convaincue. Elle s’en inspire dans ses récits. Même si elle continue à vivre régulièrement à Paris, elle est ancrée dans son Berry auprès d’un cercle d’amis chers auxquels elle restera fidèle. Toujours la plume à la main, par passion mais aussi pour entretenir le train de vie qui correspond à son idéal de maison ouverte à tous malgré les conflits qui ont pu naître avec ses enfants ou les difficultés de sa vie sentimentale. Sa plume elle l’utilise également en tant que journaliste engagée pendant les événements de 1848 et par la suite pour défendre la République et l’émancipation féminine. Elle tient un journal pendant la guerre de 1870 où elle exprime toute son horreur de la guerre.
L’ouvrage de Michèle Perrot passionnant et très bien écrit, à la fois riche et très accessible, nous dessine la personnalité d’une femme écrivain loin des clichés et images toutes faites et nous permet en même temps de mieux comprendre son œuvre, son attachement à la terre, son profond anticléricalisme, son amour de la nature et de la vie en plein air, sa volonté de la comprendre. Très moderne dans ses combats, elle défend une culture pour tous où tout le monde participe, enfants, vieillards, domestiques. On coud, on fabrique des marionnettes, on peint, on monte des décors, on lit à haute voix durant les longues soirées d’hiver. On plante, on cultive, on cuisine également et la nuit George veille sur la maisonnée, écrivant parfois jusqu’à l’épuisement, figure maternelle mais aussi femme de tête tenant les comptes tout en ayant su conserver la liberté de la vie bohème. C’est aussi un monde à la veille de disparaître avec le développement de la société industrielle. Un très beau livre qui donne envie d’aller voir de plus près cette maison de Nohant !
Nohant est aussi un jardin, lieu d’activités rurales auxquelles tient beaucoup George. Elle s’intéresse au jardinage, au potager, à l’étude des insectes puis des minéraux. Une serre est installée pour les plantes tropicales. Elle est également attentive au peuple, s’intéresse aux mœurs paysannes, à leur dialecte, leur culture, soucieuse de leur éducation, en républicaine convaincue. Elle s’en inspire dans ses récits. Même si elle continue à vivre régulièrement à Paris, elle est ancrée dans son Berry auprès d’un cercle d’amis chers auxquels elle restera fidèle. Toujours la plume à la main, par passion mais aussi pour entretenir le train de vie qui correspond à son idéal de maison ouverte à tous malgré les conflits qui ont pu naître avec ses enfants ou les difficultés de sa vie sentimentale. Sa plume elle l’utilise également en tant que journaliste engagée pendant les événements de 1848 et par la suite pour défendre la République et l’émancipation féminine. Elle tient un journal pendant la guerre de 1870 où elle exprime toute son horreur de la guerre.
L’ouvrage de Michèle Perrot passionnant et très bien écrit, à la fois riche et très accessible, nous dessine la personnalité d’une femme écrivain loin des clichés et images toutes faites et nous permet en même temps de mieux comprendre son œuvre, son attachement à la terre, son profond anticléricalisme, son amour de la nature et de la vie en plein air, sa volonté de la comprendre. Très moderne dans ses combats, elle défend une culture pour tous où tout le monde participe, enfants, vieillards, domestiques. On coud, on fabrique des marionnettes, on peint, on monte des décors, on lit à haute voix durant les longues soirées d’hiver. On plante, on cultive, on cuisine également et la nuit George veille sur la maisonnée, écrivant parfois jusqu’à l’épuisement, figure maternelle mais aussi femme de tête tenant les comptes tout en ayant su conserver la liberté de la vie bohème. C’est aussi un monde à la veille de disparaître avec le développement de la société industrielle. Un très beau livre qui donne envie d’aller voir de plus près cette maison de Nohant !
« Histoire des femmes. Tome II. Le moyen âge » est un ouvrage collectif de plus de 560 pages, paru chez Plon en janvier 1991. Rédigé par des Maitres de conférence, des Professeurs d'Université et des Chargés de recherche, tous éminents médiévistes intervenant sous la direction bienveillante mais attentive de Georges Duby et de Michelle Perrot, ce tome 2 de la collection « Histoire des femmes en Occident », a l'ambition de montrer aux lecteurs, et par le menu détail, ce que fut à cette époque la vie des femmes, leur place, leur condition, leurs rôles, leurs pouvoirs, leurs formes d'action, leur silence et leur parole. Autant vous dire que l'objectif est atteint.
Pour ce qui concerne l'entreprise, il faut admettre la difficulté de parler des femmes sans se limiter aux héroïnes et aux femmes d'exception ; en faisant ce choix, les contributeurs utilisaient les sources qui font foi sans pour autant négliger la voix des humbles.
Pour ce qui concerne la période, il faut en reconnaitre la singularité : elle s'étend sur plusieurs siècles (de la fin de l'Empire romain à la Renaissance), l'essor économique est inégal selon les pays mais progressif et significatif, l'espérance de vie est limitée (30 ans au 12ème siècle), la femme mariée à 9 enfants en moyenne (mais la mortalité avant l'âge de quatre ans est colossale), les cités « se mettent en place » (les paysans représentent près de 90 % de la population active), le droit se constitue (droit canon pour les questions religieuses, droit romain au Sud et droit coutumier dans le reste du pays pour ce qui concerne les questions temporelles), il y a une division très nette et socialement imposée entre l'homme et la femme (la femme est illettrée et cantonnée à une stricte activité domestique), les excès sont condamnés quand l'entrée en religion, la maternité et le mariage sont glorifiés, la femme, soumise à Dieu et à son mari, doit renoncer à toute ambition familiale et sociale, l’Église omniprésente « classifie » les femmes en vierges, veuves et épouses (la fameuse triade), les mariages sont arrangés (avec un écart moyen de plus de 15 ans entre mari et femme), la monogamie reste le seul fait des pauvres, un couple sur trois est issu de deuxième voire de troisième noce (les hommes meurent à la guerre ou d'épidémie) et les écrits sont rares (il faut attendre le 15ème siècle pour assister à l'invention de l'imprimerie).
La société n'est pas restée immobile sur cette période : l'évolution du statut économique et culturel de la femme a été lente mais réelle. Toutefois, il faut rester prudent : les écrits auxquels se réfèrent les contributeurs de cet ouvrage collectif sont le fait d'hommes (la documentation est donc androcentrée), de surcroit d'hommes de religion (qui se refusent à la société des femmes -lesquelles sont impures et tentatrices- et qui s'imposent chasteté et célibat) et leurs écrits dépeignent les femmes comme autant d'exemples le plus souvent à condamner (le trait est misogyne, quelque peu forcé et sous-tendu par un imaginaire puissant et largement livresque). Si on ajoute à ce tableau le fait que les commentaires des rédacteurs de l'époque brouillent plus l'image qu'ils ne l'éclairent, il n'est pas simple pour le lecteur d'aujourd'hui de se faire une idée claire de la façon dont la femme pouvait vivre sa vie à cette époque.
Pendant une grande partie de cette époque la femme reste un objet et la tradition comme l’Église font le maximum pour verrouiller toute velléité de libération de la femme. Heureusement les temps nouveaux s'annoncent avec, pêlemêle, la reconnaissance du fait que le mariage ne doit pas être exclusivement tourné vers la procréation, des clercs qui écoutent voire dialoguent davantage avec leurs fidèles -y compris de femmes-, le début de représentations (peintures, sculptures) féminines, des femmes qui exercent des activités artisanales, la valorisation de la sexualité comme garante de l'équilibre, la constitution de groupes de femmes, et j'en passe et des meilleurs. Alors, c'en est fini de l'épouse chaste, parfaite maitresse de maison, respectueuse, fidèle, empressée, avisée, irréprochable, subordonnée à son époux, attentive à ses beaux-parents, muette, révérente et totalement obéissante à son mari ? Pas tout à fait, mais voici venir la conseillère et la guide spirituel de son mari, prenant soin de ses enfants, veillant au bon comportement de la maisonnée et disposant d'initiatives (religion, morale, port des vêtements, accès aux produits « de luxe ») ! Il y aura malheureusement un sérieux coup de volant dès la fin du 15ème siècle mais c'est une autre histoire ...
Au final, un ouvrage passionnant, bien construit, très touffu, abondamment documenté, et agrémenté de dessins et de reproductions en noir et blanc, ce qui en facilite sa lecture. Je me contenterai de renvoyer les passionné(e)s vers une lecture complémentaire, à savoir le « Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval » (1999). Je recommande et mets 4 étoiles.
Pour ce qui concerne l'entreprise, il faut admettre la difficulté de parler des femmes sans se limiter aux héroïnes et aux femmes d'exception ; en faisant ce choix, les contributeurs utilisaient les sources qui font foi sans pour autant négliger la voix des humbles.
Pour ce qui concerne la période, il faut en reconnaitre la singularité : elle s'étend sur plusieurs siècles (de la fin de l'Empire romain à la Renaissance), l'essor économique est inégal selon les pays mais progressif et significatif, l'espérance de vie est limitée (30 ans au 12ème siècle), la femme mariée à 9 enfants en moyenne (mais la mortalité avant l'âge de quatre ans est colossale), les cités « se mettent en place » (les paysans représentent près de 90 % de la population active), le droit se constitue (droit canon pour les questions religieuses, droit romain au Sud et droit coutumier dans le reste du pays pour ce qui concerne les questions temporelles), il y a une division très nette et socialement imposée entre l'homme et la femme (la femme est illettrée et cantonnée à une stricte activité domestique), les excès sont condamnés quand l'entrée en religion, la maternité et le mariage sont glorifiés, la femme, soumise à Dieu et à son mari, doit renoncer à toute ambition familiale et sociale, l’Église omniprésente « classifie » les femmes en vierges, veuves et épouses (la fameuse triade), les mariages sont arrangés (avec un écart moyen de plus de 15 ans entre mari et femme), la monogamie reste le seul fait des pauvres, un couple sur trois est issu de deuxième voire de troisième noce (les hommes meurent à la guerre ou d'épidémie) et les écrits sont rares (il faut attendre le 15ème siècle pour assister à l'invention de l'imprimerie).
La société n'est pas restée immobile sur cette période : l'évolution du statut économique et culturel de la femme a été lente mais réelle. Toutefois, il faut rester prudent : les écrits auxquels se réfèrent les contributeurs de cet ouvrage collectif sont le fait d'hommes (la documentation est donc androcentrée), de surcroit d'hommes de religion (qui se refusent à la société des femmes -lesquelles sont impures et tentatrices- et qui s'imposent chasteté et célibat) et leurs écrits dépeignent les femmes comme autant d'exemples le plus souvent à condamner (le trait est misogyne, quelque peu forcé et sous-tendu par un imaginaire puissant et largement livresque). Si on ajoute à ce tableau le fait que les commentaires des rédacteurs de l'époque brouillent plus l'image qu'ils ne l'éclairent, il n'est pas simple pour le lecteur d'aujourd'hui de se faire une idée claire de la façon dont la femme pouvait vivre sa vie à cette époque.
Pendant une grande partie de cette époque la femme reste un objet et la tradition comme l’Église font le maximum pour verrouiller toute velléité de libération de la femme. Heureusement les temps nouveaux s'annoncent avec, pêlemêle, la reconnaissance du fait que le mariage ne doit pas être exclusivement tourné vers la procréation, des clercs qui écoutent voire dialoguent davantage avec leurs fidèles -y compris de femmes-, le début de représentations (peintures, sculptures) féminines, des femmes qui exercent des activités artisanales, la valorisation de la sexualité comme garante de l'équilibre, la constitution de groupes de femmes, et j'en passe et des meilleurs. Alors, c'en est fini de l'épouse chaste, parfaite maitresse de maison, respectueuse, fidèle, empressée, avisée, irréprochable, subordonnée à son époux, attentive à ses beaux-parents, muette, révérente et totalement obéissante à son mari ? Pas tout à fait, mais voici venir la conseillère et la guide spirituel de son mari, prenant soin de ses enfants, veillant au bon comportement de la maisonnée et disposant d'initiatives (religion, morale, port des vêtements, accès aux produits « de luxe ») ! Il y aura malheureusement un sérieux coup de volant dès la fin du 15ème siècle mais c'est une autre histoire ...
Au final, un ouvrage passionnant, bien construit, très touffu, abondamment documenté, et agrémenté de dessins et de reproductions en noir et blanc, ce qui en facilite sa lecture. Je me contenterai de renvoyer les passionné(e)s vers une lecture complémentaire, à savoir le « Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval » (1999). Je recommande et mets 4 étoiles.
"On ne naît pas féministe, alors comment le devient-on ?
Et comment les vagues féministes se sont-elles succédées ?"
Dans cet ouvrage, Michelle Perrot, historienne et féministe, a travaillé avec Eduardo Castillo, journaliste et écrivain, afin de se pencher sur l'histoire de la femme et du féminisme durant un siècle de luttes et de bouleversements jusqu'à aujourd'hui.
Il s'agit d'un guide dans lequel il est question de soumission, de religion, de mariage, de maternité, de violences, de précarité et de liberté.
"Nous avons conçu cet ouvrage comme une brève histoire des femmes et du féminisme, conjuguée à tous les temps. C'était la meilleure façon de rendre comte des faits, des figures féminines connues et méconnues, et des combats féministes qui ont contribué à faire avancer la cause des femmes. Nous avons voulu passer en revue l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes, les permanences et les ruptures et, à travers le temps, la prise de conscience par les femmes de l'importance de leur histoire. Cette prise de conscience a compté, elle compte et comptera de plus en plus pour les nouvelles générations."
Les auteurs retracent le chemin des féministes, des années 1970 aux années 2020, à travers les contextes sociaux, politiques et historiques. Le texte commence par un bref essai sur l'histoire des femmes, la forte influence du patriarcat jusqu'à la question de l'indépendance en passant par celles de l'égalité, de la liberté, du libre choix, de la maîtrise du corps et du consentement.
Ces dernières années sont fortement marquées par le désir de changement en matière de maternité, de contraception, d'avortement, d'homosexualité et de notion de genre.
On parle de toutes ces femmes ayant œuvré pour faire changer les mentalités. Elles sont écrivaines, journalistes, politiciennes, avocates, révolutionnaires. Il y a les pionnières comme Marguerite Thibert, Edith Thomas, mais aussi Gisèle Halimi, Simone Veil ou Simone de Beauvoir. Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme est également citée.
Les femmes ont voulu se faire entendre, que ce soit par la parole ou l'écriture, par le biais des débats, des revendications jusqu'au phénomène mondial #metoo lancé aux Etats-Unis en 2006.
Le texte balaie divers sujets en lien avec le féminisme mais ce n'est pas lourd, ni difficile à lire. C'est très bien écrit et structuré. J'ai aimé toutes les références littéraires et l'importante bibliographie proposées en fin d'ouvrage pour permettre de creuser la thématique.
Un ouvrage à lire, à faire lire, à transmettre.
Et comment les vagues féministes se sont-elles succédées ?"
Dans cet ouvrage, Michelle Perrot, historienne et féministe, a travaillé avec Eduardo Castillo, journaliste et écrivain, afin de se pencher sur l'histoire de la femme et du féminisme durant un siècle de luttes et de bouleversements jusqu'à aujourd'hui.
Il s'agit d'un guide dans lequel il est question de soumission, de religion, de mariage, de maternité, de violences, de précarité et de liberté.
"Nous avons conçu cet ouvrage comme une brève histoire des femmes et du féminisme, conjuguée à tous les temps. C'était la meilleure façon de rendre comte des faits, des figures féminines connues et méconnues, et des combats féministes qui ont contribué à faire avancer la cause des femmes. Nous avons voulu passer en revue l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes, les permanences et les ruptures et, à travers le temps, la prise de conscience par les femmes de l'importance de leur histoire. Cette prise de conscience a compté, elle compte et comptera de plus en plus pour les nouvelles générations."
Les auteurs retracent le chemin des féministes, des années 1970 aux années 2020, à travers les contextes sociaux, politiques et historiques. Le texte commence par un bref essai sur l'histoire des femmes, la forte influence du patriarcat jusqu'à la question de l'indépendance en passant par celles de l'égalité, de la liberté, du libre choix, de la maîtrise du corps et du consentement.
Ces dernières années sont fortement marquées par le désir de changement en matière de maternité, de contraception, d'avortement, d'homosexualité et de notion de genre.
On parle de toutes ces femmes ayant œuvré pour faire changer les mentalités. Elles sont écrivaines, journalistes, politiciennes, avocates, révolutionnaires. Il y a les pionnières comme Marguerite Thibert, Edith Thomas, mais aussi Gisèle Halimi, Simone Veil ou Simone de Beauvoir. Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme est également citée.
Les femmes ont voulu se faire entendre, que ce soit par la parole ou l'écriture, par le biais des débats, des revendications jusqu'au phénomène mondial #metoo lancé aux Etats-Unis en 2006.
Le texte balaie divers sujets en lien avec le féminisme mais ce n'est pas lourd, ni difficile à lire. C'est très bien écrit et structuré. J'ai aimé toutes les références littéraires et l'importante bibliographie proposées en fin d'ouvrage pour permettre de creuser la thématique.
Un ouvrage à lire, à faire lire, à transmettre.
Michelle Perrot, c'est pour moi, avant tout, l'une des historiennes à l'origine de l'Histoire des femmes en Occident, qui a été une mine, une bible même, pour me permettre de découvrir et comprendre pleinement la condition féminine du XIXème siècle, alors que je réalisais mon mémoire de maîtrise sur les figures féminines de la littérature vampirique.
Et c'est, de fait, une grande historienne qui, à travers un entretien avec Eduardo Castillo, un de ses anciens élèves, nous conte d'abord son parcours universitaire, qui l'a mené de manière assez inattendue tout d'abord dans cette voie de l'histoire des femmes, avant de nous évoquer, entre passé plus ou moins proche et présent, les féminismes, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, ce qu'ils pourront/pourraient être.
Car oui, il y a des féminismes, et l'historienne nous le montre, bien que brièvement, avec beaucoup de sagesse, et avec la distance nécessaire de son regard historique qui a vécu, tout autant qu'étudié, ceux-ci tout au long de sa carrière et de sa vie. Féminismes qui se doivent d'être complémentaires plutôt que sectaires, et qui se doivent de prendre en compte tous les paramètres de la condition féminine, sociaux, raciaux..., en une intersectionnalité qui lui semble nécessaire.
Des avancées fondamentales - droit de vote, à l'avortement, au divorce... - dans un certain nombre de pays, aux violents reculs de ces dernières années dans un certain nombre d'autres - parfois ce sont aussi les mêmes, ex Roe vs Wade aux Etats-Unis, à l'augmentation des féminicides, le temps des féminismes est loin, en effet, d'être révolu.
Je remercie les éditions Grasset et NetGalley de m'avoir permis de découvrir ce passionnant ouvrage.
Et c'est, de fait, une grande historienne qui, à travers un entretien avec Eduardo Castillo, un de ses anciens élèves, nous conte d'abord son parcours universitaire, qui l'a mené de manière assez inattendue tout d'abord dans cette voie de l'histoire des femmes, avant de nous évoquer, entre passé plus ou moins proche et présent, les féminismes, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, ce qu'ils pourront/pourraient être.
Car oui, il y a des féminismes, et l'historienne nous le montre, bien que brièvement, avec beaucoup de sagesse, et avec la distance nécessaire de son regard historique qui a vécu, tout autant qu'étudié, ceux-ci tout au long de sa carrière et de sa vie. Féminismes qui se doivent d'être complémentaires plutôt que sectaires, et qui se doivent de prendre en compte tous les paramètres de la condition féminine, sociaux, raciaux..., en une intersectionnalité qui lui semble nécessaire.
Des avancées fondamentales - droit de vote, à l'avortement, au divorce... - dans un certain nombre de pays, aux violents reculs de ces dernières années dans un certain nombre d'autres - parfois ce sont aussi les mêmes, ex Roe vs Wade aux Etats-Unis, à l'augmentation des féminicides, le temps des féminismes est loin, en effet, d'être révolu.
Je remercie les éditions Grasset et NetGalley de m'avoir permis de découvrir ce passionnant ouvrage.
« Nohant vu, voulu et vécu par Sand : tel est notre propos.
Dans ses dimensions matérielles et symbolique, affectives et politiques, réelles et idéelles, côté chambres et côté jardin.
Dans sa folle ambition de projet communautaire, d'atelier d'artiste, de lieu de création, de modèle égalitaire.
Dans sa tragédie de papillon brûlé à la lampe nocturne.
Dans sa beauté de fleur condamné au squelette de l'herbier. »
Nohant, une demeure d'artiste, témoin d'une époque, que Michelle Perrot nous raconte avec précision.
En été 2016, de passage dans le Berry, un détour par ces lieux étaient une évidence (à mes yeux !...un peu moins à ceux de mes loulous ;-)). Nous avons eu donc la chance de visiter cette grande et belle maison ainsi que son beau et apaisant jardin attenant. Un souvenir inoubliable pour ma part; au fond de ma petite mémoire, des instantanés ceux de l'immense et si fonctionnelle cuisine, du majestueux escalier de l'entrée, de la pièce de réception si chaleureuse et accueillante, et de son théâtre, le clou d'une visite riche en découvertes.
Alors c'est avec un grand plaisir que je me suis laissée happer par ces pages, pour une visite tout aussi intéressante, dense, enrichissante de ce "monde enchanté".
« Nohant est une thébaïde [...]. L'art y établit la communion des coeurs et des esprits. C'est aussi une cellule politique, inspirée un temps par le socialisme de Pierre Leroux, noyau républicain support de journaux et fervent subversif des manières de vivre et de penser. Nohant est le creuset d'une utopie,
spatialisée comme elles le sont toutes, pénétrée par l'ardent désir de changer le monde par son existence même. »
Nohant, « un refuge, un lieu stable, où s'enracinent les souvenirs et la vie, où reposer un jour dans une terre familière. »
Nohant, « une oasis, un sanctuaire. »
Nohant, « le chemin et la quête d'une vie. [la] nôtre en ce livre. »
George Sand, la passionnée, la voyageuse, une femme toujours en mouvement qui voyait dans le chemin la métaphore et la réalité de la vie. « Qu'y a-t-il de plus beau qu'un chemin [...] le chemin sans maître [...], route de l'univers ? »
En même temps qu'une femme hantée par le désir de l'éternel retour.
« Arriver pour moi, c'est toujours revenir. »
Un beau voyage dans le temps, instructif, émouvant, enrichissant, dépaysant, merci Michelle Perrot !
Merci également aux cafés littéraires et gourmands ;-) de Pontault et aux bibliothécaires qui placent en nos mains des œuvres que nous n'aurions probablement jamais saisies.
« La vie est un voyage qui a la vie pour but. »
Lien : https://seriallectrice.blogs..
Dans ses dimensions matérielles et symbolique, affectives et politiques, réelles et idéelles, côté chambres et côté jardin.
Dans sa folle ambition de projet communautaire, d'atelier d'artiste, de lieu de création, de modèle égalitaire.
Dans sa tragédie de papillon brûlé à la lampe nocturne.
Dans sa beauté de fleur condamné au squelette de l'herbier. »
Nohant, une demeure d'artiste, témoin d'une époque, que Michelle Perrot nous raconte avec précision.
En été 2016, de passage dans le Berry, un détour par ces lieux étaient une évidence (à mes yeux !...un peu moins à ceux de mes loulous ;-)). Nous avons eu donc la chance de visiter cette grande et belle maison ainsi que son beau et apaisant jardin attenant. Un souvenir inoubliable pour ma part; au fond de ma petite mémoire, des instantanés ceux de l'immense et si fonctionnelle cuisine, du majestueux escalier de l'entrée, de la pièce de réception si chaleureuse et accueillante, et de son théâtre, le clou d'une visite riche en découvertes.
Alors c'est avec un grand plaisir que je me suis laissée happer par ces pages, pour une visite tout aussi intéressante, dense, enrichissante de ce "monde enchanté".
« Nohant est une thébaïde [...]. L'art y établit la communion des coeurs et des esprits. C'est aussi une cellule politique, inspirée un temps par le socialisme de Pierre Leroux, noyau républicain support de journaux et fervent subversif des manières de vivre et de penser. Nohant est le creuset d'une utopie,
spatialisée comme elles le sont toutes, pénétrée par l'ardent désir de changer le monde par son existence même. »
Nohant, « un refuge, un lieu stable, où s'enracinent les souvenirs et la vie, où reposer un jour dans une terre familière. »
Nohant, « une oasis, un sanctuaire. »
Nohant, « le chemin et la quête d'une vie. [la] nôtre en ce livre. »
George Sand, la passionnée, la voyageuse, une femme toujours en mouvement qui voyait dans le chemin la métaphore et la réalité de la vie. « Qu'y a-t-il de plus beau qu'un chemin [...] le chemin sans maître [...], route de l'univers ? »
En même temps qu'une femme hantée par le désir de l'éternel retour.
« Arriver pour moi, c'est toujours revenir. »
Un beau voyage dans le temps, instructif, émouvant, enrichissant, dépaysant, merci Michelle Perrot !
Merci également aux cafés littéraires et gourmands ;-) de Pontault et aux bibliothécaires qui placent en nos mains des œuvres que nous n'aurions probablement jamais saisies.
« La vie est un voyage qui a la vie pour but. »
Lien : https://seriallectrice.blogs..
Quiconque s’est penché sur la vie de George Sand, quiconque s’est promené du côté de Nohant, sait que George Sand est Nohant et que Nohant est George Sand.
Cet ouvrage en est la démonstration.
George Sand est un personnage, mais Nohant en est également un.
Je suis de celle qui pense que les lieux ont une âme et mes visites à Nohant n’ont pu que me confirmer dans cette position.
Nous sommes loin de la Bonne Dame de Nohant qui a pu être décrite sans fin il y a quelques années : de l’ouvrage se dégage une personnalité complexe et multi-facettes.
Pour réactualiser les choses à la sauce XXIème siècle, j’écrirai que Nohant fut/est une résidence d’artistes.
Dans le regard de Michelle PEROT cela donne trois dimensions : les gens, les lieux et les temps… mais avant tout beaucoup de vie.
L’ouvrage est très documenté, mais pas austère… à un bémol près s’agissant des pages consacrées à la politique.
Sa lecture me fut si agréable que j’ai commandé « Histoire de chambres ».
Cet ouvrage en est la démonstration.
George Sand est un personnage, mais Nohant en est également un.
Je suis de celle qui pense que les lieux ont une âme et mes visites à Nohant n’ont pu que me confirmer dans cette position.
Nous sommes loin de la Bonne Dame de Nohant qui a pu être décrite sans fin il y a quelques années : de l’ouvrage se dégage une personnalité complexe et multi-facettes.
Pour réactualiser les choses à la sauce XXIème siècle, j’écrirai que Nohant fut/est une résidence d’artistes.
Dans le regard de Michelle PEROT cela donne trois dimensions : les gens, les lieux et les temps… mais avant tout beaucoup de vie.
L’ouvrage est très documenté, mais pas austère… à un bémol près s’agissant des pages consacrées à la politique.
Sa lecture me fut si agréable que j’ai commandé « Histoire de chambres ».
Un ouvrage très riche difficile à résumer qui couvre l'histoire des femmes en Occident et du XVIIIème siècle à nos jours en différents thèmes : les sources, le corps (sexualité, maternité, séduction, apparence), l'âme (mysticisme, religion, accès au savoir), le travail, les femmes dans l'espace (ville, voyages..).
Il est accompagné d'un CD de l'auteure, très agréable à écouter car elle se veut pédagogue.
Les femmes ont été longtemps absentes de l'Histoire pour plusieurs raisons : elles ont laissé peu de traces ou celles-ci ont été effacées, elles étaient confinées à la sphère privée, ont été les gardiennes de la transmission mais orale, L'Histoire a longtemps évoqué les grands hommes et les hauts faits avant de s'intéresser aux mentalités (Ecole des Annales), au privé (Georges Duby, Philippe Arès). Enfin, et on n'y pense pas, la grammaire. Sans être partisan de l'écriture inclusive, reconnaissons qu'elle empêche de déceler la présence de femmes dans des manifestations par exemple.
Aujourd'hui, les lois ont considérablement évolué et en théorie l'égalité est là (Michelle Perrot retrace la longue évolution en matière d'accès au savoir, travail, contraception et les causes des blocages) mais les mentalités sont plus dures à changer.
On apprend beaucoup et on découvre des personnalités hautes en couleur.
Il est accompagné d'un CD de l'auteure, très agréable à écouter car elle se veut pédagogue.
Les femmes ont été longtemps absentes de l'Histoire pour plusieurs raisons : elles ont laissé peu de traces ou celles-ci ont été effacées, elles étaient confinées à la sphère privée, ont été les gardiennes de la transmission mais orale, L'Histoire a longtemps évoqué les grands hommes et les hauts faits avant de s'intéresser aux mentalités (Ecole des Annales), au privé (Georges Duby, Philippe Arès). Enfin, et on n'y pense pas, la grammaire. Sans être partisan de l'écriture inclusive, reconnaissons qu'elle empêche de déceler la présence de femmes dans des manifestations par exemple.
Aujourd'hui, les lois ont considérablement évolué et en théorie l'égalité est là (Michelle Perrot retrace la longue évolution en matière d'accès au savoir, travail, contraception et les causes des blocages) mais les mentalités sont plus dures à changer.
On apprend beaucoup et on découvre des personnalités hautes en couleur.
Un documentaire très interessant sur "les mauvaises filles" selon les époques et la société dans la quelle elles ont grandi : sorcières, mère célibataires, hystérique, punk... tout y passe avec photo, texte...
Accessible à tous. permet également de voir l'avancée de la place des femmes dans la société et il reste encore du chemin à faire...
Accessible à tous. permet également de voir l'avancée de la place des femmes dans la société et il reste encore du chemin à faire...
Ce qui amène Michelle Perrot à l’Histoire, c’est la guerre… En effet, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle a une dizaine d’années et elle ne cessera de dire que « cette période l’a profondément marquée », alors qu’elle voyait un monde disparaître.
Son parcours incroyable, placé sous le signe de la réussite aux côtés de son maître Ernest Labrousse, a de quoi étonner. Pionnière, elle lance, à Jussieu, un cours sur l’Histoire des femmes. Travailleuse acharnée, elle ouvre en parallèle un chantier de recherche sur le monde des prisonniers.
On retiendra, de ce petit ouvrage, la richesse des réflexions qui apparaissent au fil des pages. Alors certes, certains diront qu’elle a été « au bon endroit au bon moment » pour avoir cette carrière mais moi je préfère dire que c’est sa capacité d’analyse si pointue qui lui a permis de se faire une place aux côtés des plus grands historiens de son époque.
C’est court, intense, brillant, captivant et c’est un ouvrage à mettre entre les mains de ceux qui doutent de l’apport de l’Histoire dans notre société et pensent que c’est une discipline qui se veut moraliste.
Rigoureuse, pionnière, cette grande dame fait partie de celles « qui voient ce qui est invisible » c’est-à-dire ce qui est en marge ou à la marge. Sa modestie se ressent au travers de ce petit ouvrage mais au final, ne serait-elle pas un modèle pour beaucoup d’entre nous ?
Lien : https://ogrimoire.com/2024/0..
Son parcours incroyable, placé sous le signe de la réussite aux côtés de son maître Ernest Labrousse, a de quoi étonner. Pionnière, elle lance, à Jussieu, un cours sur l’Histoire des femmes. Travailleuse acharnée, elle ouvre en parallèle un chantier de recherche sur le monde des prisonniers.
On retiendra, de ce petit ouvrage, la richesse des réflexions qui apparaissent au fil des pages. Alors certes, certains diront qu’elle a été « au bon endroit au bon moment » pour avoir cette carrière mais moi je préfère dire que c’est sa capacité d’analyse si pointue qui lui a permis de se faire une place aux côtés des plus grands historiens de son époque.
C’est court, intense, brillant, captivant et c’est un ouvrage à mettre entre les mains de ceux qui doutent de l’apport de l’Histoire dans notre société et pensent que c’est une discipline qui se veut moraliste.
Rigoureuse, pionnière, cette grande dame fait partie de celles « qui voient ce qui est invisible » c’est-à-dire ce qui est en marge ou à la marge. Sa modestie se ressent au travers de ce petit ouvrage mais au final, ne serait-elle pas un modèle pour beaucoup d’entre nous ?
Lien : https://ogrimoire.com/2024/0..
Essai-entretien très intéressant sur l'histoire du féminisme. Notre autrice n'est pas historienne féministe, elle est historienne (surtout) ET féministe. Tentant de répondre à cette question un brin provocatrice : les femmes ont-elles une histoire ? Sur la totalité des Grands Hommes, des peintres, des écrivains, des scientifiques, etc. et dans nombre de métiers, les femmes n'étaient pas bien nombreuses faut l'avouer ; les femmes ayant fait bouger les lignes sont d'ailleurs quasiment méconnues. Bouger contre cette sacro-sainte distinction : le public aux hommes, le privé aux femmes (sous contrôle) - une femme publique étant une... prostituée (prétendument consentante !). Ça change depuis quelques décennies (en Occident), par exemple, au grand dam de certains, de nombreux métiers se sont féminisés. Au grand dam de certains toujours, Miss France a même désormais une coupe à la "garçonne" (o' scandale !). Cette Miss, Eve Gilles, est aussi belle que notre pays compte d'abrutis, c'est dire ! Quand on pense, qu'encore cette année, ce type d'émission est regardée par plus de 7 millions de gens... Le patriarcat a la dent dure, mais je m'égare ! Cet essai est à lire disais-je, de nombreux sujets sont traités,et les faits de société nous fait le recommander d'autant plus.
Dans cet ouvrage, Michèle PErrot, ptionnière française des études historiques sur les femmes et actrice des luttes féminismes des années 70, raconte, et se raconte.
Historienne de formation, fille d'un homme éclairé qui lui a permis de grandir sans entrave, d'étudier comme un garçon, elle évoque dans ce livre toutes les ramifications et l'histoire du monde au féminin : des premières luttes - ou revendications - pour l'égalité du XVIIIème siècle occidental, à l'accession (ok toujours partielle) après plusieurs siècles, de l'histoire du patriarcat et des mouvements féministes.
Elle montre comment les cause actuelles (#metoo entre autres) n'auraient pas pu voir le jour sans les combats et les avancées des années 70 sur la "libération" ou plutôt la recherche de l'égalité.
Elle met également en lumière l'importance de la prise en compte des différences culturelles pour éviter de traiter de façon indifférenciée, sur tous les continents, certains signes (voile, burqa).
Un ouvrage qui se lit d'une traite et qui éclaire tant le chemin parcouru que celui qui reste encore à parcourir.
Un must !
Je remercie vivement NetGalley et les Editions Grasset qui m'ont transmis cet ouvrage
#Letempsdesféminismes #NetGalleyFrance
Lien : http://les-lectures-de-bill-..
Historienne de formation, fille d'un homme éclairé qui lui a permis de grandir sans entrave, d'étudier comme un garçon, elle évoque dans ce livre toutes les ramifications et l'histoire du monde au féminin : des premières luttes - ou revendications - pour l'égalité du XVIIIème siècle occidental, à l'accession (ok toujours partielle) après plusieurs siècles, de l'histoire du patriarcat et des mouvements féministes.
Elle montre comment les cause actuelles (#metoo entre autres) n'auraient pas pu voir le jour sans les combats et les avancées des années 70 sur la "libération" ou plutôt la recherche de l'égalité.
Elle met également en lumière l'importance de la prise en compte des différences culturelles pour éviter de traiter de façon indifférenciée, sur tous les continents, certains signes (voile, burqa).
Un ouvrage qui se lit d'une traite et qui éclaire tant le chemin parcouru que celui qui reste encore à parcourir.
Un must !
Je remercie vivement NetGalley et les Editions Grasset qui m'ont transmis cet ouvrage
#Letempsdesféminismes #NetGalleyFrance
Lien : http://les-lectures-de-bill-..
J'ai vraiment apprécié la lecture de ce livre.
Merci au édition Grasset pour la publication de cet essai.
Je remercie Michelle Perrot et Edouardo Castillo pour avoir l'idée de retranscrit cette réflexion.
L'histoire des femmes est très bien relaté dans cet ouvrage.
Il y a de nombreuses référence à de nombreuses femmes qui ont voulu faire changer la situation d'une époque.
Etant née dans les années 80, j ai été sidéré d'apprendre que certains droits ont été conquis que aussi tardivement.
J'ai apprécié qu'elle mette en lumière des femmes telle que: Aubertine Auclert, Gisèle Halimi, Françoise Giroud, Olympe de Gouges,Laure Adler, Marguerite Durand, Françoise Héritier, Louise Weiss, Mona Chollet ect..`
Je m'excuse pour celles que j'oublie.
Elle fait référence aux écrits de Titou Lecoq, je pense qu'elle va jouer un rôle par son travail sur le sujet de l'égalité Femmes- Hommes
Le livre va au bout des pensées et de comprendre la situation actuelle en France.
En refermant ce livre, j'ai pensé à citation de Simone de Beauvoir qui à nombreuse fois est cité dans cet essai et merci de la mentionné car elle est pour moi une figure un incontestable du "féminisme". Voici cette citation
"N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant"."
Merci au édition Grasset pour la publication de cet essai.
Je remercie Michelle Perrot et Edouardo Castillo pour avoir l'idée de retranscrit cette réflexion.
L'histoire des femmes est très bien relaté dans cet ouvrage.
Il y a de nombreuses référence à de nombreuses femmes qui ont voulu faire changer la situation d'une époque.
Etant née dans les années 80, j ai été sidéré d'apprendre que certains droits ont été conquis que aussi tardivement.
J'ai apprécié qu'elle mette en lumière des femmes telle que: Aubertine Auclert, Gisèle Halimi, Françoise Giroud, Olympe de Gouges,Laure Adler, Marguerite Durand, Françoise Héritier, Louise Weiss, Mona Chollet ect..`
Je m'excuse pour celles que j'oublie.
Elle fait référence aux écrits de Titou Lecoq, je pense qu'elle va jouer un rôle par son travail sur le sujet de l'égalité Femmes- Hommes
Le livre va au bout des pensées et de comprendre la situation actuelle en France.
En refermant ce livre, j'ai pensé à citation de Simone de Beauvoir qui à nombreuse fois est cité dans cet essai et merci de la mentionné car elle est pour moi une figure un incontestable du "féminisme". Voici cette citation
"N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant"."
Grâce à une conversation avec l'un de ses anciens étudiants d'origine chilienne Eduardo Castillo, l'historienne Michelle Perrot, grande figure de l'université française, nous livre une autobiographie intellectuelle passionnante et stimulante.
Le texte est fluide et balaye magistralement 60 ans de réflexion et de lectures à travers le spectre du féminisme. Un thème très actuel que Michelle Perrot a introduit dans la pratique de sa discipline, puis longuement sillonné.
Ce livre se lit avec plaisir et facilité (je m'attendais à une forme dialoguée, il n'en est rien). Il est précieux car il nous livre à la fois le témoignage d'une pionnière et d'une militante, mais aussi la réflexion profonde d'une intellectuelle rompue à prendre en compte la complexité des choses.
Le propos aborde avec beaucoup de hauteur l'histoire du mouvement féministe et de ses théories, dans leur contexte, avec leurs limites, mais aussi les visages contemporains du féminisme : wokisme, intersectionnalité...
Très synthétique, cet ouvrage apporte une somme de définitions et de multiples pistes de lectures et de réflexions. Il comporte également un aspect autobiographique : au fil des pages on partage les émotions intellectuelles et les convictions d'une femme qui arrive au seuil d'un siècle de vie (elle a 94 ans).
Michelle Perrot, avec humilité et générosité, partage avec son lecteur son expérience, ses réflexions, ses questionnements parfois.
On ressort de cette lecture éclairé par son insatiable curiosité, par son discernement, construit par son exigence intellectuelle, mais aussi par son souci de la vérité et de la justice et par une réelle empathie. Lumineux...
Le texte est fluide et balaye magistralement 60 ans de réflexion et de lectures à travers le spectre du féminisme. Un thème très actuel que Michelle Perrot a introduit dans la pratique de sa discipline, puis longuement sillonné.
Ce livre se lit avec plaisir et facilité (je m'attendais à une forme dialoguée, il n'en est rien). Il est précieux car il nous livre à la fois le témoignage d'une pionnière et d'une militante, mais aussi la réflexion profonde d'une intellectuelle rompue à prendre en compte la complexité des choses.
Le propos aborde avec beaucoup de hauteur l'histoire du mouvement féministe et de ses théories, dans leur contexte, avec leurs limites, mais aussi les visages contemporains du féminisme : wokisme, intersectionnalité...
Très synthétique, cet ouvrage apporte une somme de définitions et de multiples pistes de lectures et de réflexions. Il comporte également un aspect autobiographique : au fil des pages on partage les émotions intellectuelles et les convictions d'une femme qui arrive au seuil d'un siècle de vie (elle a 94 ans).
Michelle Perrot, avec humilité et générosité, partage avec son lecteur son expérience, ses réflexions, ses questionnements parfois.
On ressort de cette lecture éclairé par son insatiable curiosité, par son discernement, construit par son exigence intellectuelle, mais aussi par son souci de la vérité et de la justice et par une réelle empathie. Lumineux...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Michelle Perrot
Lecteurs de Michelle Perrot (876)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quiz saga Haikyuu
Quel est le personnage principal de cette saga?
Daichi Sawamura
Tobio Kageyama
Tooru Oikawa
Shoyo Hinata
21 questions
23 lecteurs ont répondu
Thème : Haikyu, tome 1 de
Haruichi FurudateCréer un quiz sur cet auteur23 lecteurs ont répondu