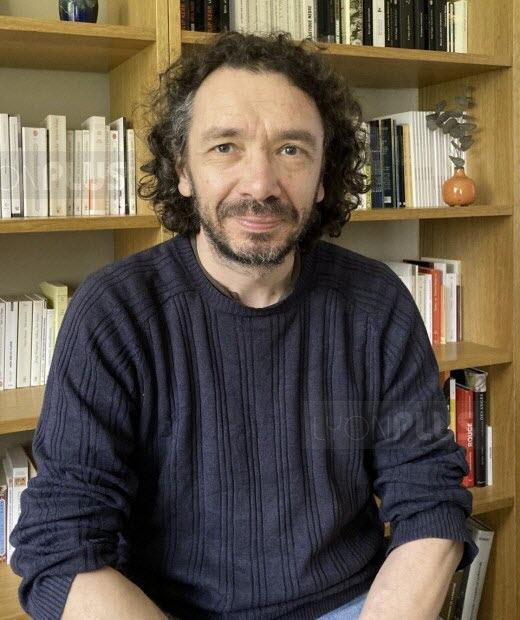Critiques de Gwenaël Bulteau (146)
Polar social historique.
Lyon 1898.Le cadavre mutilé d’un enfant vient d’être découvert. L'enquête commence, et plonge dans les entrailles d’une société française écartelée. L’affaire Dreyfus bat son plein. La publication du J’accuse de Zola va bientôt rebattre toutes les cartes.
Un premier roman naturaliste et social à ne pas manquer.
Lyon 1898.Le cadavre mutilé d’un enfant vient d’être découvert. L'enquête commence, et plonge dans les entrailles d’une société française écartelée. L’affaire Dreyfus bat son plein. La publication du J’accuse de Zola va bientôt rebattre toutes les cartes.
Un premier roman naturaliste et social à ne pas manquer.
Le roman s'ouvre sur la découverte du corps supplicié d'un enfant, puis le démarrage de l'enquête s'ensuit. L'intrigue est parfaitement maîtrisée, avec un scénario tentaculaire aux nombreux embranchements, rempli de nombreux personnages tous complexes à l'image d'un des flics, à prime abord détestable, qui révèle progressivement un autre visage lorsque son identité profonde apparaît. Les personnages féminins sont particulièrement intéressants dans leurs multiples facettes qui floutent les frontières entre le Bien et le Mal, loin de tout manichéisme.
Polar donc. Polar historique surtout puisqu'il se situe en janvier 1898, à un moment charnière de la IIIème République, en pleine affaire Dreyfus. le 10 janvier le commandant Esterhazy, le « vrai » traître, comparaît devant un tribunal militaire. le conseil de guerre prononce à l'unanimité son acquittement. Le 13, retentit le célèbre J'accuse de Zola, un électrochoc qui secoue la République au point de la faire sombrer dans une quasi guerre civile. le nationalisme se déchaîne, l'antisémitisme se décomplexe et sévit dans toutes les sphères de la société, y compris dans les rangs de la police.
Le risque avec les polars historiques, c'est souvent de plaquer une reconstitution ripolinée et lourdaude. Gwenaël Bulteau est lui parvenu à reconstituer le Lyon de
la Belle époque sans clichés et avec qualité. Dans La République des faibles, les belles moustaches sont pleines de boue et de sueur. le récit colle au plancher, au plus près des personnages, bourgeois, prolo ou flics. L'écriture, précise et très visuelle lorsqu'il s'agit de décrire les avancées de l'enquête, se fait crue pour dénoncer l'injustice des inégalités sociales. Peut-être aurai-je apprécié que l'arrière-plan socio-politique soit encore plus utilisé pour encore plus l'ancrer dans cette passionnante période.
Ce que décrit le roman est terrible : enfance martyrisée, femmes maltraités, ouvriers rabaissés. le titre résonne de façon presque ironique tant la IIIème République, qui a pourtant érigée fin XIXème siècle de le concept de « République des faibles » censé protéger les invisibilisés, s'est dévoyée : les faibles boivent en fait le calice jusqu'à la lie, les autorités cherchant avant tout à préserver l'ordre établi de la société bourgeoise et à arrêter les agitateurs socialistes. Les faibles ne peuvent compter que sur quelques individualités prêtes à se dresser pour que la machine judiciaire se mette en branle pour le meurtre d'un enfant, ce qui n'était pas le cas à cette époque lorsque l'enfant était de basse extraction sociale. Ses accents naturalistes à la Zola sont vraiment pertinents.
Un premier roman très prometteur, sur les traces d'un Hervé le Corre, la référence absolue en matière de polar historique à vocation sociale.
Polar donc. Polar historique surtout puisqu'il se situe en janvier 1898, à un moment charnière de la IIIème République, en pleine affaire Dreyfus. le 10 janvier le commandant Esterhazy, le « vrai » traître, comparaît devant un tribunal militaire. le conseil de guerre prononce à l'unanimité son acquittement. Le 13, retentit le célèbre J'accuse de Zola, un électrochoc qui secoue la République au point de la faire sombrer dans une quasi guerre civile. le nationalisme se déchaîne, l'antisémitisme se décomplexe et sévit dans toutes les sphères de la société, y compris dans les rangs de la police.
Le risque avec les polars historiques, c'est souvent de plaquer une reconstitution ripolinée et lourdaude. Gwenaël Bulteau est lui parvenu à reconstituer le Lyon de
la Belle époque sans clichés et avec qualité. Dans La République des faibles, les belles moustaches sont pleines de boue et de sueur. le récit colle au plancher, au plus près des personnages, bourgeois, prolo ou flics. L'écriture, précise et très visuelle lorsqu'il s'agit de décrire les avancées de l'enquête, se fait crue pour dénoncer l'injustice des inégalités sociales. Peut-être aurai-je apprécié que l'arrière-plan socio-politique soit encore plus utilisé pour encore plus l'ancrer dans cette passionnante période.
Ce que décrit le roman est terrible : enfance martyrisée, femmes maltraités, ouvriers rabaissés. le titre résonne de façon presque ironique tant la IIIème République, qui a pourtant érigée fin XIXème siècle de le concept de « République des faibles » censé protéger les invisibilisés, s'est dévoyée : les faibles boivent en fait le calice jusqu'à la lie, les autorités cherchant avant tout à préserver l'ordre établi de la société bourgeoise et à arrêter les agitateurs socialistes. Les faibles ne peuvent compter que sur quelques individualités prêtes à se dresser pour que la machine judiciaire se mette en branle pour le meurtre d'un enfant, ce qui n'était pas le cas à cette époque lorsque l'enfant était de basse extraction sociale. Ses accents naturalistes à la Zola sont vraiment pertinents.
Un premier roman très prometteur, sur les traces d'un Hervé le Corre, la référence absolue en matière de polar historique à vocation sociale.
Deuxième polar historique pour Gwenaël Bulteau ( après La République des faibles ) et nouvelle réussite pour cet auteur qui allie talent de conteur évident, plume soignée et capacité à ressusciter une période bouillonnante de l'histoire de France.
Le prologue, totalement immersif, remplit parfaitement sa fonction de machine à remonter le temps. Direction Paris, le 22 janvier 1905, où sont organisées les funérailles de l’icône communarde Louise Michel, rassemblant plusieurs milliers de personnes en un cortège hérissé de drapeaux rouges et de bannières noires, de gare de Lyon jusqu’au cimetière de Levallois-Perret. Parmi elles, Jeanne, une jeune femme disparaît, « elle ignorait encore qu’elle vivait le dernier jour de son existence. » Un an après, sa cousine, montée à Paris, décide de partir sur les traces de Jeanne pour essayer de découvrir ce qu’il lui est arrivé.
L’enquête en elle-même est plutôt simple, très bien menée, tout est cohérent. Mais on sent très vite que ce n’est pas uniquement sa résolution qui intéresse l’auteur. Le Grand soir est certes un polar mais surtout un polar historique et social engagé qui éclaire les luttes sociales et féministes du début du XXème siècle. Des funérailles de Louise Michel, on passe dans les bas quartiers ouvriers de la capitale, puis dans le bassin houiller du Nord secoué par la catastrophe minière de Courrières ( officiellement 1099 morts ), jusqu’aux préparatifs de la première manifestation du 1er mai en France organisée par la CGT pour obtenir la journée de 8 heures. Tout l’arrière-plan politique du roman est bien plus qu’un simple décor et enveloppe totalement le lecteur.
Et c’est d’autant plus passionnant qu’on découvre deux extraordinaires pionnières féministes françaises que l’auteur a inclu dans son récit aux côtés de ses autres personnages fictifs, procédé qui apporte immédiatement de la profondeur à l’intrigue. Il imagine ainsi que Mme Sorgue ( figure de l’anarcho-syndicalisme, soutien actif aux nombreuses grèves ouvrières ) et Madeleine Pelletier ( femme médecin habillée d’un costume d’homme et coiffée d’un chapeau melon, prônant liberté sexuelle et avortement ) ont côtoyé la jeune disparue et possède une pièce du puzzle de l’enquête.
En fait, tout le roman vibre des colères sociales et féministes de la Belle époque, d’autant que les deux cousines que l’ont suit sont des personnages forts et marquants. Jeanne, la disparue, issue de la très haute bourgeoisie, refusait de rentrer dans le rang imposée par sa classe sociale, rejetant farouchement son milieu pour fuguer dans les quartiers populaires, déguisée en ouvrière. Sans s’en rendre immédiatement compte, Louise cherche sa propre voie pour écrire sa vie ; l’enquête qu’elle mène le lui révèlera, en plus de la vérité sur le sort de sa cousine.
Quel monde !!! Attention , chers amis et amies qui pensez que " c'était mieux avant " , vous risquez de revoir votre jugement et ce , de la première à la dernière ligne .L'auteur vous convie à pénétrer dans la " cour des miracles " , dans les bas - fonds de la société prolétaire lyonnaise de la fin du XIXème siècle. La République ? Plutôt une effervescence confuse à l'approche d'une élection où les haines se déchaînent , où l'affaire Dreyfus nourrit un antisémitisme aussi primaire que sauvage , où le nationalisme éclate....
C'est dans cette atmosphère de violence que vous allez évoluer, parmi les faibles , les opprimés, dans l'injustice , la misère sociale et intellectuelle , dans une société pour le moins " virile "dans laquelle se meuvent des alcooliques violents et où femmes et enfants de basse couche essaient tant bien que mal de survivre .
Les couleurs ? sombres . Les sons ? plutôt des cris . Le toucher ? glauque , gluant , comme ces tas d'immondices dans lequel les mains calleuses d'un chiffonnier vont , un matin , trouver le cadavre privé de tête d'un enfant dont le corps est rongé par la décomposition...L'enquête commence et va donner lieu à bien des découvertes , évidemment ...Mais à partir de là , c'est à vous de faire votre parcours , moi , je viens de tourner la dernière page et , je l'avoue , j'ai reçu une remarquable leçon d'histoire .C'est qu'il est bon , voire excellent , le professeur . Non seulement Gwenael Bulteau a travaillé son sujet et s'est bien documenté mais il a aussi le don d'enfoncer les événements dans une trame passionnante qui nous réserve son lot de surprises .
Je me suis cru revenu au temps de ma jeunesse avec Dickens , dans les bas - fonds londoniens . Heureusement , la police , vous le verrez , veillait au grain pour .....protéger les misérables ? Oui , c'était l'idée mais ...la police ...en ce temps - là... comment dire ....euh ....ah , voilà , voilà, elle avait aussi ses ....problèmes.
Que de choses à lire , à dire , à imaginer dans ce roman qui fut pour moi " palpitant " , écrit d'une plume alerte , utilisant même , pour donner , s'il en était besoin , encore plus de crédibilité au récit, un vocabulaire particulièrement adapté au contexte , un vocabulaire " populaire " mais jamais vulgaire . Les ramifications du " fil rouge " , loin de détourner notre attention , permettent à nos sens de toujours rester en éveil et , croyez - moi , c'est d'une indiscutable nécessité.... Partout , " ça craint ".
Amateurs de romans noirs et d'Histoire , ce roman est pour vous .Mais je préviens les âmes trop sensibles , ça " décoiffe "...Quant à vous , gentes dames , sachez que vous aller partager des destins plutôt ....durs .
Mais oui , comme disent certains , " c'était mieux avant " ....
On en reparle après ? Juste après, hein ?
C'est dans cette atmosphère de violence que vous allez évoluer, parmi les faibles , les opprimés, dans l'injustice , la misère sociale et intellectuelle , dans une société pour le moins " virile "dans laquelle se meuvent des alcooliques violents et où femmes et enfants de basse couche essaient tant bien que mal de survivre .
Les couleurs ? sombres . Les sons ? plutôt des cris . Le toucher ? glauque , gluant , comme ces tas d'immondices dans lequel les mains calleuses d'un chiffonnier vont , un matin , trouver le cadavre privé de tête d'un enfant dont le corps est rongé par la décomposition...L'enquête commence et va donner lieu à bien des découvertes , évidemment ...Mais à partir de là , c'est à vous de faire votre parcours , moi , je viens de tourner la dernière page et , je l'avoue , j'ai reçu une remarquable leçon d'histoire .C'est qu'il est bon , voire excellent , le professeur . Non seulement Gwenael Bulteau a travaillé son sujet et s'est bien documenté mais il a aussi le don d'enfoncer les événements dans une trame passionnante qui nous réserve son lot de surprises .
Je me suis cru revenu au temps de ma jeunesse avec Dickens , dans les bas - fonds londoniens . Heureusement , la police , vous le verrez , veillait au grain pour .....protéger les misérables ? Oui , c'était l'idée mais ...la police ...en ce temps - là... comment dire ....euh ....ah , voilà , voilà, elle avait aussi ses ....problèmes.
Que de choses à lire , à dire , à imaginer dans ce roman qui fut pour moi " palpitant " , écrit d'une plume alerte , utilisant même , pour donner , s'il en était besoin , encore plus de crédibilité au récit, un vocabulaire particulièrement adapté au contexte , un vocabulaire " populaire " mais jamais vulgaire . Les ramifications du " fil rouge " , loin de détourner notre attention , permettent à nos sens de toujours rester en éveil et , croyez - moi , c'est d'une indiscutable nécessité.... Partout , " ça craint ".
Amateurs de romans noirs et d'Histoire , ce roman est pour vous .Mais je préviens les âmes trop sensibles , ça " décoiffe "...Quant à vous , gentes dames , sachez que vous aller partager des destins plutôt ....durs .
Mais oui , comme disent certains , " c'était mieux avant " ....
On en reparle après ? Juste après, hein ?
Ce polar historique qui fleure bon le roman noir, nous parle de la France d’en bas, celle qui se lève tôt, celle des sans-dents.
En un seul mot : des prolétaires de tous bords. Ceux qui triment comme des bêtes, tirent le diable par la queue, où les hommes boivent, traitent les femmes comme des moins que rien, ont la haine des Juifs, des étrangers, des Prussiens, des flics…
En commençant son histoire par la découverte du corps supplicié d’un enfant, déposé dans une décharge, l’auteur nous balance directement dans la fosse à purin avant même que l’on ait pu tester la température du bouillon de culture.
La misère noire, on va en bouffer, mais sans jamais jouer au voyeur, car l’auteur a évité le pathos et le larmoyant. Oui, c’est brut de décoffrage, oui, c'est glauque, oui, c'est violent et c’est à se demander si on en a un pour relever l’autre, dans ce petit monde qui est aux antipodes de La petite maison dans la prairie.
L’enquête aura plusieurs ramifications, elle servira de fil conducteur à l’auteur pour nous montrer la ville de Lyon en 1898, en pleine affaire Dreyfus, à une époque où Zola et son « j’accuse » fit l’effet d’une bombe et où les gens se transformèrent en bêtes sauvages dans le but d’aller casser du juif.
Le travail historique et documentaire est énorme, mais jamais nous n’aurons l’impression que l’auteur nous déclame une leçon apprise en cours d’histoire, car tous les éléments historiques s’emboîtent parfaitement dans le récit, sans jamais l’alourdir, l’appesantir ou ralentir le rythme.
Mesdames, ne cherchez pas vos droits dans ces pages, nous n’en avons pas, ou si peu : celui de fermer notre gueule, d’écarter les cuisses et de rester à notre place, devant les fourneaux. Je préviens les petits esprits que cela pourrait choquer et qui voudrait ensuite porter plainte contre l’auteur pour maltraitance féminine.
L’Histoire ne fut pas tendre avec nous les femmes (nous le charme), comme elle fut violente aussi pour bien d’autres personnes ! On ne va pas renier le passé ou le passer sous silence sous prétexte que certains ne veulent pas en entendre parler ou veulent nous imposer la "cancel culture".
Ce que ce roman décrit et met en lumière est terrible, car à cette époque, on a de la maltraitance enfantine, féminine, ouvrière, c’est bourré d’injustices, d’inégalités sociales, d’antisémitisme, de misère crasse, de mauvaises foi et de type qui ont des relations inadéquates avec des enfants.
La République (IIIᵉ) avait promis de protéger les faibles, mais ce sont eux qui morflent en premier. La société est bourgeoise, l’ordre est bien établit dans les classes et ceux d’en haut n’ont pas trop envie que les trublions socialistes d’en bas viennent foutre en l’air cet ordre. S’il le faut, la police et le rouleau compresseur de la Justice viendront y mettre bon ordre, dans ces agitateurs.
Un roman noir puissant, violent, sans concession, brut de décoffrage. Une belle écriture, sans fioritures et une plume trempée dans l’acide des injustices sociales. Un très bon premier roman noir.
Lien : https://thecanniballecteur.w..
En un seul mot : des prolétaires de tous bords. Ceux qui triment comme des bêtes, tirent le diable par la queue, où les hommes boivent, traitent les femmes comme des moins que rien, ont la haine des Juifs, des étrangers, des Prussiens, des flics…
En commençant son histoire par la découverte du corps supplicié d’un enfant, déposé dans une décharge, l’auteur nous balance directement dans la fosse à purin avant même que l’on ait pu tester la température du bouillon de culture.
La misère noire, on va en bouffer, mais sans jamais jouer au voyeur, car l’auteur a évité le pathos et le larmoyant. Oui, c’est brut de décoffrage, oui, c'est glauque, oui, c'est violent et c’est à se demander si on en a un pour relever l’autre, dans ce petit monde qui est aux antipodes de La petite maison dans la prairie.
L’enquête aura plusieurs ramifications, elle servira de fil conducteur à l’auteur pour nous montrer la ville de Lyon en 1898, en pleine affaire Dreyfus, à une époque où Zola et son « j’accuse » fit l’effet d’une bombe et où les gens se transformèrent en bêtes sauvages dans le but d’aller casser du juif.
Le travail historique et documentaire est énorme, mais jamais nous n’aurons l’impression que l’auteur nous déclame une leçon apprise en cours d’histoire, car tous les éléments historiques s’emboîtent parfaitement dans le récit, sans jamais l’alourdir, l’appesantir ou ralentir le rythme.
Mesdames, ne cherchez pas vos droits dans ces pages, nous n’en avons pas, ou si peu : celui de fermer notre gueule, d’écarter les cuisses et de rester à notre place, devant les fourneaux. Je préviens les petits esprits que cela pourrait choquer et qui voudrait ensuite porter plainte contre l’auteur pour maltraitance féminine.
L’Histoire ne fut pas tendre avec nous les femmes (nous le charme), comme elle fut violente aussi pour bien d’autres personnes ! On ne va pas renier le passé ou le passer sous silence sous prétexte que certains ne veulent pas en entendre parler ou veulent nous imposer la "cancel culture".
Ce que ce roman décrit et met en lumière est terrible, car à cette époque, on a de la maltraitance enfantine, féminine, ouvrière, c’est bourré d’injustices, d’inégalités sociales, d’antisémitisme, de misère crasse, de mauvaises foi et de type qui ont des relations inadéquates avec des enfants.
La République (IIIᵉ) avait promis de protéger les faibles, mais ce sont eux qui morflent en premier. La société est bourgeoise, l’ordre est bien établit dans les classes et ceux d’en haut n’ont pas trop envie que les trublions socialistes d’en bas viennent foutre en l’air cet ordre. S’il le faut, la police et le rouleau compresseur de la Justice viendront y mettre bon ordre, dans ces agitateurs.
Un roman noir puissant, violent, sans concession, brut de décoffrage. Une belle écriture, sans fioritures et une plume trempée dans l’acide des injustices sociales. Un très bon premier roman noir.
Lien : https://thecanniballecteur.w..
Lyon, 1898 : le commissaire Soubielle et son équipe sont à pied d'oeuvre pour retrouver le meurtrier d'un enfant décapité, dont le corps violenté a été abandonné dans une décharge.
Misère, alcoolisme, stigmates de la guerre franco-prussienne, affaire Dreyfus, nationalisme & antisémitisme dans ce quartier des pentes de la Croix-Rousse * ... voilà le cadre de l'intrigue.
.
Sur le bandeau de l'édition poche 10/18 :
• "La force d'une enquête aux mutliples rebondissements."
> Beaucoup trop de rebondissements, de noms à mémoriser, on s'y perd, et c'est d'autant plus difficile quand on connaît mal le contexte socio-historique (la Commune, l'affaire Dreyfus).
• "Epoustouflant".
> Je dirais 'écoeurant' : glauque, violent, vulgaire. Je comparais l'ambiance à celle du 'Parfum' (P. Süskind), chef-d'oeuvre qui mérite ce qualificatif 'époustouflant', et ce roman n'en a vraiment pas l'envergure.
.
Je me suis quand même laissée captiver à mon rythme actuel - lent : une semaine pour 330 pages.
J'ai aimé ce voyage dans le temps (124 ans en arrière), et dans l'espace, à Lyon, même si j'ai lu cet ouvrage en partie dans cette ville que j'ai découverte in situ et avec cette histoire.
.
Mes lectures des Rougon-Macquart remontent à 25 ans, je me suis demandé si c'était aussi misérabiliste & trash (je crois que oui), et si l'auteur, Gwenaël Bulteau dont le ton cru rappelle le langage fleuri de Jean Teulé n'en fait pas des tonnes.
Même perplexité ici qu'avec la série 'L'amie prodigieuse' d'Elena Ferrante : mais ils sont tous comme ça, "là-bas" ? les hommes possessifs et prompts à cogner, les femmes 'hystériques' (pardon pour le terme) ? Mes ancêtres vendéens de la même époque, des 'prolétaires' eux aussi, me semblent moins dingues, au vu de ce que m'en ont raconté mes parents et leurs aînés.
On peut s'étonner aussi que les forces de l'ordre s'émeuvent ici des moeurs dépravées de quelques citoyens. Dans 'La petite danseuse de quatorze ans' (Camille Laurens), l'attirance d'adultes pour les jeunes enfants/adolescents apparaît ouvertement, et les parents savent parfois en profiter pour arrondir les fins de mois.
.
Avis mitigé, too much.
.
-----
.
* pensée pour la grande auteure Virginie ♥ qui a emprunté son pseudonyme à ces lieux
Misère, alcoolisme, stigmates de la guerre franco-prussienne, affaire Dreyfus, nationalisme & antisémitisme dans ce quartier des pentes de la Croix-Rousse * ... voilà le cadre de l'intrigue.
.
Sur le bandeau de l'édition poche 10/18 :
• "La force d'une enquête aux mutliples rebondissements."
> Beaucoup trop de rebondissements, de noms à mémoriser, on s'y perd, et c'est d'autant plus difficile quand on connaît mal le contexte socio-historique (la Commune, l'affaire Dreyfus).
• "Epoustouflant".
> Je dirais 'écoeurant' : glauque, violent, vulgaire. Je comparais l'ambiance à celle du 'Parfum' (P. Süskind), chef-d'oeuvre qui mérite ce qualificatif 'époustouflant', et ce roman n'en a vraiment pas l'envergure.
.
Je me suis quand même laissée captiver à mon rythme actuel - lent : une semaine pour 330 pages.
J'ai aimé ce voyage dans le temps (124 ans en arrière), et dans l'espace, à Lyon, même si j'ai lu cet ouvrage en partie dans cette ville que j'ai découverte in situ et avec cette histoire.
.
Mes lectures des Rougon-Macquart remontent à 25 ans, je me suis demandé si c'était aussi misérabiliste & trash (je crois que oui), et si l'auteur, Gwenaël Bulteau dont le ton cru rappelle le langage fleuri de Jean Teulé n'en fait pas des tonnes.
Même perplexité ici qu'avec la série 'L'amie prodigieuse' d'Elena Ferrante : mais ils sont tous comme ça, "là-bas" ? les hommes possessifs et prompts à cogner, les femmes 'hystériques' (pardon pour le terme) ? Mes ancêtres vendéens de la même époque, des 'prolétaires' eux aussi, me semblent moins dingues, au vu de ce que m'en ont raconté mes parents et leurs aînés.
On peut s'étonner aussi que les forces de l'ordre s'émeuvent ici des moeurs dépravées de quelques citoyens. Dans 'La petite danseuse de quatorze ans' (Camille Laurens), l'attirance d'adultes pour les jeunes enfants/adolescents apparaît ouvertement, et les parents savent parfois en profiter pour arrondir les fins de mois.
.
Avis mitigé, too much.
.
-----
.
* pensée pour la grande auteure Virginie ♥ qui a emprunté son pseudonyme à ces lieux
Là où nombre de ses confrères regardent vers le futur, Gwenaël Bulteau se tourne vers le passé pour son premier roman.
Le débutant en littérature (même s’il avait déjà écrit plusieurs nouvelles, dont une primée aux Quais du polar) se lance dans le polar historique. Mais catégoriser son histoire de manière trop étriquée ne serait pas lui faire honneur comme il se doit.
1898, la Troisième République, dite des faibles. Avec des femmes et des enfants qui, pour beaucoup, ne « méritaient » pas d’être respectés comme les hommes.
1898, en pleine affaire Dreyfus, et de l’onde de choc du « J’accuse » d’Émile Zola. Dans une société où l’antisémitisme est totalement décomplexé, dans la rue comme dans les sphères plus officielles, y compris dans la police.
Cette plongée dans le passé est absolument fascinante, vraiment immersive, clairement instructive. Le roman noir est le genre parfait pour captiver tout en parlant d’une société pas si révolue que cela.
La réussite est complète et force le respect. C’est rare, pour un premier roman de genre, qui demande une maîtrise autant de la narration que du contexte.
L’intrigue policière, autour de meurtres d’enfants, prend vite des directions diverses et surprenantes. Au point où je me suis demandé à un moment si l’auteur n’allait pas se perdre et terminer son intrigue en queue de poisson. Pas du tout, le final est formidable, tendu, inattendu et mené de main de maître.
Mais une bonne idée d’intrigue n’est rien sans une ambiance et des personnages qui marquent les esprits. Là encore, belle réussite.
Ce retour vers le passé est plein d’adresse, avec un travail remarquable réalisé sur l’environnement de l’époque. A aucun moment, on a l’impression d’une reconstitution en carton pâte. Au contraire, tout semble sonner juste, sans tomber dans la leçon d’Histoire. Le contexte est instructif mais sert toujours l’intrigue.
Quant aux protagonistes, ils sont dessinés avec soin, tout en nuances de gris, loin de tout manichéisme. Ils ont leurs singularités, des pensées et comportements ambivalents. Des caractères complexes, qui tout à tour touchent, choquent, marquent.
Cette histoire nous plonge dans l’intime, de ceux qui n’ont à peine que de quoi vivre, qui sont laissés sur le côté. Et des forces de l’ordre clairement politisées aussi. Un contexte social et politique explosif.
C’est surtout, un cri d’amour pour ces faibles, femmes et enfants, et un cri de justice à travers un pan de l’Histoire qui a des enseignements à nous rappeler.
La république des faibles est autant polar historique que roman noir, contrôlé du début à la fin par un auteur de talent. Gwenaël Bulteau est une belle révélation.
Lien : https://gruznamur.com/2021/0..
Le débutant en littérature (même s’il avait déjà écrit plusieurs nouvelles, dont une primée aux Quais du polar) se lance dans le polar historique. Mais catégoriser son histoire de manière trop étriquée ne serait pas lui faire honneur comme il se doit.
1898, la Troisième République, dite des faibles. Avec des femmes et des enfants qui, pour beaucoup, ne « méritaient » pas d’être respectés comme les hommes.
1898, en pleine affaire Dreyfus, et de l’onde de choc du « J’accuse » d’Émile Zola. Dans une société où l’antisémitisme est totalement décomplexé, dans la rue comme dans les sphères plus officielles, y compris dans la police.
Cette plongée dans le passé est absolument fascinante, vraiment immersive, clairement instructive. Le roman noir est le genre parfait pour captiver tout en parlant d’une société pas si révolue que cela.
La réussite est complète et force le respect. C’est rare, pour un premier roman de genre, qui demande une maîtrise autant de la narration que du contexte.
L’intrigue policière, autour de meurtres d’enfants, prend vite des directions diverses et surprenantes. Au point où je me suis demandé à un moment si l’auteur n’allait pas se perdre et terminer son intrigue en queue de poisson. Pas du tout, le final est formidable, tendu, inattendu et mené de main de maître.
Mais une bonne idée d’intrigue n’est rien sans une ambiance et des personnages qui marquent les esprits. Là encore, belle réussite.
Ce retour vers le passé est plein d’adresse, avec un travail remarquable réalisé sur l’environnement de l’époque. A aucun moment, on a l’impression d’une reconstitution en carton pâte. Au contraire, tout semble sonner juste, sans tomber dans la leçon d’Histoire. Le contexte est instructif mais sert toujours l’intrigue.
Quant aux protagonistes, ils sont dessinés avec soin, tout en nuances de gris, loin de tout manichéisme. Ils ont leurs singularités, des pensées et comportements ambivalents. Des caractères complexes, qui tout à tour touchent, choquent, marquent.
Cette histoire nous plonge dans l’intime, de ceux qui n’ont à peine que de quoi vivre, qui sont laissés sur le côté. Et des forces de l’ordre clairement politisées aussi. Un contexte social et politique explosif.
C’est surtout, un cri d’amour pour ces faibles, femmes et enfants, et un cri de justice à travers un pan de l’Histoire qui a des enseignements à nous rappeler.
La république des faibles est autant polar historique que roman noir, contrôlé du début à la fin par un auteur de talent. Gwenaël Bulteau est une belle révélation.
Lien : https://gruznamur.com/2021/0..
Le printemps arrivant, il est temps de se remettre aux polars.
Dans la famille polar social et historique, La République des faibles est une bonne pioche et une heureuse surprise.
D'abord bien sur parce que l'action se déroule dans les premiers mois de 1898 dans...les quartiers de mon enfance. Et ça c'est vraiment très cool car Gwenaël Bulteau traite son affaire en véritable historien. Mine de rien, il articule finement l'histoire architecturale de Lyon-Caluire avec son histoire sociale et politique et c'est vraiment très intéressant ( même pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter cette belle ville !)
Ensuite parce qu'il nous plonge dans des faits sociétaux d'une étonnante actualité: condition des enfants, patriarcat omnipotent et décadent, montée de l'extrême-droite (dans le contexte antisémitique de l'affaire Dreyfus) et d'une violence inquiétante. Les prolétaires de la Bourse du travail affrontent les partisans des ligues et les forces de l'ordre. Tout cela préfigure, avec un ajustement intelligent, ce qui se passe aujourd'hui...C'est un peu troublant...
On va donc suivre quelques policiers hauts en couleur regroupés autour du commissaire Soubielle qui mène l'enquête: le corps décapité d'un petit garçon habillé en fille a été découvert dans la décharge de La Croix-Rousse
Ensuite tout se précipite : un meurtre, des pédophiles, des complotistes, des infanticides, des violeurs, des femmes battues, des alcooliques et un étonnant petit vieux souffrant d'un syndrome post-traumatique ( lié à la guerre de 70)...
Il faut avoir le coeur bien accroché, c'est sur, mais on suit tout cela à un train d'enfer, de rebondissements en rebondissements. C'est palpitant et parfois bien glauque, comme la vie en ces temps troublés de La République des faibles. Felix Faure est au manette de la France, mais, comme chacun sait, plus pour très longtemps: l'épectase guette les infidèles. Et des infidèles, il y en a quelques-uns dans ce très bon roman qui résonne très fort.
Alors on peut mégoter un peu : certains personnages manquent d'épaisseur et l'histoire nous traine dans les bas-fonds sordides de la IIIe République.
Mais au final c'est un très bon moment de lecture et il vient de sortir en poche...
Parfait entre deux lectures pointues!!!
Dans la famille polar social et historique, La République des faibles est une bonne pioche et une heureuse surprise.
D'abord bien sur parce que l'action se déroule dans les premiers mois de 1898 dans...les quartiers de mon enfance. Et ça c'est vraiment très cool car Gwenaël Bulteau traite son affaire en véritable historien. Mine de rien, il articule finement l'histoire architecturale de Lyon-Caluire avec son histoire sociale et politique et c'est vraiment très intéressant ( même pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter cette belle ville !)
Ensuite parce qu'il nous plonge dans des faits sociétaux d'une étonnante actualité: condition des enfants, patriarcat omnipotent et décadent, montée de l'extrême-droite (dans le contexte antisémitique de l'affaire Dreyfus) et d'une violence inquiétante. Les prolétaires de la Bourse du travail affrontent les partisans des ligues et les forces de l'ordre. Tout cela préfigure, avec un ajustement intelligent, ce qui se passe aujourd'hui...C'est un peu troublant...
On va donc suivre quelques policiers hauts en couleur regroupés autour du commissaire Soubielle qui mène l'enquête: le corps décapité d'un petit garçon habillé en fille a été découvert dans la décharge de La Croix-Rousse
Ensuite tout se précipite : un meurtre, des pédophiles, des complotistes, des infanticides, des violeurs, des femmes battues, des alcooliques et un étonnant petit vieux souffrant d'un syndrome post-traumatique ( lié à la guerre de 70)...
Il faut avoir le coeur bien accroché, c'est sur, mais on suit tout cela à un train d'enfer, de rebondissements en rebondissements. C'est palpitant et parfois bien glauque, comme la vie en ces temps troublés de La République des faibles. Felix Faure est au manette de la France, mais, comme chacun sait, plus pour très longtemps: l'épectase guette les infidèles. Et des infidèles, il y en a quelques-uns dans ce très bon roman qui résonne très fort.
Alors on peut mégoter un peu : certains personnages manquent d'épaisseur et l'histoire nous traine dans les bas-fonds sordides de la IIIe République.
Mais au final c'est un très bon moment de lecture et il vient de sortir en poche...
Parfait entre deux lectures pointues!!!
En cette fin de XIXème siècle, alors qu'une bataille fait rage entre pro et antidreyfusard, on découvre le cadavre d'un enfant sans tête sur les pentes de la Croix Rousse.
Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête.
Si l'identification du pauvre gamin ne prend pas longtemps, l'affaire s'annonce compliquée.
D'autant qu'au sein de son équipe, ne règne pas la meilleure ambiance.
Ce polar historique, signé Gwenaël Bulteau, va nous plonger dans la réalité brutale d'une époque perturbée où sont encore bien présentes les séquelles de la défaite de 1870 face aux Prussiens.
L'antisémitisme se répand, prémice des années sombres à venir.
Un deuxième crime, va mobiliser les policiers, d'autant plus motivés, que c'est l'un des leurs qu'on atteint.
Gwenaël Bulteau, nous offre un voyage dans les bas fonds de la cité rhodanienne, avec une galerie de personnages dont la cruauté et la violence s'accordent au décor de leur lieu de vie.
Lieu de tous les excès.
Haine du juif, prostitution, alcool ou pédophilie.
On croise ici, la lie d'une société que la République semble avoir oubliée.
Certains sont prêts à tout pour arriver à leurs fins.
Les rivalités politiques exacerbent, divisent et poussent à l'émeute, une population qui tente de survivre.
Les enfants sont souvent les premières victimes de cette violence ambiante.
Notre commissaire n'est pas au bout de ses surprises, le lecteur non plus d'ailleurs.
De révélations en retournements, Bulteau nous offre un formidable feu d'artifice final.
Premier polar historique de l'auteur, une réussite.
Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête.
Si l'identification du pauvre gamin ne prend pas longtemps, l'affaire s'annonce compliquée.
D'autant qu'au sein de son équipe, ne règne pas la meilleure ambiance.
Ce polar historique, signé Gwenaël Bulteau, va nous plonger dans la réalité brutale d'une époque perturbée où sont encore bien présentes les séquelles de la défaite de 1870 face aux Prussiens.
L'antisémitisme se répand, prémice des années sombres à venir.
Un deuxième crime, va mobiliser les policiers, d'autant plus motivés, que c'est l'un des leurs qu'on atteint.
Gwenaël Bulteau, nous offre un voyage dans les bas fonds de la cité rhodanienne, avec une galerie de personnages dont la cruauté et la violence s'accordent au décor de leur lieu de vie.
Lieu de tous les excès.
Haine du juif, prostitution, alcool ou pédophilie.
On croise ici, la lie d'une société que la République semble avoir oubliée.
Certains sont prêts à tout pour arriver à leurs fins.
Les rivalités politiques exacerbent, divisent et poussent à l'émeute, une population qui tente de survivre.
Les enfants sont souvent les premières victimes de cette violence ambiante.
Notre commissaire n'est pas au bout de ses surprises, le lecteur non plus d'ailleurs.
De révélations en retournements, Bulteau nous offre un formidable feu d'artifice final.
Premier polar historique de l'auteur, une réussite.
Le premier roman de Gwenaël Bulteau, la République des faibles avait impressionné bons nombres de lecteurs et reçu de nombreux prix. J’attendais comme beaucoup d’autres, je pense, son second roman avec impatience.
Le grand soir, même s’il est différent du premier, nous permet de retrouver ce que nous avions apprécié, une plongée un gros siècle en arrière cette fois à Paris et non plus à Lyon, une enquête moins policière dans ce dernier mais toujours bien menée mais, surtout une description de l’époque, commune aux deux qui en font des romans noirs comme on les aime.
Ici, tout commence à l’enterrement de Louise Michel, dernière fois où est aperçue Jeanne, une fille de la bourgeoisie, proche des gens. L’enquête policière ne menant à rien sera vite abandonnée. C’est sans compter sur la volonté de Lucie, la cousine de Jeanne qui mettra son énergie à chercher à comprendre ce qui s’est réellement passé. Au cours de ses investigations, elle rencontrera des personnages historiques dont la citoyenne Sorgue et le Docteur Pelletier.
Histoire mêlée de fiction, Le grand soir est un merveilleux récit qui confirme le talent de Gwenaël Bulteau.
Le grand soir, même s’il est différent du premier, nous permet de retrouver ce que nous avions apprécié, une plongée un gros siècle en arrière cette fois à Paris et non plus à Lyon, une enquête moins policière dans ce dernier mais toujours bien menée mais, surtout une description de l’époque, commune aux deux qui en font des romans noirs comme on les aime.
Ici, tout commence à l’enterrement de Louise Michel, dernière fois où est aperçue Jeanne, une fille de la bourgeoisie, proche des gens. L’enquête policière ne menant à rien sera vite abandonnée. C’est sans compter sur la volonté de Lucie, la cousine de Jeanne qui mettra son énergie à chercher à comprendre ce qui s’est réellement passé. Au cours de ses investigations, elle rencontrera des personnages historiques dont la citoyenne Sorgue et le Docteur Pelletier.
Histoire mêlée de fiction, Le grand soir est un merveilleux récit qui confirme le talent de Gwenaël Bulteau.
Deux salles, une ambiance.
Paris.
La neige blanche accompagne le rouge linceul de Louise Michel en ce jour gris de janvier 1905.
Visuel, très visuel.
La commune inhume une de ses icônes en ce début de roman historique ou une jeune bourgeoise en rupture de ban assiste à ces obsèques puis…disparait en ne laissant aucune trace.
Un an plus tard, sa jeune cousine poursuit les recherches qui n’ont jusqu’alors rien donné et, à sa suite, s’infiltre dans les mouvances d’opposition voire anarchistes dont émergent les premières revendications féministes personnifiées par le médecin Madeleine Pelletier.
Roquefort.
1906. Une grève ébranle les caves fromagères où gronde le râle syndical naissant. Bien que triomphant, le mouvement se termine dans le sang quand est abattu un contremaître mis à pieds pour abus sexuels voulant se venger en tentant d'assassiner Madeleine Durand plus connue sous le pseudonyme de La Sorgue.
Deux personnages réels donc dans une trame romanesque et policière.
Ces deux figures tutélaires des luttes féministes de ce début du siècle dernier vont nous accompagner dans ce roman très bien écrit quand nous arpenterons les bas-fonds populeux du Paris d’alors à la recherche de la jeune fille de bonne famille disparue ou les rues de Lens en proie aux manifestations des mineurs abattus par les exactions de la direction des Houilles du nord.
Il sera donc question de lutte des classes, de syndicalisme, d’inégalités hommes/femmes mais également d’études de mœurs ou d’avortement.
Il y aura de la lutte, évidemment, de la solidarité, bien sûr, et de la trahison, aussi, dans ce récit épique comme dans toutes les épopées qui ont pour ambition de nous restituer les différents soulèvements populaires qui ont conduit aux libertés et aux acquis sociaux arrachés dans le sang à une classe dirigeante peu encline à lâcher un peu de lest dans sa suprématie.
Cela fait forcément écho à la situation politique actuelle.
Par contre, comme à chaque fois où des personnes existantes ou ayant existé interviennent en tant que personnages romanesques dans un ouvrage (voir ma chronique sur ‘le baiser'), je m’interroge sur la pertinence de ce choix de leur octroyer un parcours fictif qu’elles n'ont pas vécu.
La liberté de narration du romancier justifie-t-elle cette utilisation ?
Il suffit de taper le nom des deux femmes citées ci-dessus sur un navigateur internet pour lire leurs réelles histoires et s’apercevoir que ce qui nous est narré ici n’est pas toujours compatible avec la ‘vraie vie’.
Cela me perturbe quelque peu, cette frontière floue entre la réalité historique et le pur roman me laisse dubitatif et un peu chagrin d’avoir à faire mes propres investigations pour trier ce qui appartient à chaque nature de récit.
Sans doute ne le devrais-je pas et considérer avoir une œuvre purement fictionnelle et romanesque entre les mains seulement aimerais-je (et pour quelle raison le ferait-on) que l'on me prête des aventures qui ne sont pas miennes ? Pas sûr !
Contentons-nous d’avoir appris l’existence de ces deux femmes de courage qui ont mis leur pierre à l’édifice du mouvement féministe qui, comme la Sagrada Familia de Barcelone, n'est toujours qu'un vaste chantier à ciel ouvert dont la fin semble remise aux calendes grecques.
Paris.
La neige blanche accompagne le rouge linceul de Louise Michel en ce jour gris de janvier 1905.
Visuel, très visuel.
La commune inhume une de ses icônes en ce début de roman historique ou une jeune bourgeoise en rupture de ban assiste à ces obsèques puis…disparait en ne laissant aucune trace.
Un an plus tard, sa jeune cousine poursuit les recherches qui n’ont jusqu’alors rien donné et, à sa suite, s’infiltre dans les mouvances d’opposition voire anarchistes dont émergent les premières revendications féministes personnifiées par le médecin Madeleine Pelletier.
Roquefort.
1906. Une grève ébranle les caves fromagères où gronde le râle syndical naissant. Bien que triomphant, le mouvement se termine dans le sang quand est abattu un contremaître mis à pieds pour abus sexuels voulant se venger en tentant d'assassiner Madeleine Durand plus connue sous le pseudonyme de La Sorgue.
Deux personnages réels donc dans une trame romanesque et policière.
Ces deux figures tutélaires des luttes féministes de ce début du siècle dernier vont nous accompagner dans ce roman très bien écrit quand nous arpenterons les bas-fonds populeux du Paris d’alors à la recherche de la jeune fille de bonne famille disparue ou les rues de Lens en proie aux manifestations des mineurs abattus par les exactions de la direction des Houilles du nord.
Il sera donc question de lutte des classes, de syndicalisme, d’inégalités hommes/femmes mais également d’études de mœurs ou d’avortement.
Il y aura de la lutte, évidemment, de la solidarité, bien sûr, et de la trahison, aussi, dans ce récit épique comme dans toutes les épopées qui ont pour ambition de nous restituer les différents soulèvements populaires qui ont conduit aux libertés et aux acquis sociaux arrachés dans le sang à une classe dirigeante peu encline à lâcher un peu de lest dans sa suprématie.
Cela fait forcément écho à la situation politique actuelle.
Par contre, comme à chaque fois où des personnes existantes ou ayant existé interviennent en tant que personnages romanesques dans un ouvrage (voir ma chronique sur ‘le baiser'), je m’interroge sur la pertinence de ce choix de leur octroyer un parcours fictif qu’elles n'ont pas vécu.
La liberté de narration du romancier justifie-t-elle cette utilisation ?
Il suffit de taper le nom des deux femmes citées ci-dessus sur un navigateur internet pour lire leurs réelles histoires et s’apercevoir que ce qui nous est narré ici n’est pas toujours compatible avec la ‘vraie vie’.
Cela me perturbe quelque peu, cette frontière floue entre la réalité historique et le pur roman me laisse dubitatif et un peu chagrin d’avoir à faire mes propres investigations pour trier ce qui appartient à chaque nature de récit.
Sans doute ne le devrais-je pas et considérer avoir une œuvre purement fictionnelle et romanesque entre les mains seulement aimerais-je (et pour quelle raison le ferait-on) que l'on me prête des aventures qui ne sont pas miennes ? Pas sûr !
Contentons-nous d’avoir appris l’existence de ces deux femmes de courage qui ont mis leur pierre à l’édifice du mouvement féministe qui, comme la Sagrada Familia de Barcelone, n'est toujours qu'un vaste chantier à ciel ouvert dont la fin semble remise aux calendes grecques.
Et si vous preniez un billet pour un voyage dans le temps ? Dans les rues de Paris et de province, au tout début du XXème siècle, aux côtés du peuple.
Louise Michel est enterrée en cette année 1905, la foule suit le cortège dans une tension palpable. La lutte ouvrière perd un porte-voix, mais d'autres cris et chants s'élèvent.
Gwenaël Bulteau a rencontré un joli succès avec son premier roman, La république des faibles (Prix Landerneau polar 2021), un vrai bon polar historique qui se déroulait en 1898.
A-t-il reproduit les mêmes schémas pour ce deuxième roman ? Oui et non. Là où le précédent mettait vraiment en avant une enquête policière, celui-ci est d'une autre veine. Toujours assez noire, mais pas vraiment polar.
Alors oui, il est bien question d'une disparition et de quelques morts, mais cette histoire est avant tout centrée sur les personnages et le sort des prolétaires.
On pourrait réellement croire à un livre d'un illustre aîné littéraire de l'époque. Quel étonnant travail de reconstitution, allant jusqu'à la langue. Un vrai retour vers le passé, dans la crasse et les douleurs des petites gens, et de ceux qui osent sortir de leur condition pour les côtoyer.
On est loin d'une reconstitution en papier mâché, on s'y croirait à suivre ces personnages qui luttent.
L'un des points communs des deux livres est la manière appuyée de parler de la situation des femmes, de leur peu de droits. Car ce sont plusieurs d'entre-elles qui sont mises en lumière dans les méandres des ruelles, à se battre tout comme à chercher à comprendre. Des femmes fortes à une époque où elles n'avaient pas vraiment voix au chapitre.
Le roman suit donc leurs chemins et leurs errances, à une époque clé où la révolte gronde. Il s'attache vraiment aux personnages, c'est le sens même de ce récit.
Le livre est donc autant affaire de ressentis, de tragédies quotidiennes, que l'histoire de la disparition d'une jeune fille. Cet événement devient une sorte de fil conducteur qui permet de suivre ces gens-là, loin de tous clichés.
La forme romanesque est donc plus évanescente qu’avec le premier roman, même si l’histoire réserve son lot de (sérieuses) surprises dans sa deuxième partie.
Avec Le grand soir, Gwenaël Bulteau propose une fiction noire au plus près du réel et des personnages forts qu’il a dessinés. Un voyage dans le temps fictionnel mais qui a beaucoup à nous apprendre de ce passé si loin si proche.
Lien : https://gruznamur.com/2022/1..
Louise Michel est enterrée en cette année 1905, la foule suit le cortège dans une tension palpable. La lutte ouvrière perd un porte-voix, mais d'autres cris et chants s'élèvent.
Gwenaël Bulteau a rencontré un joli succès avec son premier roman, La république des faibles (Prix Landerneau polar 2021), un vrai bon polar historique qui se déroulait en 1898.
A-t-il reproduit les mêmes schémas pour ce deuxième roman ? Oui et non. Là où le précédent mettait vraiment en avant une enquête policière, celui-ci est d'une autre veine. Toujours assez noire, mais pas vraiment polar.
Alors oui, il est bien question d'une disparition et de quelques morts, mais cette histoire est avant tout centrée sur les personnages et le sort des prolétaires.
On pourrait réellement croire à un livre d'un illustre aîné littéraire de l'époque. Quel étonnant travail de reconstitution, allant jusqu'à la langue. Un vrai retour vers le passé, dans la crasse et les douleurs des petites gens, et de ceux qui osent sortir de leur condition pour les côtoyer.
On est loin d'une reconstitution en papier mâché, on s'y croirait à suivre ces personnages qui luttent.
L'un des points communs des deux livres est la manière appuyée de parler de la situation des femmes, de leur peu de droits. Car ce sont plusieurs d'entre-elles qui sont mises en lumière dans les méandres des ruelles, à se battre tout comme à chercher à comprendre. Des femmes fortes à une époque où elles n'avaient pas vraiment voix au chapitre.
Le roman suit donc leurs chemins et leurs errances, à une époque clé où la révolte gronde. Il s'attache vraiment aux personnages, c'est le sens même de ce récit.
Le livre est donc autant affaire de ressentis, de tragédies quotidiennes, que l'histoire de la disparition d'une jeune fille. Cet événement devient une sorte de fil conducteur qui permet de suivre ces gens-là, loin de tous clichés.
La forme romanesque est donc plus évanescente qu’avec le premier roman, même si l’histoire réserve son lot de (sérieuses) surprises dans sa deuxième partie.
Avec Le grand soir, Gwenaël Bulteau propose une fiction noire au plus près du réel et des personnages forts qu’il a dessinés. Un voyage dans le temps fictionnel mais qui a beaucoup à nous apprendre de ce passé si loin si proche.
Lien : https://gruznamur.com/2022/1..
Laissez-vous embarquer dans un voyage que vous n'oublierez pas de si tôt !
Le premier janvier, nous souhaitons leur fête aux Clair, les brillants, les glorieux. Seulement, en 1898, dans une France qui, sous la IIIᵉ République, n'arrive pas encore à poser de manière pérenne ses principes fondamentaux que sont la démocratie, les libertés, la laïcité, les droits sociaux, la justice pour tous, c'est l'obscurité qui va s'abattre sur la ville de Lyon avec, l'atroce découverte par un chiffonnier du corps d'un enfant sans tête.
Le commissaire Jules Soubielle sera chargé de l'enquête dans un climat de tension extrême à l'approche d'élections législatives où le socialisme naissant fait face au nationalisme et surtout l'antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus.
Le commissaire devra jongler entre ses ennuis personnels, ses équipes déchirées entre problème d'alcool et idéaux politiques, une misère sociale présente à tous les coins de rue, les secrets cachés de familles comme les Génor et les sévices subis par certains enfants.
Gwenaël Bulteau signe avec La République des faibles un magistral premier roman, récompensé par le prix Landerneau. Professeur des écoles, on ressent dans son texte l'affection et l'engagement auprès des enfants et son combat contre l'injustice sociale. Polar, roman noir, roman social, roman historique, un récit multi-facettes et une prose poétique font de ce roman un petit bijou de l'édition contemporaine.
Un grand merci aux éditions La manufacture de livres et à l'auteur pour ce magnifique roman.
Le premier janvier, nous souhaitons leur fête aux Clair, les brillants, les glorieux. Seulement, en 1898, dans une France qui, sous la IIIᵉ République, n'arrive pas encore à poser de manière pérenne ses principes fondamentaux que sont la démocratie, les libertés, la laïcité, les droits sociaux, la justice pour tous, c'est l'obscurité qui va s'abattre sur la ville de Lyon avec, l'atroce découverte par un chiffonnier du corps d'un enfant sans tête.
Le commissaire Jules Soubielle sera chargé de l'enquête dans un climat de tension extrême à l'approche d'élections législatives où le socialisme naissant fait face au nationalisme et surtout l'antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus.
Le commissaire devra jongler entre ses ennuis personnels, ses équipes déchirées entre problème d'alcool et idéaux politiques, une misère sociale présente à tous les coins de rue, les secrets cachés de familles comme les Génor et les sévices subis par certains enfants.
Gwenaël Bulteau signe avec La République des faibles un magistral premier roman, récompensé par le prix Landerneau. Professeur des écoles, on ressent dans son texte l'affection et l'engagement auprès des enfants et son combat contre l'injustice sociale. Polar, roman noir, roman social, roman historique, un récit multi-facettes et une prose poétique font de ce roman un petit bijou de l'édition contemporaine.
Un grand merci aux éditions La manufacture de livres et à l'auteur pour ce magnifique roman.
Fin du XIXe siècle, à Lyon, alors que la célèbre Affaire Dreyfus tient le haut du pavé, les ligues nationalistes font le coup de poing avec les organisations communistes, souvent clandestines.
Dans cette ambiance très tendue, le probable meurtre d’un enfant, dont un chiffonier vient de retrouver la dépouille sur les pentes de la Croix-Rousse en janvier 1898, ne peut qu'augmenter cette ambiance de violence sourde .
Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes tensions, entre nationalisme, antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme naissant.
On triche un peu dans notre rubrique romanciers de Lyon : contrairement à Yamina Benahmed Daho et François Médeline, les deux derniers écrivains ayant eu les honneurs de cette catégorie Gwenaël Bulteau n'est pas vraiment une plume locale puisque, comme son prénom l'indique du reste, il est né et réside toujours en Vendée. Mais on ne pense pas qu'il ira nous chercher des poux dans la tête si l'on classe son premier roman, La République des faibles dans la catégorie des romans lyonnais.
En effet, son auteur a situé son intrigue dans la cité des Gones et il doit d'ailleurs beaucoup à la ville de Lyon, puisqu'une de ses nouvelles policières, point de naissance de ce premier roman, avait été récompensé par le célèbre festival Quais du Polar, assurément bien accroché entre Rhône et Saône.
Mais trève de chauvinisme local, le plus important est bien que Gwenaël Bulteau nous livre ici un très solide roman policier historique, nous ramenant à la fin du XIXème siècle, en pleine affaire Dreyfus, en mélant histoire et intrigue policière dans la doite lignée d’ un Hervé Le Corre
Privilégiant l’action aux analyses psychologiques, Gwenaël Bulteau nous immerge dans un polar très solidement construit avec un style classique que ne renierait pas Dickens et Zola.
Le Jury du Prix Landerneau Polar qui vient tout juste de le consacrer ne s'y est d'ailleurs pas trompé du tout !
Lien : http://www.baz-art.org/archi..
Gwenaël Bulteau nous offre un nouveau roman historique. Un roman social et politique dans lequel les femmes luttent pour leur émancipation, les ouvriers pour que leurs conditions de travail s’améliorent.
Nous sommes le 22 janvier 1905 : un cortège populaire accompagne la dépouille de Louise Michel, figure majeure de la Commune de Paris, dans sa dernière villégiature sise au cimetière de Levallois Perret. Parmi la cohorte d’ouvriers, se faufile une certaine Jeanne Desroselles. La jeune fille, dont le père est un riche industriel, s’intéresse depuis quelques mois aux revendications des prolétaires, travailleurs de tout poil. Elle va disparaître peu après et les actions déployées pour la retrouver vont se retrouver vaines. Un peu plus d’un an plus tard, Lucie , la cousine de Jeanne, va décider de reprendre de manière officieuse l’enquête à son compte. Pour se faire, elle va devoir revêtir les habits du peuple pour tenter d’obtenir des renseignements auprès des personnes que sa cousine avait côtoyées. Au cours d’un meeting syndical en mémoire des mineurs morts à Courrières quelques semaines plus tôt, elle va faire la connaissance du Docteur Pelletier, une des rares femmes étant autorisées à exercer le métier, puis elle va être mise sur la piste d’un couple dont le mari imite les passants. Un couple que fréquentait régulièrement Jeanne et qui sont peut-être les derniers à l’avoir vu. Alors que Lucie poursuit ses investigations, la colère gronde dans le milieu ouvrier, attisée par quelques leaders charismatiques, motivant leurs troupes à se rassembler pour une manifestation d'ampleur qui se tiendra à Paris le 1er mai. Ce jour béni de la révolution sociale qui renversera la société bourgeoise et capitaliste . Le Grand Soir.
L’auteur vendéen nous plonge avec cette écriture dans ces années tumultueuses du début du siècle dont l’un des évènements déclencheurs est la mort d’une millier de mineurs à Courrières le 10 mars 1906 dans le nord de la France .La gestion de cette catastrophe par les autorités locales, privilégiant la reprise de l’activité au sort des malheureux disparus, la colère des mineurs gronde et va se traduire par des grèves multiples qui vont ensuite s’étendre sur tout le pays avec en point de mire le premier mai prochain.
Gwenael Bulteau intègre sur fonds de mouvement social une affaire de disparition et un assassinat. Le scénario nous propose alors deux histoires distinctes : les investigations de Lucie d’une part dans un Paris où les quartiers luxueux côtoient des bidonvilles à ciel ouvert , dans lequel on survit de bric et d' broc, de boulots exténuants sous-payés , ou de menus trafics. La jeune femme qui cotoie cette classe défavorisée va peu à peu se laisser emporter par ces demandes légitimes et en premier chef le droit des femmes qui veulent pouvoir voter, travailler, n’être plus considérées que comme un objet de plaisir et de reproduction. En parallèle, on fait connaissance avec la citoyenne Sorgue , anarcho-syndicaliste, meneuse d’hommes, prête à dilapider sa fortune pour aider les travailleurs et leurs idées, activiste surveillée de près par la police qui souhaite contrôler ses actions futures . C’est également une féministe de la première heure qui entend bien protéger ses semblables de tous les abus possibles.
L’auteur mêle ainsi personnages de fiction et ceux qui ont fait l’Histoire comme Mme Sorgue et Madeleine Pelletier, offrant au récit une épaisseur historique qui renforce sa qualité de témoignage autant que sa qualité romanesque, celle-ci uniquement due à la valeur de l’écriture de son auteur.
Nous sommes le 22 janvier 1905 : un cortège populaire accompagne la dépouille de Louise Michel, figure majeure de la Commune de Paris, dans sa dernière villégiature sise au cimetière de Levallois Perret. Parmi la cohorte d’ouvriers, se faufile une certaine Jeanne Desroselles. La jeune fille, dont le père est un riche industriel, s’intéresse depuis quelques mois aux revendications des prolétaires, travailleurs de tout poil. Elle va disparaître peu après et les actions déployées pour la retrouver vont se retrouver vaines. Un peu plus d’un an plus tard, Lucie , la cousine de Jeanne, va décider de reprendre de manière officieuse l’enquête à son compte. Pour se faire, elle va devoir revêtir les habits du peuple pour tenter d’obtenir des renseignements auprès des personnes que sa cousine avait côtoyées. Au cours d’un meeting syndical en mémoire des mineurs morts à Courrières quelques semaines plus tôt, elle va faire la connaissance du Docteur Pelletier, une des rares femmes étant autorisées à exercer le métier, puis elle va être mise sur la piste d’un couple dont le mari imite les passants. Un couple que fréquentait régulièrement Jeanne et qui sont peut-être les derniers à l’avoir vu. Alors que Lucie poursuit ses investigations, la colère gronde dans le milieu ouvrier, attisée par quelques leaders charismatiques, motivant leurs troupes à se rassembler pour une manifestation d'ampleur qui se tiendra à Paris le 1er mai. Ce jour béni de la révolution sociale qui renversera la société bourgeoise et capitaliste . Le Grand Soir.
L’auteur vendéen nous plonge avec cette écriture dans ces années tumultueuses du début du siècle dont l’un des évènements déclencheurs est la mort d’une millier de mineurs à Courrières le 10 mars 1906 dans le nord de la France .La gestion de cette catastrophe par les autorités locales, privilégiant la reprise de l’activité au sort des malheureux disparus, la colère des mineurs gronde et va se traduire par des grèves multiples qui vont ensuite s’étendre sur tout le pays avec en point de mire le premier mai prochain.
Gwenael Bulteau intègre sur fonds de mouvement social une affaire de disparition et un assassinat. Le scénario nous propose alors deux histoires distinctes : les investigations de Lucie d’une part dans un Paris où les quartiers luxueux côtoient des bidonvilles à ciel ouvert , dans lequel on survit de bric et d' broc, de boulots exténuants sous-payés , ou de menus trafics. La jeune femme qui cotoie cette classe défavorisée va peu à peu se laisser emporter par ces demandes légitimes et en premier chef le droit des femmes qui veulent pouvoir voter, travailler, n’être plus considérées que comme un objet de plaisir et de reproduction. En parallèle, on fait connaissance avec la citoyenne Sorgue , anarcho-syndicaliste, meneuse d’hommes, prête à dilapider sa fortune pour aider les travailleurs et leurs idées, activiste surveillée de près par la police qui souhaite contrôler ses actions futures . C’est également une féministe de la première heure qui entend bien protéger ses semblables de tous les abus possibles.
L’auteur mêle ainsi personnages de fiction et ceux qui ont fait l’Histoire comme Mme Sorgue et Madeleine Pelletier, offrant au récit une épaisseur historique qui renforce sa qualité de témoignage autant que sa qualité romanesque, celle-ci uniquement due à la valeur de l’écriture de son auteur.
Premier janvier 1898, nuit de goudron sur la décharge de la croix rousse, haut quartier des célèbres canuts qui se dispute le sommet de ce coin de ciel de France avec la basilique Notre-Dame de Fourvière, la tour crayon n’ayant pas encore écrit son empreinte moderne dans Lyon, capitale des Gaules.
Lyon, la capitale dégueule quotidiennement son lot de vieux journaux, les torchons de la veille que récupèrent, harassés, les chiffonniers dès potron-minet pour les revendre aux imprimeries qui, déjà, avant l'heure des verts partis écologistes, recyclent son papier ad libitum.
Seulement ce matin là, c’est le jeune corps sans tête d'un garçon d'une dizaine d’années vêtu d'une robe de fille que débusque Pierre Démange à la place de la presse locale ardemment recherchée.
Un corps sans face sous la pile de papier !
Macabre découverte qui va déposséder la maréchaussée de son annuel jour de congé. Congédié le férié.
Le commissaire Soubielle, récemment arrivé en ville et ses sbires sont chargés de l’enquête qui va nous permettre une lugubre introspection minutieuse du Lyon du 19ème finissant.
L’époque est encore aux rapports rédigés à la plume trempée dans l'encrier mais déjà aux premiers tramways qui grimpent les rues escarpées et aux miliciens d’extrême droite qui, sur les quais de Saône, en réunion, vitupèrent et maudissent juifs, étrangers et syndicats naissants.
En tournant les pages de ce polar historique, on pataugera dans les fangeux dédales obscurs et les bouibouis mal famés des basfonds de la cité à tenter de débusquer les pervers patentés.
On verra fondre au noir des plus sombres le condé engagé, et dans une double vie, et dans un activisme politique déviant vers une idéologie nauséabonde qui a malheureusement toujours le vent mauvais (comme dit si bien Verlaine) en poupe aujourd’hui.
On entendra siffler le train des balles qui feront gronder des tempêtes sous des crânes perforés par l’ogive si parfaitement usinée.
On assistera, médusés et impuissants, à des pratiques policières que notre rigoureuse époque réprouverait en vociférant à grands cris d’orfraies avec un empressement médiatiquement relayé et scandalisé.
La misère la plus sale et les mœurs les plus sordides projetteront leurs noirs desseins sur les écrans sombres de nos nuits hantées par ces vies détruites dès leur plus jeune âge par les bas instincts d’une humanité qui n’en est plus une et qui heurtera notre coquet confort contemporain pourtant pas si lointain des années retracées ici.
Des miasmes, du sang, du foutre, des fluxes et refluxes corporels viendront éclabousser notre inconscient subitement éclairé par les becs de gaz incandescents braqués sur les bas quartiers populaires et défavorisés de la ville pourtant symbole de haute gastronomie et de savoir-vivre.
Au diable la rosette tentatrice ou la quenelle sauce Nantua, ici on se damne non pour un met fin et réputé mais pour seulement survivre parmi rats et poux.
On naviguera bouche bée et sans vue dans les commissures de la presqu’île dans le sillage d’une police gangrenée par des idées âcres infusées par l’affaire Dreyfus qui enflamme et divise la nation. Sans honte et sans retenue, ces idées délétères serpentent et s’immiscent par les étroits boyaux des couloirs des commissariats d’arrondissement.
On mènera l’enquête, croisant ici hélas : trognes et cancrelats, politiciens véreux et mains baladeuses, artistes ratés et apothicaires pochtronnés, flics corrompus et chiens battus, corps sans tête ou sans mains et exhibitionnistes désinhibés, pédophiles répugnants et assassins sans scrupules, une galerie de porcs, traits pour traits typiques des fantasmes accrochés à ces faubourgs abandonnés d’alors et pas encore gentrifiés.
Choquant toujours, scabreux parfois, le récit oscille entre ‘les misérables’ et ‘Vidocq’ pour nous restituer la noirceur de charbon d'une époque pas si lointaine finalement et pourtant enfouie.
Un roman sinistre et d'une noirceur insondable qui pourra rebuter par les descriptions cruellement réalistes dont sont constitués certains paragraphes comme par la nature profondément abjecte de certains personnages qui pourraient faire passer le couple Thénardier de Hugo pour des créatures évanescentes de la comtesse de Ségur.
Pour lecteurs avertis tout de même !
Lyon, la capitale dégueule quotidiennement son lot de vieux journaux, les torchons de la veille que récupèrent, harassés, les chiffonniers dès potron-minet pour les revendre aux imprimeries qui, déjà, avant l'heure des verts partis écologistes, recyclent son papier ad libitum.
Seulement ce matin là, c’est le jeune corps sans tête d'un garçon d'une dizaine d’années vêtu d'une robe de fille que débusque Pierre Démange à la place de la presse locale ardemment recherchée.
Un corps sans face sous la pile de papier !
Macabre découverte qui va déposséder la maréchaussée de son annuel jour de congé. Congédié le férié.
Le commissaire Soubielle, récemment arrivé en ville et ses sbires sont chargés de l’enquête qui va nous permettre une lugubre introspection minutieuse du Lyon du 19ème finissant.
L’époque est encore aux rapports rédigés à la plume trempée dans l'encrier mais déjà aux premiers tramways qui grimpent les rues escarpées et aux miliciens d’extrême droite qui, sur les quais de Saône, en réunion, vitupèrent et maudissent juifs, étrangers et syndicats naissants.
En tournant les pages de ce polar historique, on pataugera dans les fangeux dédales obscurs et les bouibouis mal famés des basfonds de la cité à tenter de débusquer les pervers patentés.
On verra fondre au noir des plus sombres le condé engagé, et dans une double vie, et dans un activisme politique déviant vers une idéologie nauséabonde qui a malheureusement toujours le vent mauvais (comme dit si bien Verlaine) en poupe aujourd’hui.
On entendra siffler le train des balles qui feront gronder des tempêtes sous des crânes perforés par l’ogive si parfaitement usinée.
On assistera, médusés et impuissants, à des pratiques policières que notre rigoureuse époque réprouverait en vociférant à grands cris d’orfraies avec un empressement médiatiquement relayé et scandalisé.
La misère la plus sale et les mœurs les plus sordides projetteront leurs noirs desseins sur les écrans sombres de nos nuits hantées par ces vies détruites dès leur plus jeune âge par les bas instincts d’une humanité qui n’en est plus une et qui heurtera notre coquet confort contemporain pourtant pas si lointain des années retracées ici.
Des miasmes, du sang, du foutre, des fluxes et refluxes corporels viendront éclabousser notre inconscient subitement éclairé par les becs de gaz incandescents braqués sur les bas quartiers populaires et défavorisés de la ville pourtant symbole de haute gastronomie et de savoir-vivre.
Au diable la rosette tentatrice ou la quenelle sauce Nantua, ici on se damne non pour un met fin et réputé mais pour seulement survivre parmi rats et poux.
On naviguera bouche bée et sans vue dans les commissures de la presqu’île dans le sillage d’une police gangrenée par des idées âcres infusées par l’affaire Dreyfus qui enflamme et divise la nation. Sans honte et sans retenue, ces idées délétères serpentent et s’immiscent par les étroits boyaux des couloirs des commissariats d’arrondissement.
On mènera l’enquête, croisant ici hélas : trognes et cancrelats, politiciens véreux et mains baladeuses, artistes ratés et apothicaires pochtronnés, flics corrompus et chiens battus, corps sans tête ou sans mains et exhibitionnistes désinhibés, pédophiles répugnants et assassins sans scrupules, une galerie de porcs, traits pour traits typiques des fantasmes accrochés à ces faubourgs abandonnés d’alors et pas encore gentrifiés.
Choquant toujours, scabreux parfois, le récit oscille entre ‘les misérables’ et ‘Vidocq’ pour nous restituer la noirceur de charbon d'une époque pas si lointaine finalement et pourtant enfouie.
Un roman sinistre et d'une noirceur insondable qui pourra rebuter par les descriptions cruellement réalistes dont sont constitués certains paragraphes comme par la nature profondément abjecte de certains personnages qui pourraient faire passer le couple Thénardier de Hugo pour des créatures évanescentes de la comtesse de Ségur.
Pour lecteurs avertis tout de même !
En 1898, un cadavre est découvert dans une décharge lyonnaise. C'est celui d'un enfant, mais il lui manque la tête.
L'enquête commence vite, ou plutôt les enquêtes, car dans ce commissariat chacun travaille de manière personnelle. Cette police est désunie, à l'image d'une société fracturée à l'époque, qui se déchire notamment à propos de l'affaire Dreyfus.
L'intérêt principal de ce roman réside dans son contexte historique, plus que dans l'intrigue qui reste plutôt "classique".
Je me suis laissé porter par l'ambiance mais il manque à ce roman une petite touche qui l'aurait magnifié, soit un brin de fantaisie, soit un ou plusieurs personnages qui m'aurait fait vibrer.
C'était pour moi la première lecture d'une ouvrage sélectionné pour le Prix Cezame 2022, et probablement ni la meilleure ni la moins bonne.
L'enquête commence vite, ou plutôt les enquêtes, car dans ce commissariat chacun travaille de manière personnelle. Cette police est désunie, à l'image d'une société fracturée à l'époque, qui se déchire notamment à propos de l'affaire Dreyfus.
L'intérêt principal de ce roman réside dans son contexte historique, plus que dans l'intrigue qui reste plutôt "classique".
Je me suis laissé porter par l'ambiance mais il manque à ce roman une petite touche qui l'aurait magnifié, soit un brin de fantaisie, soit un ou plusieurs personnages qui m'aurait fait vibrer.
C'était pour moi la première lecture d'une ouvrage sélectionné pour le Prix Cezame 2022, et probablement ni la meilleure ni la moins bonne.
En pleine Troisième République, le premier janvier 1898, alors que les cloches de Fourvière carillonnent, un chiffonnier trouve, dans la décharge de la Croix-Rousse, le cadavre d'un petit garçon vêtu d'une robe. le commissaire Jules Soubielle, qui aimerait réformer la police, enquête avec trois autres officiers : Aurélien Caron, spécialiste des affaires criminelles connu pour sa brutalité, Gabriel Silent, tenté par la politique, antisémite notoire, et Fernand Grimbert, alcoolique assez violent, qui rêve de justice sociale. Si Lyon ne vit pas au rythme de Paris, l'histoire de cette fin de siècle y connaît les mêmes soubresauts : la misère, les révoltes ouvrières, l'antisémitisme, la violence envers les femmes, le travail des enfants, etc.
***
Dans La République des faibles, Gwenaël Bulteau entraine ses lecteurs dans une enquête qui connaîtra plusieurs rebondissements et fausses pistes, et sur laquelle viendront se greffer les histoires personnelles des policiers enquêteurs et de certains participants. Rien que de très classique, en fait. Ce qui fait l'originalité de ce polar, c'est l'époque à laquelle il se déroule. Les ouvriers lyonnais travaillent toujours dans d'épouvantables conditions. Ils ont gardé en mémoire les massacres des Communards par monsieur Thiers. Une grande partie de la population cultive la haine des Prussiens depuis la défaite de 1870. de plus, milieu janvier 1898, en pleine enquête sur plusieurs meurtres que je vous laisse découvrir, paraît le « j'accuse » de Zola qui ravive le fort antisémitisme ambiant et provoque le chaos chez les ligueurs. Ajoutons à cela l'omniprésence de l'alcool quel que soit le milieu social, les abus sexuels sur les enfants, les assassinats de nourrissons, les avortements clandestins, etc. N'en jetez plus ! C'est cette surenchère dans l'horreur qui a douché mon intérêt pour le récit. Certaines outrances et incohérences dans les actes et les portraits (ceux des femmes, surtout, voir p. 240 entre autres) expliquent ma relative tiédeur. Il n'en reste pas moins que ce premier roman est très prometteur !
***
Dans La République des faibles, Gwenaël Bulteau entraine ses lecteurs dans une enquête qui connaîtra plusieurs rebondissements et fausses pistes, et sur laquelle viendront se greffer les histoires personnelles des policiers enquêteurs et de certains participants. Rien que de très classique, en fait. Ce qui fait l'originalité de ce polar, c'est l'époque à laquelle il se déroule. Les ouvriers lyonnais travaillent toujours dans d'épouvantables conditions. Ils ont gardé en mémoire les massacres des Communards par monsieur Thiers. Une grande partie de la population cultive la haine des Prussiens depuis la défaite de 1870. de plus, milieu janvier 1898, en pleine enquête sur plusieurs meurtres que je vous laisse découvrir, paraît le « j'accuse » de Zola qui ravive le fort antisémitisme ambiant et provoque le chaos chez les ligueurs. Ajoutons à cela l'omniprésence de l'alcool quel que soit le milieu social, les abus sexuels sur les enfants, les assassinats de nourrissons, les avortements clandestins, etc. N'en jetez plus ! C'est cette surenchère dans l'horreur qui a douché mon intérêt pour le récit. Certaines outrances et incohérences dans les actes et les portraits (ceux des femmes, surtout, voir p. 240 entre autres) expliquent ma relative tiédeur. Il n'en reste pas moins que ce premier roman est très prometteur !
68 textes. Quelques 300 pages. 68 hommes et femmes pour jeter une bouteille à la mer, dire leur colère, leur amertume, leur désespérance.
Un combat, ou 10, ou 100... L'anthropocène devenu capitalocène et anthropocide; la folie guerrière qui jette ses filets pour prendre les dollars des marchands de guerre; l'ineptie d'empoisonner la terre au principe de nourrir les populations; l'injure faite aux majorités dans l'injonction de faire plus et mieux quand ils donnent quasiment tout; le mépris jeté à la face de jeunes qui n'ont d'avenir assuré que leur lendemain; l'abrutissement orchestré dans une virtualisation offerte comme un pis aller rassurant; la compétition stérile et injurieuse sans cirque mais nourris de pouces baissés...
68 textes, cela fait beaucoup de mots et pourtant si peu quand il faudrait reboiser les esprits de milliers de gens.
Mais peu de mots au carré, au cube, à la puissance de 1000 lecteurs, voilà que cela devient une marée, un tsunami.
Romanciers, poètes, dessinateurs, réalisateurs, journalistes, sociologues, ces hommes et femmes ont joué le jeu d'un appel lancé par Oliviet Bordaçarre. Ecrire pour marquer un Stop, pour dire la colère et la peur.
Bribes de réflexion, manifestes, poèmes, courtes nouvelles, ces textes empoignent le cœur, rallument l'effroi ou offrent un peu d'espoir. Mais tous sans exceptions, secouent la torpeur insouciante qui sait que la situation est grave mais veut croire que l'humanité, en bonne élève, poursuivra sa course, persuadée de l'impossibilité de son extinction.
Collapsologie, pourront penser certains, oublieux des chiffres qui disent chaque jour la disparition de nos voisins aquatiques, volatiles, férus de froid, ou de forêts luxuriantes.
C'est peut-être un coup d'épée dans un océan d'impossibles, mais il a le mérite d'exister.
Alors, je sais gré à chacun de ces hommes et femmes, sentinelles, qui posent des mots comme on gratte une plaie, pour qu'elle suppure, gangrenne, et qu'enfin on coupe le membre.
Qu'importe le temps qu'il nous reste. Toutes les civilisations se sont éteintes un jour, mais, sans doute pouvons nous gagner un peu de temps avant que, pour citer cette belle expression de Mouloud Akkouche, la planète ne baisse définitivement ses paupières.
Un grand coup de chapeau à l'éditeur, la manufacture des livres, qui a joué le jeu.
Et, cerise sur le gâteau, tous les droits du livre dont reversés à des associations et collectifs locaux qui, en fourmis travailleuses, œuvrent sans relâche pour faire leur part du colibri.
Un combat, ou 10, ou 100... L'anthropocène devenu capitalocène et anthropocide; la folie guerrière qui jette ses filets pour prendre les dollars des marchands de guerre; l'ineptie d'empoisonner la terre au principe de nourrir les populations; l'injure faite aux majorités dans l'injonction de faire plus et mieux quand ils donnent quasiment tout; le mépris jeté à la face de jeunes qui n'ont d'avenir assuré que leur lendemain; l'abrutissement orchestré dans une virtualisation offerte comme un pis aller rassurant; la compétition stérile et injurieuse sans cirque mais nourris de pouces baissés...
68 textes, cela fait beaucoup de mots et pourtant si peu quand il faudrait reboiser les esprits de milliers de gens.
Mais peu de mots au carré, au cube, à la puissance de 1000 lecteurs, voilà que cela devient une marée, un tsunami.
Romanciers, poètes, dessinateurs, réalisateurs, journalistes, sociologues, ces hommes et femmes ont joué le jeu d'un appel lancé par Oliviet Bordaçarre. Ecrire pour marquer un Stop, pour dire la colère et la peur.
Bribes de réflexion, manifestes, poèmes, courtes nouvelles, ces textes empoignent le cœur, rallument l'effroi ou offrent un peu d'espoir. Mais tous sans exceptions, secouent la torpeur insouciante qui sait que la situation est grave mais veut croire que l'humanité, en bonne élève, poursuivra sa course, persuadée de l'impossibilité de son extinction.
Collapsologie, pourront penser certains, oublieux des chiffres qui disent chaque jour la disparition de nos voisins aquatiques, volatiles, férus de froid, ou de forêts luxuriantes.
C'est peut-être un coup d'épée dans un océan d'impossibles, mais il a le mérite d'exister.
Alors, je sais gré à chacun de ces hommes et femmes, sentinelles, qui posent des mots comme on gratte une plaie, pour qu'elle suppure, gangrenne, et qu'enfin on coupe le membre.
Qu'importe le temps qu'il nous reste. Toutes les civilisations se sont éteintes un jour, mais, sans doute pouvons nous gagner un peu de temps avant que, pour citer cette belle expression de Mouloud Akkouche, la planète ne baisse définitivement ses paupières.
Un grand coup de chapeau à l'éditeur, la manufacture des livres, qui a joué le jeu.
Et, cerise sur le gâteau, tous les droits du livre dont reversés à des associations et collectifs locaux qui, en fourmis travailleuses, œuvrent sans relâche pour faire leur part du colibri.
En tant que Républicain fanatique ( si , si ) je n ai aucune sympathie pour les Bonap tant le numéro 1 mort dans l Atlantique que le 3 perdu dans le smog anglais quand au 2 il défuncta de la grippe aviaire , bon entre les armoiries de son père et de sa mère c 'était couru Bon revenons à nos volailles je disais ;cette famille s 'est évertuée a assassiner Marianne avec quel résultat le Corse nous a coûté un siècle de domination Rosbif le second une magistrale claque teutonne ( merci Badinguet ) Mais est il nécessaire dans les 2 rompol cette République comme dans ces lèvres de saphir qui se déroulent dans le second empire de plonger obligatoirement dans le sordide , le gore , le misérabilisme le plus minable et sale pour nous narrer une histoire policière ? ben non ce n est pas Nana , l'Assommoir ou Germinal et je vais faire pleurer les auteurs de ces 2 tristes pensums ; la révélation va être dure vous n 'êtes pas Zola Désolé !!!
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Gwenaël Bulteau
Lecteurs de Gwenaël Bulteau (706)Voir plus
Quiz
Voir plus
Autobiographies de l'enfance
C’est un roman autobiographique publié en 1894 par Jules Renard, qui raconte l'enfance et les déboires d'un garçon roux mal aimé.
Confession d’un enfant du siècle
La mare au diable
Poil de Carotte
12 questions
257 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur257 lecteurs ont répondu